Christoph MECKEL: Portrait-robot. Mon père
Eberhardt Meckel, fut un écrivain, un poète et critique allemand, né en 1907 à Freiburg im Breisgau, mort en 1969 dans la même ville. Après des études d’histoire de l’art et de philosophie, il monte à Berlin en 1929, se marie en 1931. Là, il essaye de réussir comme écrivain, s’accommodant de l’accession de Hitler au pouvoir, qu’il n’approuve pas. Il écrit des poèmes, des pièces radiophoniques, participe au monde culturel et à la presse nazis. Incorporé en 1940, il est promu lieutenant, avant d’être incarcéré comme prisonnier de guerre en Algérie. Revenu à Freiburg en 1947, il s’efforcera de poursuivre la carrière littéraire interrompue par la guerre. Christoph Meckel a bien connu cet homme, puisque celui-ci fut son père. Ou plutôt a-t-il cru bien le connaître, comme bien des allemands de sa génération. Car que sait-on exactement de la responsabilité des pères dans l’avènement d’un régime qui ne put se maintenir qu’avec la complicité au moins passive d’une majorité de la population? Où se situe la responsabilité de chacun? Et surtout comment se reconstruire, allemand, quand on est soi-même l’enfant de cette Histoire?
Il y a en Eberhardt Meckel, tel que la figure s’en dessine, après sa mort, sous le regard de son fils, quelque chose de typiquement allemand – une Allemagne, sortie du livre d’une autre époque, celle de la vieille littérature Romantique et Classique. Car Eberhardt est resté, par bien des points, un homme du 19è siècle : un écrivain, fils d’une lignée d’architectes, gérant sa vie avec sérieux et minutie; un univers bourgeois ordonné, peuplé de culture et d’amitiés; des valeurs qui dans le sein du foyer peuvent cependant se montrer brutales à l’égard des enfants dont on attend beaucoup, et qu’on n’hésite pas à corriger, même en ayant recours à des châtiments; une certaine raideur élitiste. C’est aussi un provincial, un homme du pays de Bade, de cette terre alémanique qui s’étend de Karlsruhe jusqu’à Bâle et au-delà le long du Rhin jusqu’à Constance, jusqu’à l’Alsace frontalière, et tout au nord de la Suisse jusqu’à la région de Zürich et la rive helvétique du lac de Constance. C’est la terre d’Hermann Hesse, dont le culte provincial a pu donner le meilleur, lorsqu’elle est justement le ferment de l’humanisme littéraire, ce pas-de-côté qui permit au grand écrivain de poser sur son pays ce regard distancié et critique qui en fit justement l’une des consciences morales de l’Allemagne du 20e siècle. Mais chez Eberhardt, le culte de sa province n’est qu’un provincialisme, une fuite du présent, un refus de se confronter à la tragédie politique en cours. Derrière l’amour des paysages de la Forêt-Noire donc, des sentiments tendres et des vins du Kaiserstuhl, une responsabilité, historique. Car il y a des fuites qui font l’Histoire. Et c’est de ce refuge dans l’image d’une Allemagne surannée que s’est nourri justement le nazisme, révélant une filiation dérangeante jusqu’au coeur de la grande culture allemande.
Portrait-robot, dit le titre du récit, et non réquisitoire ou portrait à charge. Ce paysage mental, émotionnel, culturel qui fut celui de son père, Christoph le reconstitue avec minutie, au cours de belles pages, dans lesquelles l’ironie manifeste dissimule mal un reste de bienveillance. Je parlerai plus loin de cette dimension du texte, liée à la question de l’héritage, et à la possibilité pour les enfants de la guerre de continuer à habiter émotionnellement, affectueusement cette terre allemande dévoyée par le nazisme, de reconstruire au fond ce que c’est qu’être allemand, que se sentir allemand. Question importante! Le centre apparent du livre cependant est ailleurs: il pose la grave question de la responsabilité politique d’une génération qui subit, accompagna, peut-être soutint, silencieusement ou non, l’avènement du nazisme en Allemagne. Comment une génération portée par les idées de rigueur, une certaine raideur intellectuelle, baignée dans le culte de la grande culture allemande et dans le culte sentimental de la nature a-t-elle pu enfanter cette négation même de l’intelligence et de la culture que fut le nazisme? A travers le portrait de son père, c’est donc un portrait intime, je dirais presque intimiste, de l’Allemagne d’hier qu’esquisse Meckel, ainsi qu’une radiographie des conséquences de cette histoire sur l’Allemagne d’aujourd’hui. De ce point de vue, son récit m’a semblé être un livre important dans l’histoire de ce qu’on a appelé la culpabilité allemande.
Eberhardt Meckel offre ainsi à son fils, dans cet exercice distancié et critique, où perce cependant, je le disais, une pointe d’affection, d’exercer une sorte de droit d’inventaire à l’encontre de toute une génération: c’est le portrait d’un provincial, monté à Berlin, puis retourné après-guerre se réfugier dans sa Province, absent pour ainsi dire de l’époque, se réfugiant dans un mélange de romantisme, de sentimentalisme, de goût pour la grande culture allemande, tout cela se traduisant par la composition d’une poésie surannée, qui eut un certain succès dans les années 30, coupée à la fois des expériences esthétiques contemporaines et des questions de l’époque – refuge en apparence innocent, mais qui fut un soutien objectif au nazisme. Pays natal, patrie, honneur, femme et enfant – les thèmes ressassés de la poésie d’un Eberhardt Meckel ont nourri l’imaginaire d’une époque prompte aux autodafés: « Alors que les SA défilaient, que le Reichstag brûlait, qu’il était lui-même témoin de déportations (il fut interrogé par un commando qui fouilla ses livres), il continuait à écrire récits et poèmes dans lesquels l’époque était absente. Il n’était pas le seul à avoir cette attitude. Il est étrange de voir que toutes sortes de gens de sa génération (toute une phalange de jeunes intellectuels) ont continué à vivre hors de leur temps. On s’isolait dans les poèmes sur la nature, on se recroquevillait dans les saisons, l’éternel, les valeurs pérennes, l’intemporel, la beauté de la nature et de l’art, dans des images consolatrices et dans la croyance que les misères passent avec le temps. » Tandis que Brecht, Döblin et Heinrich Mann émigrent, Eberhardt Meckel est à Berlin et cherche à se faire un nom. Nationaliste, il n’aime pas les nazis, qu’il trouve bruyants, vulgaires. Incapable cependant de rencontrer l’Histoire (Eberhardt n’est pas Thomas Mann!), l’écrivain s’accommoda de son dégoût pour le nazisme, au point de s’habituer lentement à lui, à travers une série de radicalisations successives, dont les historiens ont montré qu’elle avait été la véritable mécanique de la prise du pouvoir et du contrôle des esprits par le parti de Hitler. Ses notes personnelles et journaux intimes en témoignent douloureusement au cours du livre!
A travers son père, Christoph Meckel vise donc une époque. Son livre est important et interroge la passivité des pères. C’est aussi le beau portrait d’un homme, qui n’était qu’un homme, un homme plein de promesses, balloté par l’histoire, hanté par une culpabilité qu’il ne saura jamais porter au jour, encore moins en faire l’inspiration d’une oeuvre, donc finalement un homme et un écrivain ratés. C’est encore le portrait d’une époque, notamment des années d’après guerre en Allemagne, avec ses zones d’occupation. Christoph Merckel sait donner de la chair à son récit, jusque dans l’évocation des aspects les plus durs de l’Histoire, évoquant les privations de l’après-guerre, et leurs effets physiques sur les personnes, la vie dans les ruines des villes bombardées, les viols commis par les soviétiques dans la zone russe, le difficile déménagement de la famille d’Erfurt à Freiburg, à travers plusieurs zones d’occupation, l’influence de l’existentialisme dans la zone française, la venue de Beckett à Freiburg ou les peintres de l’École de Paris exposés dans les couloirs du Casino. Tout un paysage mental ressurgit ainsi, et moral.
C’est ainsi que tout naturellement la question de la filiation est au coeur de ce livre. A travers une question littéraire: ‘Comment saisir la vérité d’un être ?’, qui est d’abord un défi pour l’écriture, Christoph Meckel interroge aussi son propre rapport à son père, et à son ”pays”, la région autour de Freiburg dont Christoph fut aussi, jusqu’à sa mort, en 2020, un citoyen éminent, un de ces provinciaux cultivés sur lesquels repose aussi le fédéralisme d’outre-Rhin. « C’était beau de traverser sa région avec lui », écrit à un moment Christoph Meckel parlant de son père. Je n’ai pas vu de preuve à la fois plus simplement formulée et plus belle que quelque chose peut se léguer, y compris au cœur du tragique de l’Histoire, et qu’il y a dans les paysages, l’esprit des lieux, la façon dont on les contemple, mieux qu’une consolation -celle qu’aura cherché en vain toute sa vie Eberhardt Meckel- une reconstruction possible aussi, qui est peut-être la véritable essence de la poésie.
« Sa conscience était ébréchée. La question de la culpabilité allemande ne lui laissait pas de répit. On ne pouvait y répondre sans sacrifier sa probité personnelle, sur laquelle il insistait tant. Mais il ne la sacrifia pas.
Il espérait remporter aux points les rounds à venir.
Ce qu’il disait ne suffisait pas pour apprendre ce qu’il avait fait et pensé pendant la période nazie. Son rôle dans le contexte global n’apparaissait pas clairement. Ce qu’il racontait restait de l’ordre de l’anecdote: les horreurs de la guerre -VOUS N’AVEZ PAS IDÉE! Nous n’avions en effet pas idée et le croyions. Il exprimait l’abomination que lui inspiraient les crimes allemands et certains points restaient obscurs dans ses propos. Il semblait ne pas être sûr de sa légitime indignation. Son sentiment de culpabilité et son refoulement – sa vie dépendait toujours davantage de ses refoulements – livraient bataille à la mécanique de sa conscience.
Il ne faisait, désormais, que des choses justes et bonnes. Par sens civique et pour apaiser sa conscience. Il faisait don d’argent à des opérations d’aide internationales et à des fins humanitaires, sociales et politiques. Il soutenait la cellule locale du SPD. Il assistait aux assemblées communales, s’opposa aux lois sur l’état d’urgence, se fit remarquer par sa position critique lors de discussions publiques – et tout cela était juste. RESPECTABLE, comme il le disait lui-même. Désormais, faire ce qui était juste était inévitable et il faisait ce qui était juste avec ostentation. S’en préoccupait un peu trop et en parlait un peu trop. Une inquiétude singulière, perpétuelle pesait sur l’équité de ses actes. Il lui fallait alléger le fardeau de sa conscience. Il collectionnait les points.«
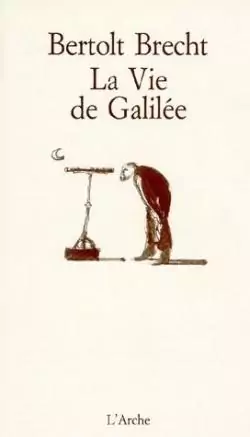
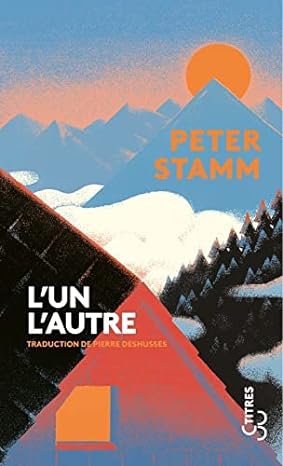
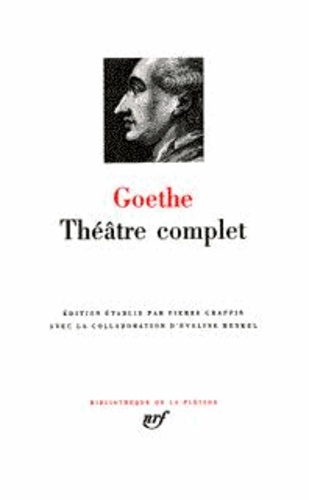
0 commentaire