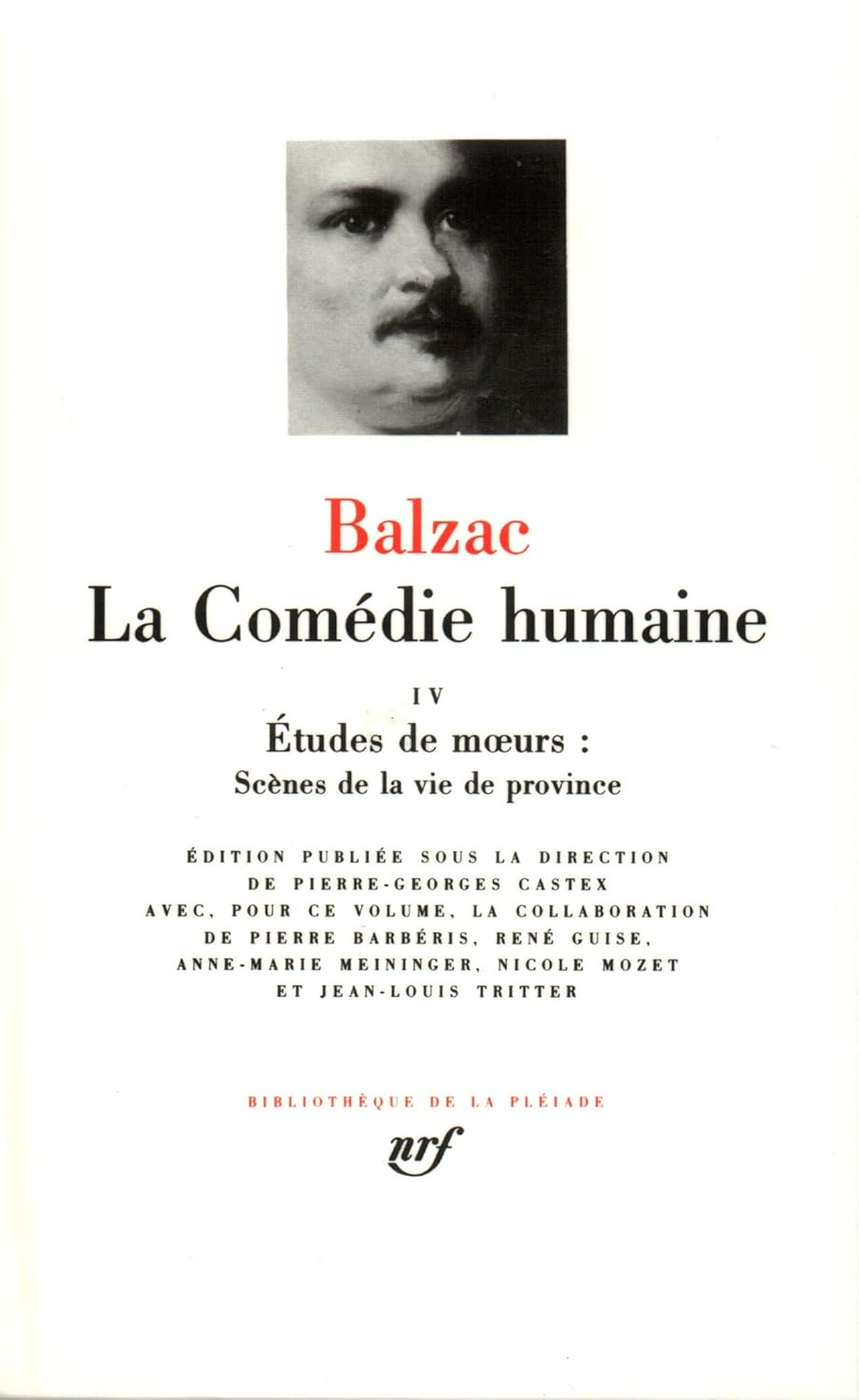Claude PUJADE-RENAUD: Le Désert de la grâce
Janvier 1712, dans la vallée de Chevreuse, Claude Dodart, médecin du Dauphin, assiste au cours d’une partie de chasse à un étonnant spectacle: dans le vallon qui abrita naguère un monastère de femmes, des pierres renversées, la terre qu’on remue, des corps qu’on déménage. C’est tout ce qui reste de Lire la suite…