Charles Ferdinand RAMUZ: Derborence
Un matin, comme tous les étés, les hommes sont montés à l’alpage de Derborence. Le bétail a suivi, les cloches ont tinté, et les femmes sont restées au village, comme toujours. Parmi eux, il y a Antoine, un jeune homme récemment marié, parti pour quelques semaines, pour gagner sa part de lait et de fromage. Mais une nuit, alors qu’ils sont là-haut, la montagne s’effondre. Un éboulement titanesque ensevelit tout : les chalets, les troupeaux, les hommes. Le village, en contrebas, médusé et incrédule, comprend trop tard. Il n’y a plus rien à faire. Et les morts sont pleurés. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux revient…
Pour cette étape de juillet des Escapades européennes placée sous le signe de la grande traversée des Alpes, j’ai choisi de suivre non un randonneur ou un explorateur, mais un survivant. Ce billet a été pour moi l’occasion de me replonger dans l’œuvre d’un écrivain que j’aime profondément : Charles-Ferdinand Ramuz. Il n’est plus beaucoup lu aujourd’hui, et c’est bien dommage, car il compte selon moi parmi les grands auteurs du XXe siècle, à la fois poète de la nature et penseur de la condition humaine.
Derborence (1934) appartient au cycle des romans de la montagne que Ramuz consacre à ce monde rude et clos, à la fois majestueux et menaçant. Dès 1904, dans un article simplement intitulé «Montagne», il affirmait que la littérature n’avait pas su traiter ce sujet: trop de pittoresque, pas assez de vérité. Pour lui, il fallait restituer la solitude, le silence, la verticalité inhumaine, la manière dont l’homme y chemine minuscule comme une fourmi, exposé à la violence brute comme à une grandeur qui le dépasse. Avec quelques autres romans, parmi lesquels La Grande Peur dans la montagne, Derborence incarne cette esthétique nouvelle, très loin des clichés alpins.
Mais alors que dans La Grande Peur (1926), Ramuz mettait en scène une sorte de tragédie moderne, le malheur final résultant de l’hubris des hommes montés vers l’alpage malgré les avertissements, ce sont les conséquences de la catastrophe survenue dès le début du roman qu’explore Derborence, dans une démarche plus intime, plus resserrée, portée par des images déployant la double dimension de la montagne – « [belle] à voir », mais « méchante ». Ramuz y donne toute place à ses légendes: celles de la quille du diable, notamment, point de rendez-vous du sabbat des sorcières, et de ces diablotins jouant aux quilles avec les rochers, qui hante littéralement le récit, notamment à travers la figure d’un vieux berger conduisant son troupeau d’ovins à la limite entre pâturages et haute montagne. C’est donc tout un paysage géographique, historique, légendaire qui dans Derborence jaillit de la plume de Ramuz, porté par une langue âpre, dure, reflet des montagnards taiseux qui habitent les vallées dominant le Rhône.
Le roman se nourrit ainsi d’un ancrage historique et géographique précis : l’alpage de Derborence existe, au pied des Diablerets, et un éboulement en 1714 a bel et bien enseveli chalets et troupeaux. Mais Ramuz ne fait pas œuvre de chroniqueur. Il transpose, il élève, il transforme cet événement en mythe moderne. Le retour d’Antoine, qu’on avait cru mort, fait de lui un revenant au sens fort : un homme qui revient d’un monde dont on ne revient pas. Se pose alors pour lui, comme pour tout Ulysse au terme de son Odyssée, la difficile question de retrouver sa place, dans son village et parmi les vivants. Thérèse, sa femme, l’attend, le reconnaît, mais même cela ne suffit pas. Quelque chose s’est brisé dans l’ordre du monde et Antoine retourne dans la montagne, pour tenter d’arracher désespérément à la montagne d’autres survivants. Jusqu’à ce que Thérèse, enceinte, monte à son tour le rejoindre pour tâcher de le ramener parmi les vivants.
Ce qui impressionne surtout dans le roman, c’est la façon dont la nature elle-même semble douée de langage: si la haute montagne est silencieuse, frappe par son univers minéral, son silence de « désert d’hommes », son univers de commencement ou de fin du monde, il lui arrive aussi de soupirer:
« et alors voilà que la montagne a soupiré, elle aussi, soulevant pesamment sa poitrine de pierre qu’elle laisse retomber avec la même pesanteur. »
Elle siffle et gronde:
« Et, eux aussi, interrogeaient ces profondeurs, d’où montaient seulement, comme en réponse, des grondements inexplicables, des grognements dépourvus de sens: d’où montaient seulement ces langues et ces tourbillons de poussière. »
Parfois même « toute la montagne éclate de rire ». L’éboulement, avec ses fumées, projette dans les airs le motif d’un livre:
« Ils continuaient à se débattre dans une espèce de brouillard qui était comme des feuilles de ouate sale, posées les unes devant les autres, avec des poches d’air dans l’intervalle, qui étaient comme les pages d’un livre réunies en haut par la reliure et qui dans le bas s’écarteraient. »
Le vieux Rhône « marmonne », « raconte son histoire ». La fontaine reprend son « bavardage ». L’eau, depuis la fissure qu’elle creuse dans la paroi rocheuse, fait entendre « une espèce de long soupir ». Le verrou rouillé qu’on tire « jette un grand cri comme quand on saigne le cochon ». « L’eau, resserrée entre les berges, est comme beaucoup de têtes et d’épaules qui se poussent les unes les autres en avant pour aller plus vite. Avec de grands cris, des rires, des voix qui s’appellent; comme quand les enfants sortent de l’école et la porte est trop étroite pour les laisser passer tous à la fois. » C’est une parole étrangère, antérieure, inhumaine – et pourtant familière. Derrière le romancier Ramuz, il y a l’inspiration d’un poète.
Un poète à la langue âpre cependant, comme je l’écrivais plus haut. Le style de l’écrivain, avec ses phrases heurtées, ses répétitions, ses rythmes presque oraux, épouse cette tension: dire l’indicible, les grondements et les silences de la nature, approcher le mystère, dans une langue qui tâtonne mais qui vibre, à l’unisson de la voix des montagnards qui habitent ces hauteurs. Cette langue poétique, souvent âpre, dont les subtilités se découvrent au cours de la lecture demande qu’on prenne le temps d’entrer dans les romans de Ramuz. Souvent les premières pages sont déroutantes. Mais quelles merveilles ensuite! Comme le rocher, la langue de Ramuz est portée par quelque chose de minéral. D’où sort aussi la vie, à l’image de la tête d’Antoine émergeant des grands blocs abattus sur l’alpage de Derborence, au centre du roman.
« On a calculé plus tard que l’éboulement avait été de plus de cent cinquante millions de pieds cubes ; ça fait du bruit, cent cinquante millions de pieds cubes, quand ça vient en bas. Ça avait fait un grand bruit et il avait été entendu de toute la vallée, qui a pourtant d’une à deux lieues de large et au moins quinze de long. Seulement on n’avait pas su tout de suite ce que ce bruit signifiait.
Maintenant on allait le savoir, parce que la nouvelle allait, allant très vite, bien qu’il n’y eût alors ni télégraphe, ni téléphone, ni automobiles. C’est bientôt dit. On dit : «C’est la montagne qui est tombée.»
La nouvelle était arrivée presque aussi promptement à Premier qu’à Aïre, à cause du petit Dsozet. Il était debout à côté de la fontaine, pendant qu’on lui lavait le sang qu’il avait sur la figure ; et, sortant de sa bouche, la nouvelle a couru de maison en maison.
Ça bouge toujours blanc et brillant au-dessus de vous dans le ciel qui est un peu recourbé et s’abaisse à votre rencontre comme la voûte d’une cave : là-dessous la nouvelle s’avance.
Elle a suivi d’abord le chemin, puis elle a quitté le chemin.
Un homme, qui est en train de réparer le bisse, lève la tête : « Qu’est-ce que c’est ? » — « C’est la montagne… » — « Quelle montagne ? »
Et alors les lézards, qui se chauffent au soleil, allongés dans la pierraille, rentrent se cacher dans leur trou.
« Derborence… »
La nouvelle passe et va plus loin, s’acheminant vers la grande vallée qui se creuse là tout à coup, de deux couleurs entre les pins ; la nouvelle dégringole à travers la côte raide et les vignes jusqu’au Rhône qui vous frappe soudain en pleine figure avec son feu blanc.
Là, il y a une bourgade, où un médecin monte à cheval vers les 11 heures, ayant fixé derrière lui à sa selle la sacoche où sont ses instruments.
Et, avant midi, la nouvelle arrive au chef-lieu où est le gouvernement, faisant un grand tumulte de voix dans les cafés. On y boit le joli muscat du pays :
— Derborence !
Un vin presque brun tant il est doré ; un vin qui est chaud sous le palais avec un goût râpeux, tandis que son parfum vous monte dans le nez en arrière de la bouche.
On disait :
— Il paraît qu’il n’en reste pas un !
— Et les bêtes ?
— Pas une ! »Charles Ferdinand RAMUZ, Derborence (1934), 1re partie, chapitre 7
Escapades en Europe – juillet 25: La grande traversée des Alpes
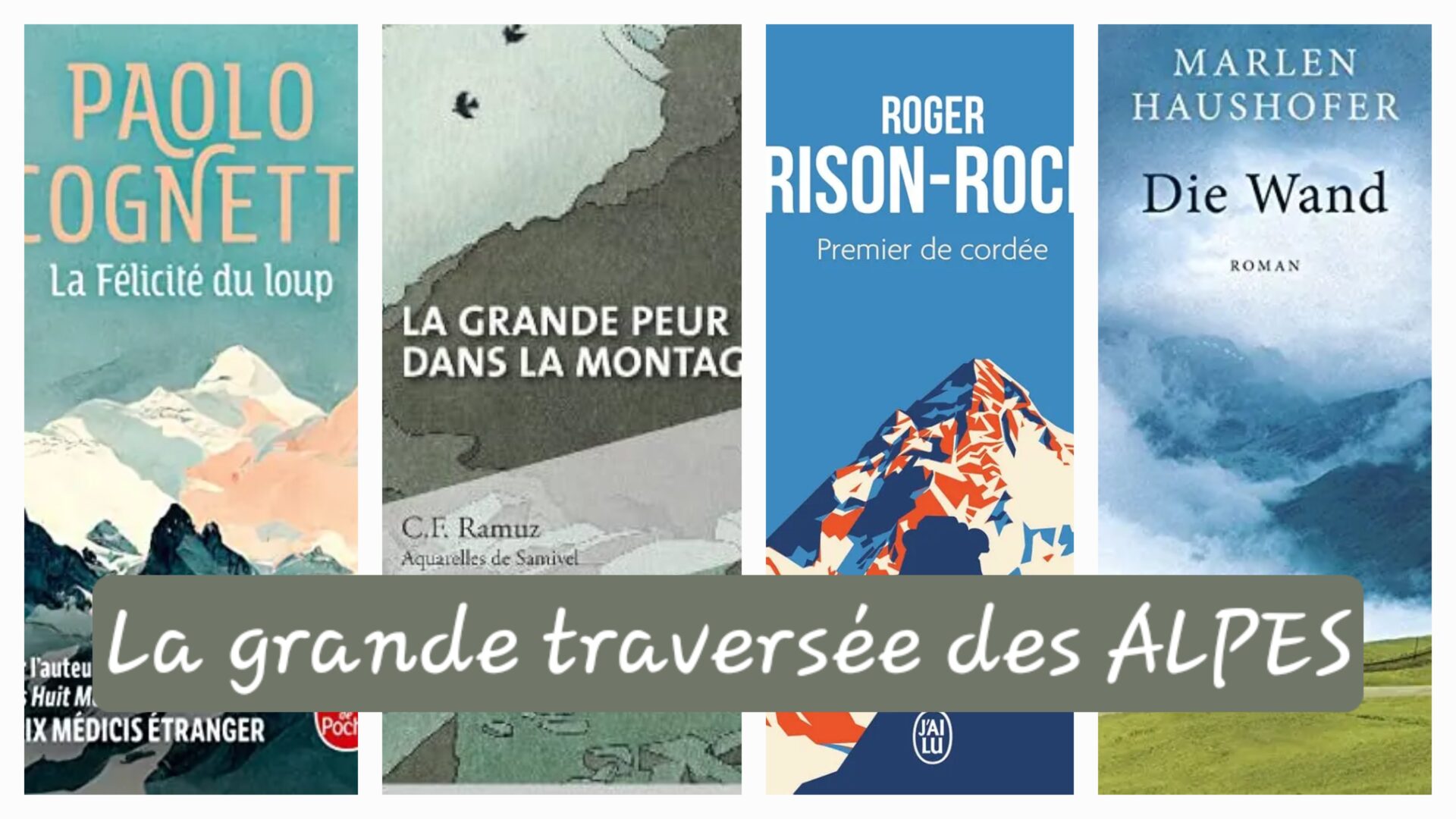
Les autres participants:
Vero a lu Le garçon sauvage – Paolo Cognetti
Nathalie a lu Requiem pour un alpiniste – Mario Rigini Stern
Je lis, je blogue a lu Premier de cordée – Roger Frison-Roche
Ingannmic a lu La Neige en deuil – Henri Troyat
Patrice a lu Jours à Leontica – Fabio Andina
Tullia a lu Die Wand (Le Mur invisible) – Marlen Haushofer
Tadloiducine a lu Voyage dans les Alpes – Alexandre Dumas
Sacha a lu Escarpées – Martine Mauris
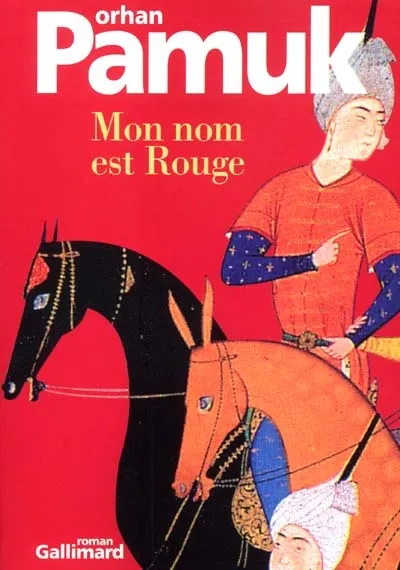
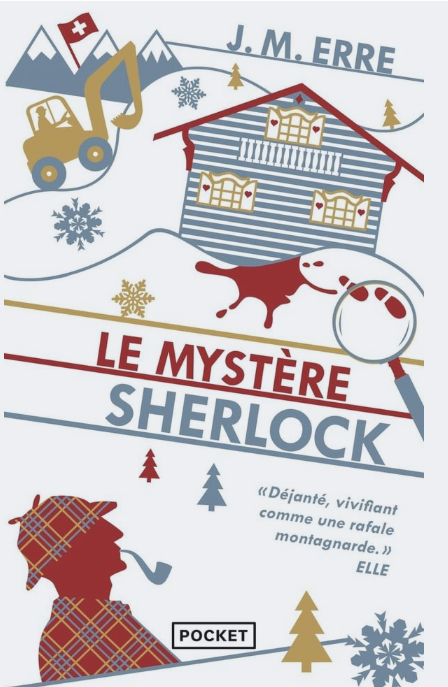
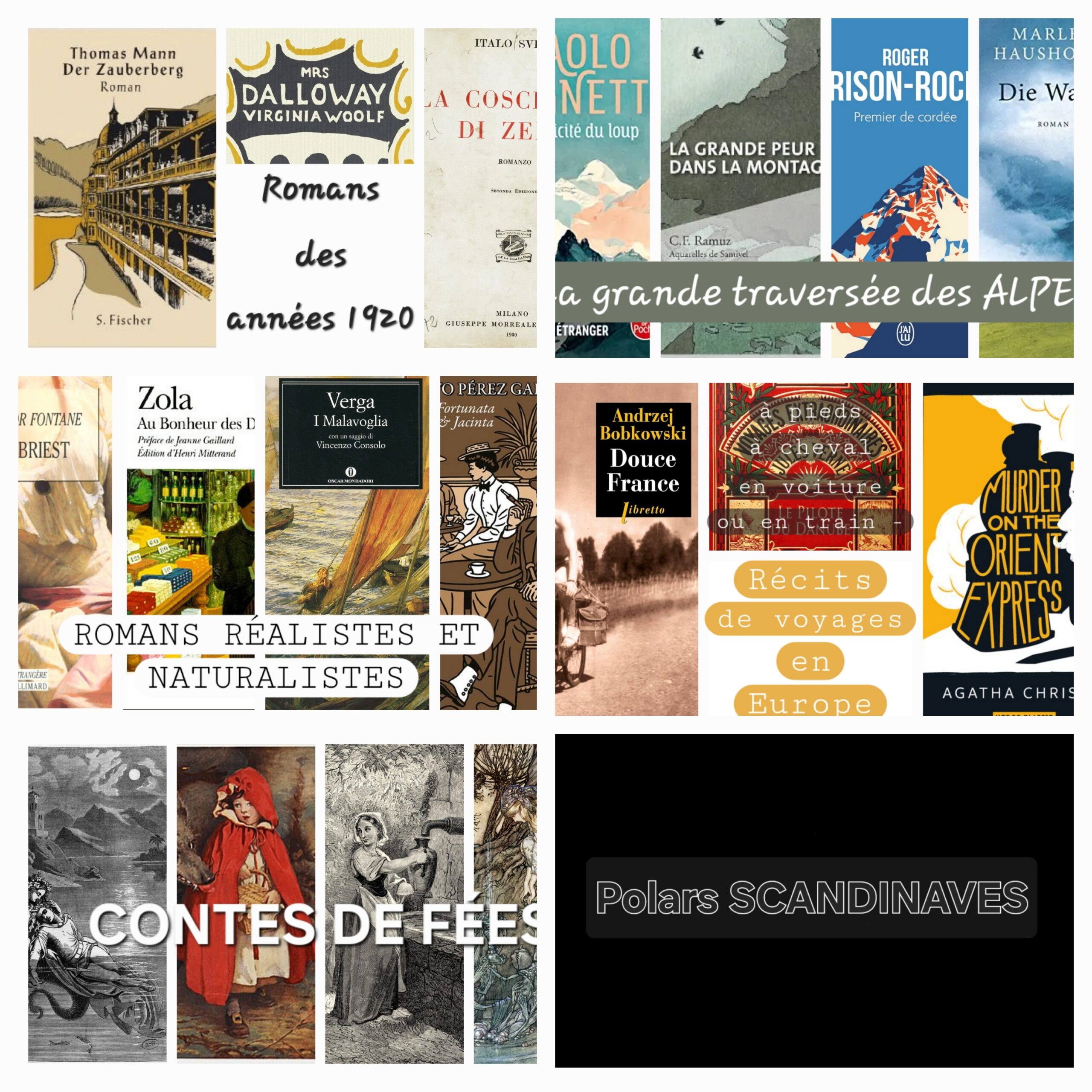
10 commentaires
Sacha · 15 juillet 2025 à 15 h 04 min
Voilà qui me fait regretter de ne pas m’être lancée avec Ramuz. J’ai lu ici et là des commentaires le rapprochant de Pagnol, ce qui m’a dissuadée…
Voici ma participation pour cette escapade alpine :
https://des-romans-mais-pas-seulement.fr/romans/escarpees-marlene-mauris/
Cléanthe · 15 juillet 2025 à 21 h 18 min
Merci pour ta participation!
Non, rien à voir avec Pagnol. On peut à la rigueur rapprocher Ramuz de Giono, en tout cas le romancier suisse a eu une certaine influence sur le romancier de haute Provence, mais à y regarder de près, ce sont deux univers différents.
Nathalie · 15 juillet 2025 à 20 h 33 min
Ah merci de mettre ce titre en avant. Je vais le noter, pour commencer avec l’auteur.
Cléanthe · 15 juillet 2025 à 21 h 14 min
Avec La Grande peur de la montagne, c’est un des sommets de l’œuvre selon moi. Mais l’œuvre de Ramuz est très riche: d’autres romans tirent plus vers le réalisme, voire une forme de naturalisme (Aline), d’autres encore sont centrés sur l’arc lémanique, un tout autre monde que celui des vallées reculées du Valais. Bon, tu auras compris… j’adore!
je lis je blogue · 16 juillet 2025 à 6 h 34 min
J’avais d’abord prévu de lire La grande peur dans la montagne mais j’ai lu récemment des commentaires sur des blogs qui m’ont refroidie: ce style âpre dont tu parles justement me fait peur.
Cléanthe · 17 juillet 2025 à 15 h 13 min
Ramuz ne plaît pas à tout le monde. Je crois que nous avons lu récemment les mêmes billets. Mais cela vaut le coup de tenter l’expérience. Apres, tu ne seras peut-être pas conquise. Personnellement, j’adore!
tadloiducine · 16 juillet 2025 à 9 h 22 min
J’ai lu quelques Ramuz voici quelques décennies… (une de mes copines devait faire sa Maîtrise de lettres sur lui, restée inachevée je crois bien).
Je crois me souvenir que son style est… difficile d’accès (et pas seulement quand il écrit sur les hautes montagnes!).
(s) ta d loi du cine, « squatter » chez dasola
Cléanthe · 17 juillet 2025 à 15 h 16 min
Quand on aime la Suisse, et le parler romand du lac jusqu’aux montagnes, je trouve que cela passe très bien. Mais, je te suis, il y a quelque chose d’un peu déstabilisant dans la langue de Ramuz.
Violette · 17 juillet 2025 à 10 h 38 min
Un très beau billet tentateur surtout que je n’ai jamais lu cet auteur (mais pourquoi donc, je me le demande…)
Cléanthe · 17 juillet 2025 à 15 h 23 min
Ramuz n’est plus beaucoup lu… mais c’est un auteur qui vaut vraiment la découverte.