Relire « Noces à Tipasa »
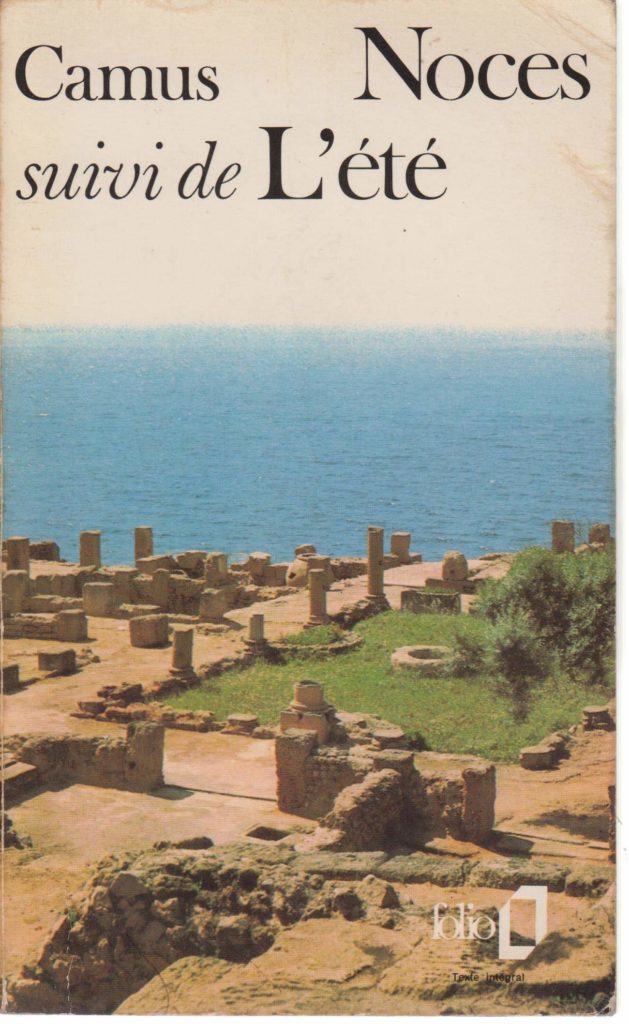
Lire et relire un texte. Ceux qui fréquentent régulièrement mon blog savent que c’est une de mes préoccupations récurrentes: ces lectures différentes qu’ont fait à plusieurs années de distance d’un même texte. Simple miroir de notre évolution personnelle? Ou plus sérieusement révélation de ces multiples niveaux de lecture d’un grand texte qu’il faut toute une vie pour pouvoir déployer – et une seule vie peut-être n’y suffit pas?
Je relis en ce moment Noces de Camus. Et quelques pages à peine après le début du premier texte, le magnifique Noces à Tipasa, vrai chant de la réconciliation de l’homme avec le monde, mon regard soudain bute sur un groupe de phrases, qui m’avaient déjà beaucoup touchées il y a une vingtaine d’années, lors de ma première lecture. Un texte que je trouve toujours très beau, aussi bien dans sa forme que dans ses ambitions philosophiques, mais enfin autrement, avec cette pointe de gravité avec laquelle on regarde les ambitions de la jeunesse, qu’on sait trop idéalistes, et pourtant toujours magnifiques et auxquelles on voudrait pouvoir continuer à adhérer sans réserve, même si on sait que la vie est un peu plus difficile que les plans qu’on en faisait.
Vers le soir, je regagnais une partie du parc plus ordonnée, arrangée en jardin, au bord de la route nationale. Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l’air maintenant rafraîchi par le soir, l’esprit s’y calmait, le corps détendu goûtait le silence intérieur qui nait de l’amour satisfait. Je m’étais assis sur un banc. Je regardais la campagne s’arrondir avec le jour. J’étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits poings fermés qui contiendraient tout l’espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi et j’en percevais seulement le parfum d’alcool. Des collines s’encadraient entre les arbres et, plus loin encore, un liséré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J’avais au cœur une joie étrange, celle-là
Albert CAMUS, Noces, Gallimard.
même qui naît d’une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu’ils ont conscience d’avoir bien rempli leur rôle, c’est-à-dire, au sens le plus précis, d’avoir fait coincider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu’ils incarnent, d’être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l’avance et qu’ils ont d’un coup fait vivre et battre avec leur propre coeur. C’était précisément cela que je ressentais: j’avais bien joué mon rôle. J’avais fait mon métier d’homme et d’avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l’accomplissement ému d’une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d’être heureux.
Je ne peux pas m’empêcher de me dire aujourd’hui que ce sont là les paroles d’un jeune homme. Et cela fait réfléchir. Serais-je devenu incapable de cette jeunesse, et de l’ambition, de l’abandon qu’elle comporte? Je ne crois pas. Je dirais même que nous avons besoin de cette jeunesse. Car il est bon de se rappeler à tout âge que notre aspiration au bonheur et la capacité à jouir des plaisirs simples de l’existence n’est pas perdre sa vie en dépenses futiles, mais bien au contraire la gagner, c’est-à-dire la vivre, intégralement, réconcilié avec le réel, contre tous les malheurs du monde.
Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans ce texte, et que je n’avais pas vu bien sûr à 28 ans. J’avais à l’époque pour ainsi dire l’âge de l’auteur. Et nous coïncidions dans notre vision du monde. Mais il manque quelque chose au jeune lecteur instruit de 28 ans que j’étais, au jeune homme de 26 ans, que fut le Camus magnifique des Noces à Tipasa: ce quelque chose qui leur manque, et menace de faire tomber tout leur système, c’est le sens tragique de l’Histoire.
La jeunesse ambitieuse, mais aussi un peu inconsciente comme l’est toute jeunesse -vertu sublime de la jeunesse: cette capacité à négliger le futur!- oublie que les malheurs du monde ne résultent pas seulement de notre defaut de volonté à nous réconcilier avec lui, d’un manque de légèreté ou d’un goût instinctif pour le malheur, mais d’un travail de sape tout intérieur à chacun de nous, ou à nos relations entre nous, qui amène bien souvent l’Histoire à se développer contre les ambitions de ceux qui la font, artisans inconscients de leur propre misère. Qui a un peu vécu sait combien de malheurs nous découvrons jour après jour par aspiration même au bonheur. Et contre cela nous ne pouvons rien!
La vraie conquête donc, c’est celle qui apparaît en tout cas à l’homme de 48 ans, presque 49 ans que je suis aujourd’hui, et qui ne s’est jamais senti aussi jeune dans ses ambitions, mais d’une jeunesse différente, plus mûre, moins naïve, n’est pas de savoir jouir pour épouser le monde, même si ça en est la manifestation extérieure. Mais de savoir rester suffisamment insensible au travail de sape de la fatalité. De continuer à affirmer, dans le plaisir des choses fragiles, par le témoignage de notre vie, notre droit au bonheur. Car peut-être n’y a-t-il pas de plus grande conquête et finalement de meilleure fidélité à ses idéaux de jeunesse que cette capacité qu’on acquière, quand on a un peu vécu, non de jouir naïvement des noces avec le monde, mais d’aborder les joies de l’existence avec la conscience de celui qui sait que ce plaisir peut lui être à tout moment retiré.
Plaisir jamais égoïste donc, conscient de sa fragilité, réconcilié avec cette fragilité même, cette précarité du jouir, que le plaisir, dans l’arrogance de la jouissance qui l’accompagne, fait mine de négliger. Plaisir de nos faiblesses peut-être, de notre fragilité, ou de notre précarité qui devrait être le principe d’une véritable éthique du bonheur.
Armé de cette sentence, je relis Noces de Camus. Et y prends un plaisir immense, mais différent, renouvelé de celui que j’y avais pris il y a maintenant 20 ans. J’apprends à débusquer dans le texte plein de promesses d’un jeune et déjà grand écrivain d’une vingtaine d’années une fragilité à fleur de mots, les traces d’une précarité de notre rapport à l’existence, dont je ne sais pas si l’auteur en était bien conscient lui-même, mais qui sont cependant l’une des beauté de ce texte, dont je reparlerai bientot dans mon billet sur le magnifique livre de Camus.
6 commentaires
Tania · 22 juillet 2019 à 17 h 39 min
Très beau billet sur vos impressions de relecture et sur ce défi du bonheur dont les conditions évoluent au fil du temps vécu. Merci, Cléanthe. Je vais lire maintenant ce que vous avez écrit sur Redon.
Cléanthe · 23 juillet 2019 à 9 h 36 min
Cette question de la relecture me passionne de plus en plus à mesure que les années passent. Les différentes impressions d’un texte, tout ce miroitement du texte au reflet des expériences de la vie…
nathalie · 23 juillet 2019 à 6 h 23 min
Mais quel beau billet ! Je crois avoir lu les Noces en un temps très lointain. Je l’ai racheté, pour le relire.
Petite et grande fragilité de l’être humain…
Cléanthe · 23 juillet 2019 à 9 h 39 min
Je serais curieux de lire tes impressions de relecture…
Dominique · 30 juillet 2019 à 10 h 23 min
Relecture pour moi aussi que j’avais mis à mon programme d’été mais pas encore faite, du coup je vais être très attentive à mes impressions, je crois que je ressens encore les impressions tactiles et les parfums de ma première lecture
on verra
j’aime beaucoup ton billet, j’ai souvent l’envie et la crainte à la fois de relire, en dehors d’ultra classiques comme TolstoÏ ou Proust, pour les autres je redoute toujours un brin d’ennui, une petite déception
Cléanthe · 4 août 2019 à 17 h 59 min
La relecture, je trouve, est un exercice passionnant. A chaque fois, c’est comme un nouveau texte qu’on découvre. J’attends en tout cas avec impatience tes impressions de relecture sur Camus.