Ödön von HORVÁTH: Un fils de notre temps
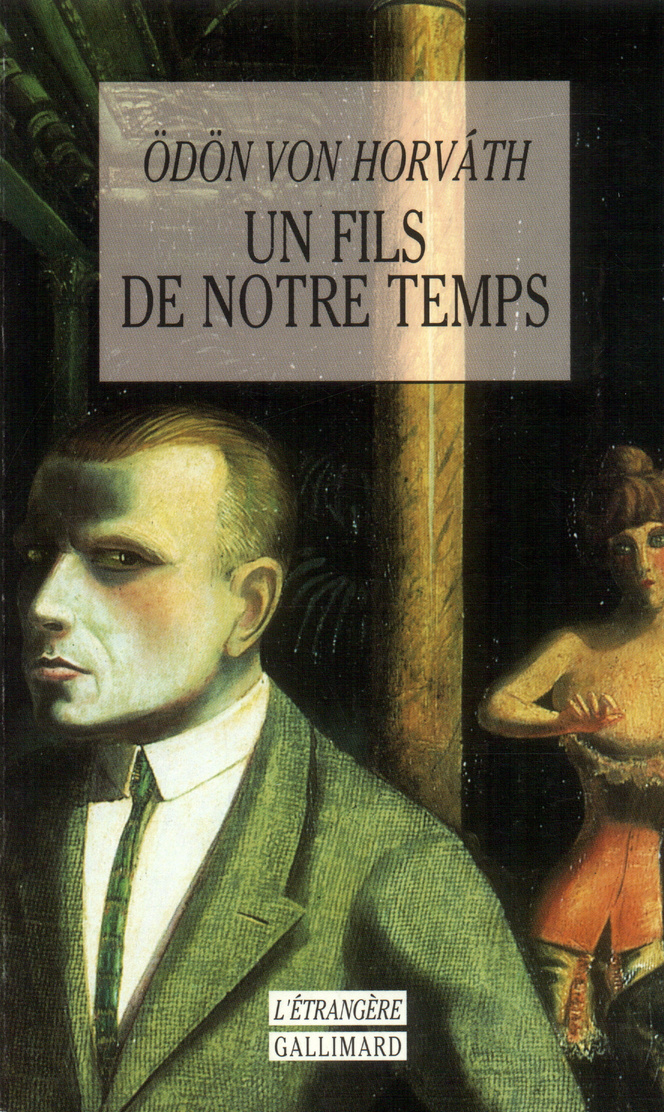
Un jeune homme au chômage, sans repères, trouve dans l’armée et l’idéologie une identité de substitution. Devenu soldat, il répète mécaniquement les slogans qu’on lui a inculqués, se coupe de son père marqué par la Grande Guerre, et s’engage dans une spirale de violence dont il ne pourra s’échapper. Un soir de permission, son regard rencontre celui d’une jeune femme, qui, à la fête foraine, tient le stand de la maison hantée. Mais la troupe est bientôt envoyée à la conquête d’un Etat riverain et hanter de sa violence les terres convoitées. Ainsi se poursuit le récit d’une conscience confisquée, ce fils de notre temps confronté à la séduction totalitaire…
Ödön von Horváth est un auteur aussi peu connu qu’important, dont j’ai déjà pu apprécier le roman Jeunesse sans dieu: le récit d’un professeur, contraint d’enseigner dans une Allemagne gagnée par le nazisme, qui observe l’endoctrinement de ses élèves, voit leur langage, leurs pensées et leurs gestes contaminés par la propagande raciste et nationaliste et finit par assister à la dérive violente jusqu’au meurtre de cette jeunesse embrigadée. J’avais aussi fort apprécié certaines de ses pièces, vues au Festival d’Avignon, Don Juan revient de guerre notamment – une oeuvre théâtrale qui, en dépit de la mort précoce et imbécile de son auteur (Horváth, après avoir fui deux fois le régime nazi, en 1933, puis en 1938, mourra bêtement écrasé par un arbre tombé sur le trottoir parisien un soir de tempête, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Robert Siodmak en Amérique), peut être considérée à l’égal de celle de Brecht. On ne lit plus beaucoup celui-ci non plus, à tort me semble-t-il. Mais je reparlerai de Brecht d’ici quelques jours, dans un prochain billet.
Publié en 1938, peu après la mort prématurée de son auteur, Un fils de notre temps est un roman bref, sec, implacable. Le narrateur, jeune chômeur désœuvré dans un pays en crise, trouve dans l’armée et l’idéologie une réponse à son vide existentiel. Allemagne et nazisme ne sont jamais nommés, cependant le lecteur comprend très bien qu’il s’agit de cela. Mais par cette omission de référence explicite, le texte d’Horváth acquière une universalité qui, tout en se nourissant de l’expérience historique de l’auteur, porte au-delà la reflexion sur le totalitarisme. Dès les premières pages, la voix du narrateur est saturée par le verbiage totalitaire : il n’a plus de langage personnel, mais parle la langue de la propagande. Les mots d’ordre – « nettoyer », « purifier », « servir » – remplacent toute pensée critique. Horváth montre ainsi comment le totalitarisme s’empare des consciences, les prive de leur singularité, impose une vision du monde sectaire et manichéenne. À cette logique de guerre permanente s’oppose l’expérience tragique du père, rescapé de 1914-1918, mais à laquelle le fils demeure insensible.
Dans son roman, Horváth insère cependant d’autres voix, rapportées par le narrateur lui-même : la lettre du capitaine, pleine de doute et d’humanité, ou encore les propos de la religieuse, marqués par la charité. L’ironie est mordante : c’est le narrateur, incapable de comprendre ces scrupules humanistes, qui rapporte leurs paroles, les filtrant malgré lui à travers son idéologie brutale. Le lecteur perçoit alors l’écart abyssal entre la voix de la propagande et la survivance obstinée d’un langage de compassion.
Progressivement, le narrateur traverse cependant des épreuves qui fissurent son aveuglement. Pourtant, même cette prise de conscience reste incomplète : la violence qu’il a intégrée, le culte de la force que le régime a inscrit en lui, ne lui laissent aucune échappée. La trajectoire s’achève dans un meurtre, comme si le lavage de cerveau initial avait définitivement condamné le personnage à reproduire la logique totalitaire.
Les dernières phrases du roman sont d’une intensité rare. Horváth y condense l’échec d’une vie et, au-delà, celui d’une génération embrigadée. L’effet produit est double : d’un côté, la sécheresse du style restitue l’implacable mécanisme d’un destin qui s’achève sans rédemption ; de l’autre, la beauté tragique de cette chute confère au texte une puissance poétique qui dépasse la simple chronique politique. Horváth montre qu’au cœur même de la langue confisquée par le totalitarisme, la littérature peut encore frapper, éveiller, secouer.
Un fils de notre temps n’est donc pas seulement un témoignage littéraire sur la montée du nazisme. C’est une œuvre majeure, plus réussie encore que Jeunesse sans dieu, qui continue d’interroger sur la fragilité des consciences et sur la facilité avec laquelle une idéologie peut coloniser la parole et la pensée. Du très très grand art, d’autant plus nécessaire en ces temps de tempête que nous traversons de nouveau depuis quelques temps.
« Avait-il raison d’être dégoûté par sa patrie? me demandé-je. Oui ou non?
D’accord, c’était une crapule – mais avait-il raison?
Est-ce qu’une crapule peut avoir raison?
Comme, par exemple, la fois où nous regardions nos aviateurs écraser de leurs bombes l’hôpital ennemi et mitrailler les fuyards qui se tortillaient sous les balles: le capitaine fit brusquement demi-tour et se mit à faire les cent pas derrière nos rangs.
Il gardait les yeux rivés à terre, comme s’il était perdu au fond de ses pensées.
Par instant seulement, il s’immobilisait et contemplait le calme de la forêt. Pui il hochait la tête, comme pour dire: « Oui, oui… »
Ou, par exemple, lorsque nous réquisitionnions dans ce village et qu’il nous a barré le chemin. Il est devenu blanc comme un linge et nous a crié qu’un soldat digne de ce nom ne pillait pas! Il a fallu que ce soit notre sous-lieutenant, ce jeune chien, qui lui explique que le pillage était non seulement autorisé, mais qu’il avait même été recommandé. En haut lieu.
Alors, il s’éloigna de nous, le capitaine. »
Ödön von Horváth, Un fils de notre temps (1938), traduction: Remy Lambrechts, L’étrangère/Gallimard
Publié (avec quelques heures d’avance!, autres LC obligent) dans le cadre d’une lecture commune proposée en hommage à Goran.
Y ont participé : Ingannmic – Claudialucia – Patrice – La Bouche à Oreille – Alex – Anne-yes – Passage à l’Est! – Madame lit

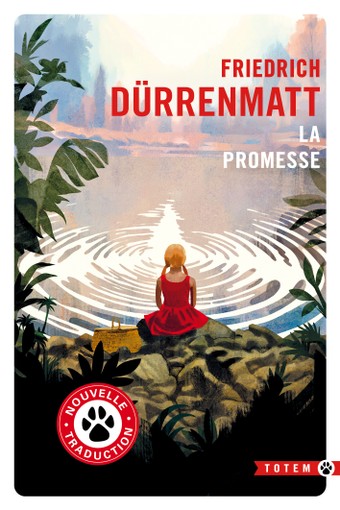
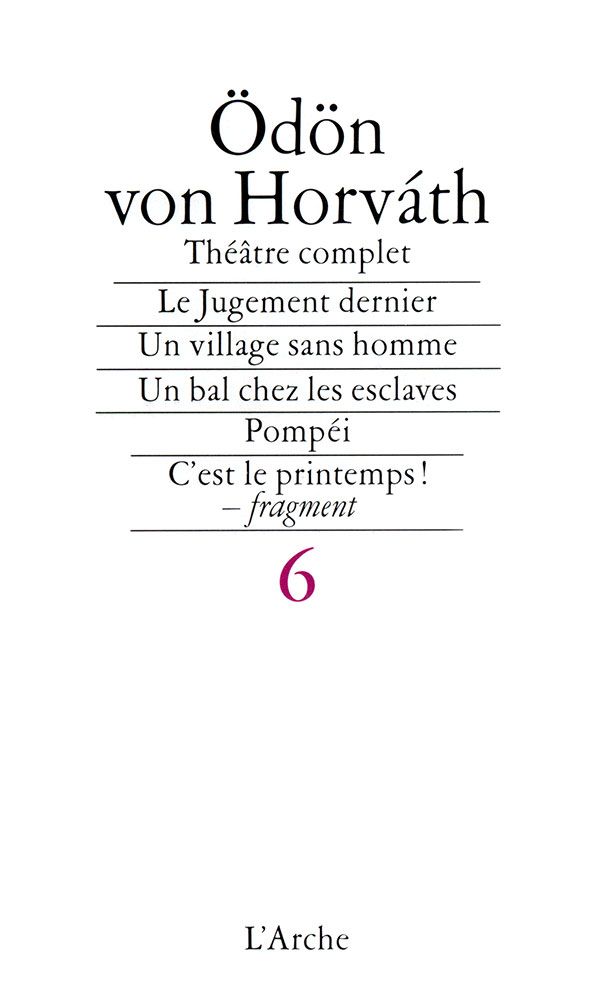
12 commentaires
Patrice · 15 septembre 2025 à 8 h 12 min
Je suis très heureux que tu aies pu te joindre à cette LC, et encore plus de lire ton enthousiasme pour ce livre qui le mérite tout à fait. En effet, il a un caractère universel et cela fait froid dans le dos de voir à quel point une idéologie peut prendre possession d’un homme qui n’est pourtant ni idiot ni mauvais.
Cléanthe · 15 septembre 2025 à 18 h 10 min
Ödön von Horvath est un auteur que j’ai rencontré il y a quelques années et que j’apprécie tout particulièrement. D’ailleurs, je partage beaucoup d’enthousiasmes communs avec le top100 de Goran. Ça a été l’occasion de retrouver cet auteur, et de continuer à faire vivre le souvenir d’un blogueur que beaucoup d’entre nous ont apprécié.
Le caractère universel du propos d’Horvath est ce qui m’a frappé d’emblée. Bien sûr, le roman se nourrit de son expérience du nazisme, mais l’absence de référence explicite à l’Allemagne donne au propos une force qui dépasse telle ou telle situation historique, même si il s’en nourrit. Et il faut bien reconnaître, hélas, le charme qu’une certaine logorrhée agressive continue (recommence?) à exercer sur les esprits jusqu’à l’époque contemporaine.
Sacha · 15 septembre 2025 à 8 h 13 min
Oui, l’actualité de la rentrée bloguesque est chargée, même lorsqu’elle est loin de la rentrée littéraire des éditeurs ! Bien que bref, Un fils de notre temps réussit visiblement à laisser une impression durable en analysant en profondeur les racines du mal. Je le note !
Cléanthe · 15 septembre 2025 à 18 h 12 min
C’est un très grand livre. Comme toute l’oeuvre d’Horvath d’ailleurs, un auteur qu’on gagne à redécouvrir.
Ingannmic · 15 septembre 2025 à 8 h 20 min
Un grand merci pour ta participation, pas évident de caser sur cette mi-septembre toutes les activités proposées !!
J’ai moi aussi apprécié ma lecture, c’est un texte court mais efficace et intense..
Cléanthe · 15 septembre 2025 à 18 h 13 min
Comme je le disais à Patrice plus haut, je ne pouvais pas râter ce rendez-vous: pour Ödön von Horvath, un auteur que j’apprécie tout particulièrement, et pour maintenir le souvenir de Goran.
Anne-yes · 15 septembre 2025 à 9 h 03 min
L’auteur a bien analysé l’emprise de l’idéologie nazie sur le personnage et son avertissement reste d’actualité.
Cléanthe · 15 septembre 2025 à 18 h 16 min
Oui, et en même temps, en ne nommant pas le nazisme, il produit un texte universel sur le totalitarisme.
je lis je blogue · 15 septembre 2025 à 17 h 36 min
Ce livre vaut très certainement le détour mais je n’ai pas trop la tête à ça pour l’instant. Je le garde dans un coin de mon cerveau.
Cléanthe · 15 septembre 2025 à 18 h 18 min
Le sujet n’est pas trop facile en effet, mais c’est un très grand livre.
claudialucia · 15 septembre 2025 à 22 h 24 min
Tu as vu une pièce de lui au Festival ! Intéressant, je pensais qu’il n’était pas connu comme auteur de théâtre. Bretch, je me souviens de l’avoir vu plusieurs fois mais il y a bien longtemps; il est de moins en moins sur scène. L’année dernière pourtant vu Le cercle de craie caucasien mais ce n’était pas au niveau !
Cléanthe · 16 septembre 2025 à 5 h 49 min
Je trouve son théâtre aussi fort que celui de Brecht, quoique dans un autre genre. Il est vrai que Brecht, lui aussi, n’est plus guère joué, ni lu. Ni même édité. J’ai voulu me procurer le théâtre complet des deux auteurs, je n’ai pu trouver les différents volumes que d’occasion – souvent d’anciens livres de bibliothèque. Mais j’en reparle d’ici quelques séjours ou semaines, en finissant de mettre à jour les billets consacrés à mes lectures de l’été.