KRASZNAHORKAI László: Petits travaux pour un palais

Bien sûr herman melvill, bibliothécaire obscur, n’a rien à voir avec Herman Melville, l’écrivain. Mais quand on vit à New-York, comme y a vécu le grand romancier auparavant, une telle homonymie finit par interpeller, au point de nourrir une véritable obsession, comme de suivre par exemple jour après jour l’itinéraire que l’auteur de Moby Dick faisait dans Manhattan pour se rendre sur son lieu de travail, ou accumuler compulsivement les biographies. Il faut dire que melvill est habitué à vivre parmi les livres. Bibliothécaire, il travaille depuis des décennies à la New York Public Library. Solitaire, obsessionnel, il nourrit un projet secret et démesuré: concevoir une bibliothèque absolue, un palais de la culture qui rassemblerait les œuvres essentielles de l’humanité, mais qui serait définitivement fermé au public. Un lieu parfait, soustrait à l’usure, au bruit du monde et à la profanation… Bienvenue dans le monde dérangé d’herman melvill!
Qu’il est difficile de résumer un tel livre! et même tout simplement d’en parler! sinon de dire que j’ai adoré cette lecture, effectuée, en une seule journée, presque d’une traite, à l’occasion d’un trajet en train. Un récit un peu fou (mais qu’attendre d’un tel fou, ce narrateur capable cependant de développements saisissants, d’éclats de lucidité?). Un texte de près de 120 pages courant le long d’une longue phrase continue, ou plutôt d’une période, serpentine, épousant les circonvolutions de l’esprit pour le moins dérangé d’herman melvill. Obsédé par la connexion de l’homme avec la terre, par l’affaissement de l’arche interne du pied dont il souffre (à ne pas confondre avec les pieds plats!), par la conservation des livres, au point de vouloir les soustraire au public, celui-ci se met en quête d’un sens dans les dédales de Manhattan, mais son projet n’est pas un simple inventaire ou une enquête traditionnelle: il s’agit d’une entreprise littéraire et métaphysique. Dans ce court roman tenu d’une longue phrase continue, le narrateur s’embarque dans un monologue obsessionnel où ses pas dans New York croisent sans cesse les ombres d’Herman Melville, de Malcolm Lowry, de Bela Bartok et de l’architecte Lebbeus Woods — autant de figures qui nourrissent sa réflexion sur l’art, l’architecture et la catastrophe.
Son projet impossible – concevoir une bibliothèque idéale, fermée à jamais au public, où seraient rassemblés les livres les plus essentiels comme on enferme des reliques sacrées, une bibliothèque-palais, inaccessible – se veut à la fois monument, tombeau et Aleph littéraire: concentrer l’univers culturel tout en le soustrayant à toute interprétation ou usage. À mesure que le récit progresse, dans une phrase qui virevolte sans points pour respirer, la démarche de melvill devient une déambulation intérieure autant qu’extérieure: il arpente Manhattan, ressasse ses pensées, mêle l’ironie à la folie, la lucidité à la paranoïa, et finit par interroger la place de l’art, de l’écrivain et de la culture dans un monde saturé d’informations et de ruines.
Ce qui pourrait n’être qu’un soliloque névrotique se transforme ainsi en méditation sur la modernité: comment penser l’art et la bibliothèque à l’ère de la saturation des signes ? Car l’utopie défensive et paranoïaque de melvill, son soliloque révèlent en creux une angoisse moderne fondamentale: celle de l’effondrement. Le roman est traversé par l’idée que nous vivons après la catastrophe, ou à son seuil permanent. Les références architecturales, notamment à Lebbeus Woods, inscrivent la pensée de Melvill dans un monde de ruines, de structures instables, de villes prêtes à se fissurer. La modernité n’est plus un horizon de progrès, mais un régime de crise continue, où l’art ne peut plus prétendre édifier un ordre durable, seulement bricoler, réparer, maintenir provisoirement — d’où ces « petits travaux », dérisoires et nécessaires à la fois.
Cette vision du monde trouve son équivalent dans la forme narrative: la phrase interminable, sinueuse, sans véritable point d’arrêt, mime une pensée qui ne peut plus conclure, qui avance par reprises, par corrections, par ajouts incessants. Il n’y a plus de récit linéaire, plus de construction solide, mais un flux mental qui se débat avec ses propres limites. En cela, le roman m’a puissamment fait penser à Beckett. Une même obstination vaine, un même humour sombre, une même lucidité impitoyable face à l’impossibilité de finir, de dire définitivement, de bâtir quelque chose qui tienne. Comme chez Beckett, on continue pourtant — non par espoir, mais par fidélité à un geste, à une exigence intérieure.
Et c’est sans doute là que réside la force du texte. Petits travaux pour un palais ne propose ni solution ni consolation. Il met en scène une conscience moderne au travail, aux accents schopenhaueriens, enfermée dans la contradiction de vouloir encore croire à la valeur absolue de l’art tout en sachant que cette croyance est déjà fissurée. Roman de la fatigue culturelle, de l’épuisement des grands projets, il n’en est pas moins d’une intensité rare. À mes yeux, il atteint justement une puissance comparable à celle des grands romans de Beckett: une littérature de l’extrême lucidité, austère et ironique, qui ne promet rien — sinon la rigueur de continuer à penser, phrase après phrase, dans les décombres.
Bref un très grand livre! Et un immense écrivain que je découvre avec bonheur à l’occasion de cette lecture commune proposée par Nathalie.
« …nous devons admettre que la catastrophe est permanente et n’est pas dirigée contre nous, la catastrophe n’en a rien à foutre de nous, si nous croisons sa route, bien sûr, elle nous détruit, mais pour elle il ne s’agit pas de destruction, il n’y a pas de destruction, ou, pour dire les choses autrement, la destruction opère à chaque instant, et le message de Woods, si l’on comprends ce qu’il veut dire, est époustouflant, puisqu’il affirme que le mode de fonctionnement de l’univers repose intégralement sur la destruction et la dévastation, la ruine et la désolation, comment vous dire, il n’existe pas de dichotomie, il est absurde de parler de forces antagonistes, d’une réalité descriptible en termes de concepts complémentaires, parler de bien et de mal est une idiotie puisque tout est mal, ou rien ne l’est, la réalité ne peut être appréhendée que sous un seul angle, celui de la destruction perpétuelle, la réalité, c’est la catastrophe dans laquelle nous vivons, de la plus petite particule subatomique jusqu’à la plus grande unité à l’échelle planétaire, tout, vous m’entendez? et je ne m’adresse toujours à personne en particulier, tout ici, dans la dramaturgie de l’inévitable catastrophe joue à la fois le rôle de l’agresseur et de la victime… »
KRASZNAHORKAI László, Petits travaux pour un palais: Pénétrer la folie des autres (Aprómunka egy palotáért, 2018), traduction de Joëlle Dufeuilly, Editions Cambourakis
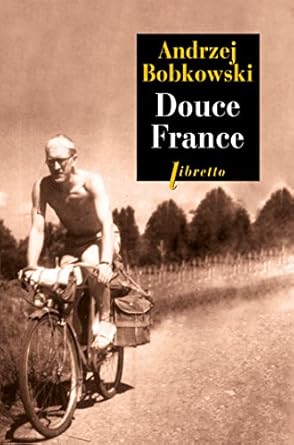
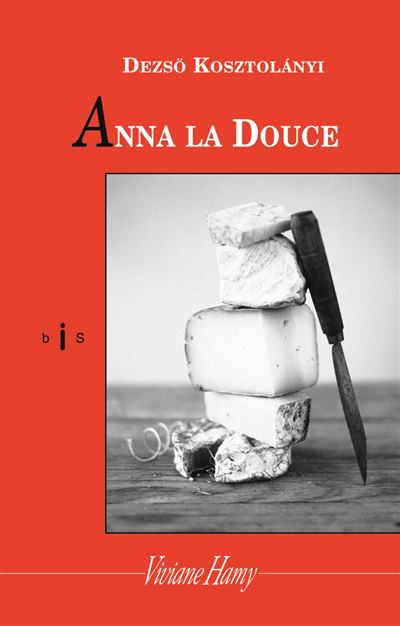
21 commentaires
keisha · 18 décembre 2025 à 7 h 34 min
Quel billet! Que je me réjouis! Je suis tombée dans la marmite avec la mélancolie de la résistance, et j’espère que tu continueras avec l’auteur! Chacune de mes lectures est un grand moment…
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 03 min
Je pense en effet que je ne vais pas tarder à poursuivre avec cet auteur.
Alexandra · 18 décembre 2025 à 9 h 26 min
J’arrive de chez Ingannmic et Nathalie. C’est bien que vous ayez choisi chacun un titre différent. Cela permet de se faire une idée de l’œuvre. En tout cas vous êtes unanimement séduits !
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 04 min
Ses livres ont l’air quand même assez différents. Cette lc donne en effet une bonne idée de la diversité de l’oeuvre.
Ingannmic · 18 décembre 2025 à 15 h 24 min
Et voilà, tu es tombé dans la marmite !
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 05 min
Et je ne suis pas prêt d’en ressortir!
nathalie · 18 décembre 2025 à 18 h 48 min
Je l’avais lu comme une plongée dans un truc, en apnée sans respirer… (en vrai, dans le fauteuil du jardin mais bref). Le livre est impressionnant dans sa progression, hyper maîtrisé tout cela. Je suis contente que tu aies aimé !
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 06 min
Une plongée en apnée, c’est bien cela. C’est ce qui m’a fait penser aux romans de Beckett justement.
Fanja · 18 décembre 2025 à 22 h 40 min
Comme je disais chez les autres, dommage j’ai raté cette LC dont j’aurais pu profiter pour découvrir l’auteur qui semble absolument valoir le détour. Ce roman-ci me tente particulièrement. Je me le note en projet 2026.
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 06 min
Je lirai avec plaisir ton billet. J’espère que tu sera séduite toi aussi.
Aifelle · 19 décembre 2025 à 6 h 40 min
Comme je le disais ailleurs, j’ai un autre livre de lui dans ma PAL « au nord par une montagne etc … ». Je n’en rajoute pas pour le moment.
Cléanthe · 19 décembre 2025 à 19 h 07 min
Je l’ai aussi. En fait, je me suis constitué une PAL Krasznahorkai déraisonnable. 🙂 Si cela te tente, pourquoi ne pas programmer une LC de ce titre un de ces jours?
Aifelle · 20 décembre 2025 à 7 h 02 min
Pourquoi pas oui, si ce n’est pas tout de suite. Début février pour moi ce serait bien.
Cléanthe · 20 décembre 2025 à 17 h 43 min
On pourrait dire le 20 fevrier?
Aifelle · 21 décembre 2025 à 6 h 42 min
Ça me va, je note et je fais suivre à Keisha qui voudrait se joindre à nous.
Cléanthe · 22 décembre 2025 à 20 h 51 min
Parfait!
keisha · 20 décembre 2025 à 7 h 53 min
Je suis pour une lc krasno saison 2 en 2026 !!!
Virginie Vertigo · 21 décembre 2025 à 22 h 20 min
Je viens juste de lire les billets sur cet auteur chez Ingannmic et Keisha. Je n’ai encore jamais lu cet auteur et j’ai dans ma bibliothèque « La mélancolie de la résistance ». Je me rends compte que ce livre semble aussi avoir tout pour me plaire. J’espère que sa prose me conviendra, je compte me lancer cet hiver.
Cléanthe · 22 décembre 2025 à 20 h 55 min
Si cela te tente, on a prévu une LC de « Au nord par une montagne etc. » pour le 20/02 avec Aifelle et Keisha.
Virginie Vertigo · 30 décembre 2025 à 9 h 45 min
Oui, Keisha m’en a parlé. Je vais sans aucun doute participer !
Cléanthe · 7 janvier 2026 à 15 h 59 min
Super! plus on est de fous… comme on dit.