George ELIOT: Les Tribulations du révérend Amos Barton
À Milby, un bourg anglais un peu terne, le révérend Amos Barton s’efforce de faire son devoir : prêcher, visiter les pauvres, ramener quelques âmes à la foi. Mais Amos est maladroit. Peu charismatique, mal vu de ses paroissiens, il prêche trop longuement, s’acharne sur des causes perdues, et ne comprend pas toujours les sensibilités qui l’entourent. Lorsque, par charité chrétienne autant que par naïveté, il accueille sous son toit l’élégante comtesse Czerlaski — une veuve un peu fantasque, un rien entêtante, et imbue d’elle-même — Amos croit bien faire. Mais très vite, les commérages enflent. On le soupçonne de complaisance, d’ambition mondaine, voire de lubricité. La présence de la comtesse suffit à fissurer l’image d’un clergyman déjà peu populaire. Et pendant ce temps, dans la maison du pasteur, sa femme s’épuise, s’efface, s’affaiblit…
Avec Les Tribulations du révérend Amos Barton (1857), l’un des trois récits réunis l’année suivante dans les Scènes de la vie de clergé, George Eliot faisait ses premiers pas en littérature. Après sa rupture avec le christianisme, Mary Ann Evans (nom de naissance de l’autrice) avait déjà traduit la Vie de Jésus d’Ernest Renan, commencé à écrire des articles pour le Conventry Herald, journal radical, ou dans la Westminster review, dont elle assuma quelques temps la charge de rédactrice en chef, publié une traduction de L’essence du christianisme de Ludwig Feuerbach. Mais Amos Barton est le premier récit de fiction publié par celle qui n’allait pas tarder à devenir la plus grande romancière anglaise du XIXème siècle.
Ce qui frappe d’emblée, dans cette longue nouvelle, conçue comme une sorte de court roman, c’est la voix singulière de l’autrice, ce mélange caractéristique d’attention aux petits gestes, aux petites passions, à la médiocrité des êtres qu’elle sait peindre d’une plume empathique et d’une ironie mordante. Une voix narrative qui ne cherche pas à séduire par l’intrigue, mais par une attention morale au réel. Pas de héros flamboyant donc ici, pas d’éclats — mais une narration profondément incarnée, où chaque détail (une remarque mondaine, une robe un peu usée, un silence gêné, un commérage) devient un indice d’existence. Eliot écrit comme on observe, longuement, sans impatience. Mais avec une plume qui est celle d’une autrice redoutablement intelligente, indépendante, et dont la liberté annonce par endroit celle de Virginia Woolf, qui, sur la voie de l’émancipation littéraire, lui doit tant. Nulle part mieux que dans les portraits qu’elle brosse des personnages n’éclate le génie satirique de l’autrice:
« Mr Pilgrim parlait généralement avec une espèce de tic intermittent. « Il est bien dommage, disait un de ses malades, qu’un homme aussi habile ait un empêchement dans son langage. » Mais quand il en venait à ce qu’il considérait comme le fort de son argumentation ou comme la pointe de sa plaisanterie, il maĉhait ses paroles lentement et avec emphase: de même, une poule annonçant qu’elle a pondu passe à intervalles irréguliers de simples notes pianissimo aux doubles croches fortissimo. »
Mr Berton « avait une manière de rire des critiques qui paraissait généralement offensante, et il montrait ainsi les restes d’une rangée de dents qui, semblables aux débris de la vieille garde, pour être peu nombreuses n’en étaient que plus fatiguées. »
« Mr Ely ne s’abandonnait jamais à la chaleur de la discussion; il suggérait aux autres ce qu’on devait penser et disait rarement ce qu’il pensait lui-même; il ne laissait voir à personne, homme ou femme, qu’il se moquait d’eux et ne donnait jamais à personne l’occasion de rire de lui. Il ne manquait de jugement qu’en une chose. Il séparait au milieu du front ses cheveux noirs et ondulés, et, comme sa tête était plutôt plate, ce genre de coiffure ne lui était pas avantageux. »
Pourtant, au-delà du mordant de quelques formules ( ah, la sublime « Il n’était pas dans sa nature d’être supérieur en quoi que ce fût, sauf peut-être en médiocrité » aux accents flaubertiens!), c’est aussi de la minutie d’une écriture réaliste, se détournant des facilités d’une littérature à effets, c’est de cette patience à décrire jusqu’aux gestes les plus communs, les petites médiocrités, les mesquineries villageoises, les frustrations et les aspirations, que naît l’émotion. Cette manière caractéristique d’approcher l’ordinaire avec précision et générosité est présente dès ce premier texte de fiction: un sourire mélancolique, presque imperceptible, qui naît du décalage entre ce que le personnage croit faire et ce que le lecteur perçoit. Amos se voit en pasteur dévoué ; les autres y voient un homme incompétent, entêté, peut-être compromis. Eliot n’humilie pas, elle montre. Et dans cet écart, il y a toute une éthique du regard : lucide, mais jamais cruel. Ainsi, lorsque survient la catastrophe, on est surpris de sentir, avec tout le village, dont l’opinion brusquement se retourne, combien ce petit homme obscur, un peu ridicule au départ, est devenu profondément touchant. Comme si, à force d’observer les failles, sans s’interdire le mordant que j’ai évoqué plus haut, George Eliot révélait une forme de grandeur invisible. Et nous rendait capable de compassion.
Au fond, c’est peut-être cela, la leçon d’Eliot : il n’y a pas de petits destins. Il n’y a que des vies qu’on regarde trop vite — ou pas assez.
« Le révérend Amos Barton, dont j’ai entrepris de vous raconter les épreuves, n’était à aucun égard, comme vous le voyez, un caractère idéal ou exceptionnel; et peut-être est-ce une chose hasardée que de vous demander votre sympathie en faveur d’un homme si peu remarquable, d’un homme dont les vertus n’étaient point héroïques, et qui ne gardait dans son cœur aucun tendre regret ; qui n’avait pas le plus léger mystère planant sur sa tête, qui était positivement et indubitablement ordinaire et qui n’était pas même amoureux, étant guéri de ce mal là depuis plusieurs années : « Un personnage n’offrant aucune espèce d’intérêt ! » s’écrira une de mes lectrices, Mrs Farthingale par exemple, qui veut l’idéal dans la fiction, pour qui le mot tragédie s’associe à des fourrures d’hermine, à l’adultère et au meurtre, et le mot comédie, aux aventures de quelques personnages qui offrent positivement un caractère.
Mais, chère Madame, il y a une si grande majorité de vos concitoyens qui présentent ces types insignifiants. Quatre-vingt pour cent parmi les Britanniques adultes comptés au dernier recensement ne sont ni extraordinairement niais ni extraordinairement méchants ni extraordinairement sages. Leurs yeux n’accusent pas de profondeur, le sentiment n’y met aucune limpidité, le bon mot à venir aucun scintillement. Nul d’entre eux n’a probablement raconté quelque évasions palpitante, quelque aventure terrifiante; leurs cerveaux ne sont point fécondés par le génie, et leurs passions n’ont pas fait
éruption comme un volcan. Ce sont seulement des hommes à conversation plus ou moins stérile et
décousue. Cependant ces gens bien ordinaires, beaucoup d’entre eux du moins, ont une conscience
et ont obéi à la sublime impulsion de quelques devoirs pénibles à remplir. Ils ont leur tristesse et leur joie ; leurs cœurs se sont élancés peut-être vers leur premier-né, il se peut qu’ils aient gémit sur
une mort violente. Bien plus, n’y a-t-il pas de l’éloquence dans leur insignifiance même, par la comparaison que nous faisons de leur obscur et étroite existence avec les possibilités glorieuses de
cette nature humaine dont il participe ? »George ELIOT, Les Tribulations du révérend Amos Barton (1857), traduction de François d’Albert-Durade, Editions sillages, pp.85-86
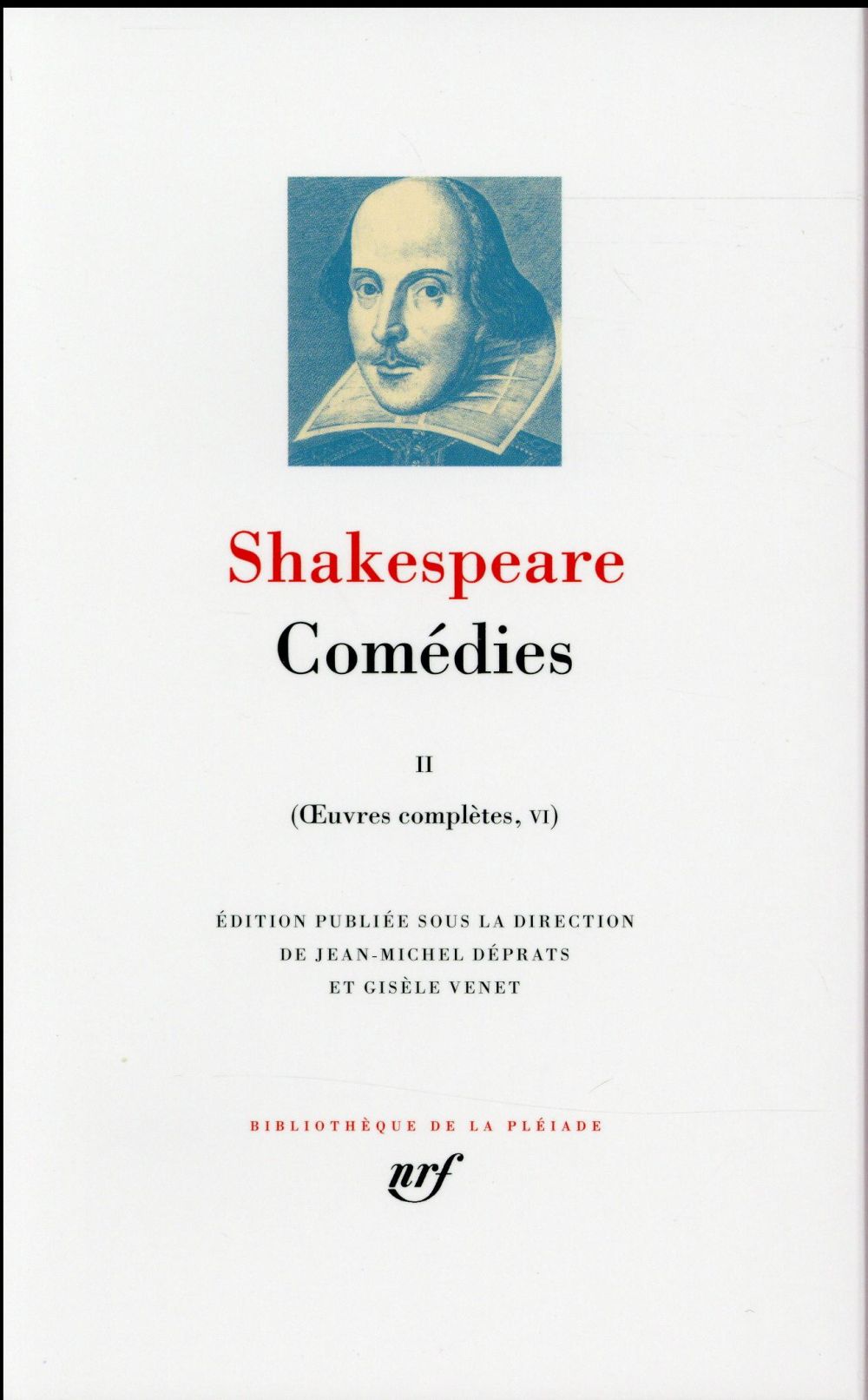
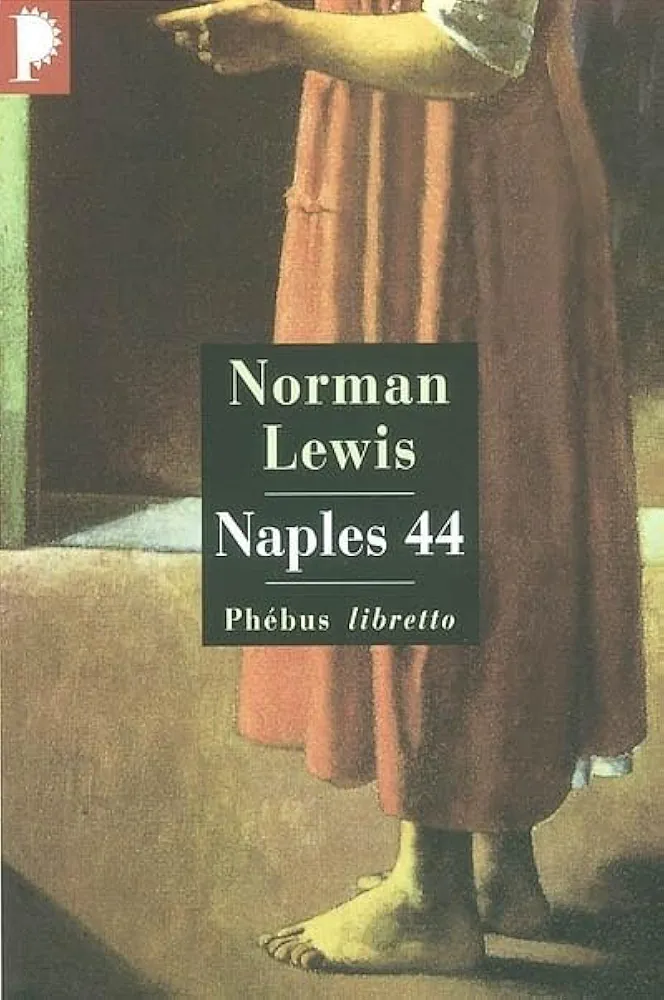
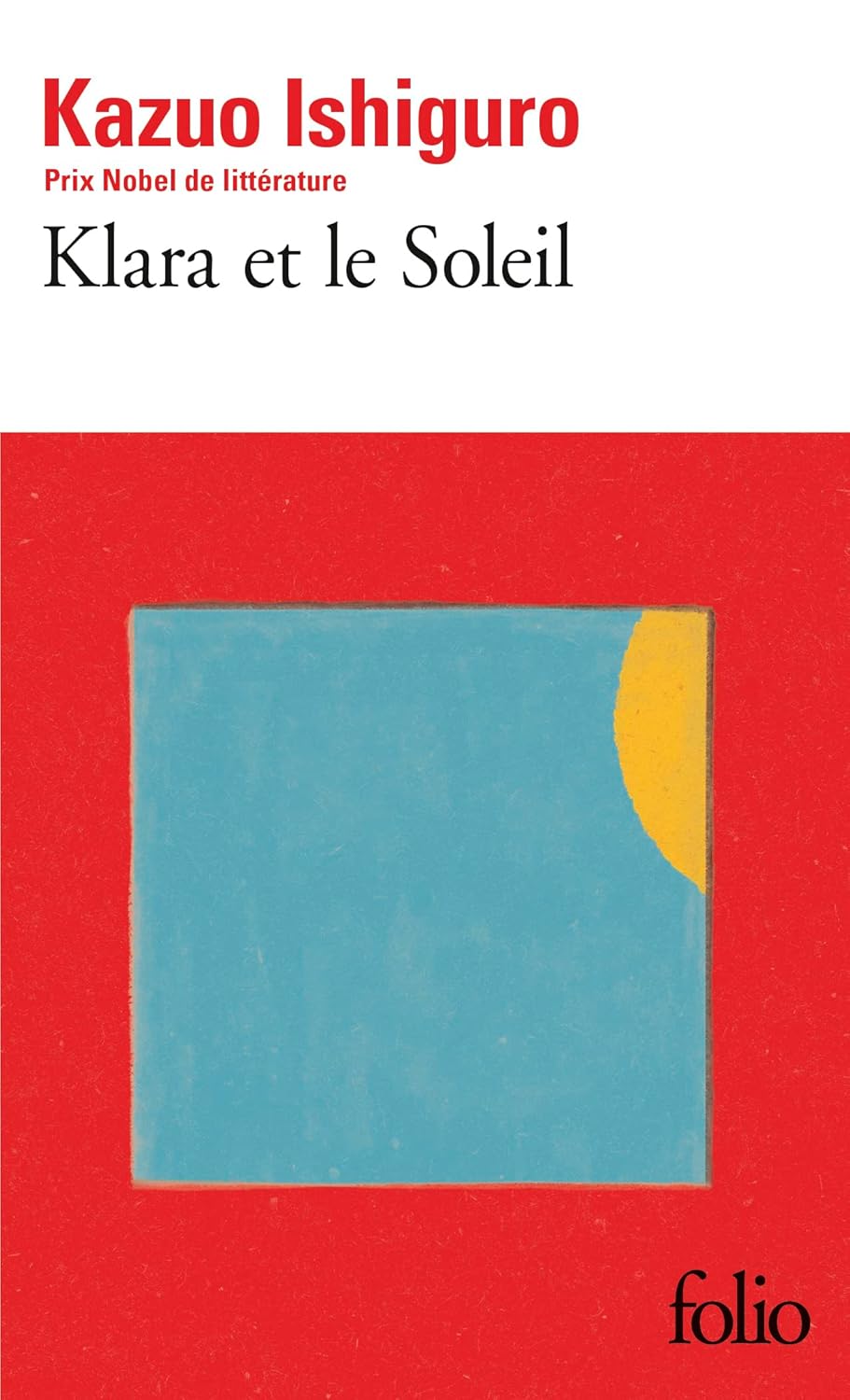
6 commentaires
nathalie · 4 août 2025 à 16 h 27 min
Oh je ne l’ai pas lu celui-là ! C’est une romancière que j’aime beaucoup, brillante, ambitieuse et très douée. Je vais me mettre en quête de ce titre. Tout ce que tu dis de son traitement des personnages me semble très juste.
Cléanthe · 4 août 2025 à 21 h 48 min
Les éditions sillage, qui font un magnifique travail de réédition, ont eu la fière idée de le rendre de nouveau disponible.
keisha · 4 août 2025 à 17 h 06 min
Oh mais j’ai sur mes étagères ces Scènes de la vie du clergé, lues il y a près de 30 ans. N’est ce pas, l’auteure est formidablement douée?
Cléanthe · 4 août 2025 à 21 h 49 min
Pour moi, elle occupe le sommet du roman anglais du 19e siècle. Avec Thomas Hardy, peut-être.
Aifelle · 5 août 2025 à 6 h 09 min
Je n’ai jamais lu cette autrice, je sais que c’est une lacune .. cette histoire pourrait me plaire, je note.
Athalie · 5 août 2025 à 7 h 47 min
Je suis en train de découvrir cette autrice en audiolisant Middlemarch … Je me régale ! Il y a tout ce que tu dis dedans . Je me demande vraiment pourquoi je n’ai pas lu cette autrice avant !