François MAURIAC : Le Fleuve de feu
 En vacances dans le Pyrénées, Daniel Trasis, un jeune marchand de voitures originaire des Landes, est séduit un jour à l’hôtel par l’arrivée de Gisèle de Plailly, une jeune fille offrant toutes les apparences d’une pureté virginale. Daniel est un séducteur, un chasseur, un prédateur pour qui toute jeune fille devient rapidement un objet de convoitise. Chaperonnée par Lucile de Verillon, une amie à elle, femme très pieuse en qui Daniel ne tarde pas à reconnaître un directeur de conscience, Gisèle se trouve donc placée au centre de deux désirs, celui de l’homme séducteur qui veut en faire sa proie et celui de la fervente catholique qui cherche à la sauver de ses propres désirs. La belle Gisèle de Plailly saura-t-elle résister au feu qui la hante?
En vacances dans le Pyrénées, Daniel Trasis, un jeune marchand de voitures originaire des Landes, est séduit un jour à l’hôtel par l’arrivée de Gisèle de Plailly, une jeune fille offrant toutes les apparences d’une pureté virginale. Daniel est un séducteur, un chasseur, un prédateur pour qui toute jeune fille devient rapidement un objet de convoitise. Chaperonnée par Lucile de Verillon, une amie à elle, femme très pieuse en qui Daniel ne tarde pas à reconnaître un directeur de conscience, Gisèle se trouve donc placée au centre de deux désirs, celui de l’homme séducteur qui veut en faire sa proie et celui de la fervente catholique qui cherche à la sauver de ses propres désirs. La belle Gisèle de Plailly saura-t-elle résister au feu qui la hante?
De passage pour quelques jours dans le bordelais, j’avais envie de me plonger dans un ou deux livres de Mauriac, un écrivain dont je gardais le bon souvenir d’un lecture : Le Sagouin, lu quand j’étais adolescent. Hélas, la rencontre ne s’est pas faite. Et c’est la grande déception de ce mois-ci.
Il y a une époque en effet où je me refusais de lire quoi que ce soit en rapport avec le lieu où je me trouvais. Je me demande si ce n’est pas une règle à laquelle je devrais revenir. Après ma lecture malheureuse de Theodor Fontane cet été à Berlin, un auteur que j’ai rêvé également de lire pendant des années, je n’ai pas non plus trouvé ces jours-ci dans Mauriac ce que j’y cherchais ou croyais pouvoir y trouver.
Il faut dire que c’est une littérature qui a beaucoup vieilli. Les trois personnages principaux de ce récit n’échappent jamais au stéréotype, si bien que j’ai peiné à trouver crédible aussi bien la furie de Daniel à posséder la pureté de la jeune fille qu’il convoite que la passion de Gisèle à se perdre moralement en se donnant physiquement à l’homme qui la désire ou l’élan de Lucile à sauver même contre elle-même la jeune fille dont elle veut assurer le salut dans son combat contre la chair. Toutes ces questions de pureté et d’impureté, de chair et d’âme, de virginité qu’on rêve de ravir, de logique du salut et de pente perverse du désir autour desquelles tourne le récit de Mauriac me semblent tellement éloignées de nous que j’ai même eu beaucoup de peine au cours de ma lecture à imaginer que c’était là l’imaginaire commun sans doute il y a moins d’une centaine d’années. A côté de cela, les dramaturges élisabéthains dont je me délecte en ce moment m’ont paru d’une modernité extraordinaire.
Ajoutons le climat de catholicisme exacerbé du récit, qui d’habitude ne me gêne pas – j’aime bien au contraire lire Bernanos ou Graham Greene justement pour la raison que ce sont des écrivains catholiques. Mais avec Mauriac – en tout cas ce roman-ci de Mauriac – ce n’est pas passé. J’ai trouvé la fin édifiante ridicule. Le renoncement à l’amour physique comme révélation de l’Amour ne parvient pas à me convaincre. La négation de la sexualité ne me semble pas être autre chose qu’une négation. Et je ne vois pas ce que l’on gagne à traiter de l’Amour sensuel comme une perversion, une pathologie, sinon à développer soi-même une vision pervertie et pathologique de l’Amour. Bref, le catholicisme de Mauriac m’insupporte, et pourtant j’aime bien ordinairement les écrivains catholiques.
On trouve en effet souvent chez ces auteurs catholiques une représentation du réel que je dirais volontiers hallucinée et qui peut nourrir une litterature intense, presque brûlante, qui fait tout le prix de ce genre de récits. Comme les bretonnes de Gauguin sortant de la messe pour lesquelles le paysage se teinte des rougeoiments démoniaques contre lesquels vient de les mettre en garde le curé, le roman catholique donne souvent à la représentation du réel ce ton halluciné hanté par la perception du mal, du poids de la chair, de la concupiscence et par la nostalgie d’une pureté perdue – c’est le motif de quelques grands romans de Graham Greene, Rocher de Brighton par exemple, ou La saison des pluies, deux romans que j’ai tout particulièrement aimés.
Oui, mais voilà : il y a chez un auteur comme Graham Greene une maîtrise formelle, une langue, que je n’ai pas trouvées chez Mauriac. C’est peut-être tout le problème d’ailleurs. Car, quand j’y réfléchis, il me semble que les mondanités ou les couchailleries secrètes qu’on trouve chez Proust ne sont guère plus modernes. Mais la langue de Proust a su leur donner ce ton qui fait que ces questions d’une époque continueront à parler au lecteur, depuis leur particularité, pendant des siècles. Comme la passion chez Racine. Ou la mystique amoureuse, quasiment érotique d’une sainte Thérèse d’Avila. Rien de cette langue qui transcende la particularité d’un regard, d’un discours en même temps qu’elle l’accomplit, encore une fois, chez Mauriac, malgré quelques formules bien pesées, quelques évocations de lieux efficaces saisies en un style rapide, quelques déclarations de personnages prêts à dégager le sens de leur parcours et de leur experience qui font comprendre que Mauriac a pu être considéré en effet au XXe siècle comme un auteur important. Ma dernière lecture (mais peut-être n’est-ce pas le bon livre – je retenterai quand même l’experience) me fait même douter qu’il soit appelé à rester comme un classique.

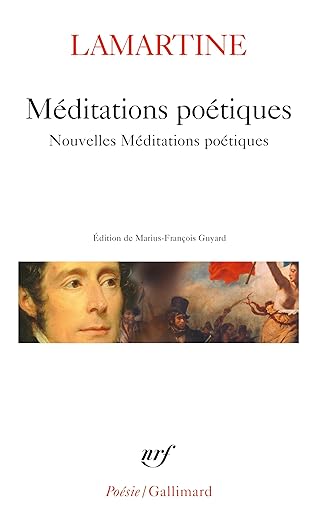
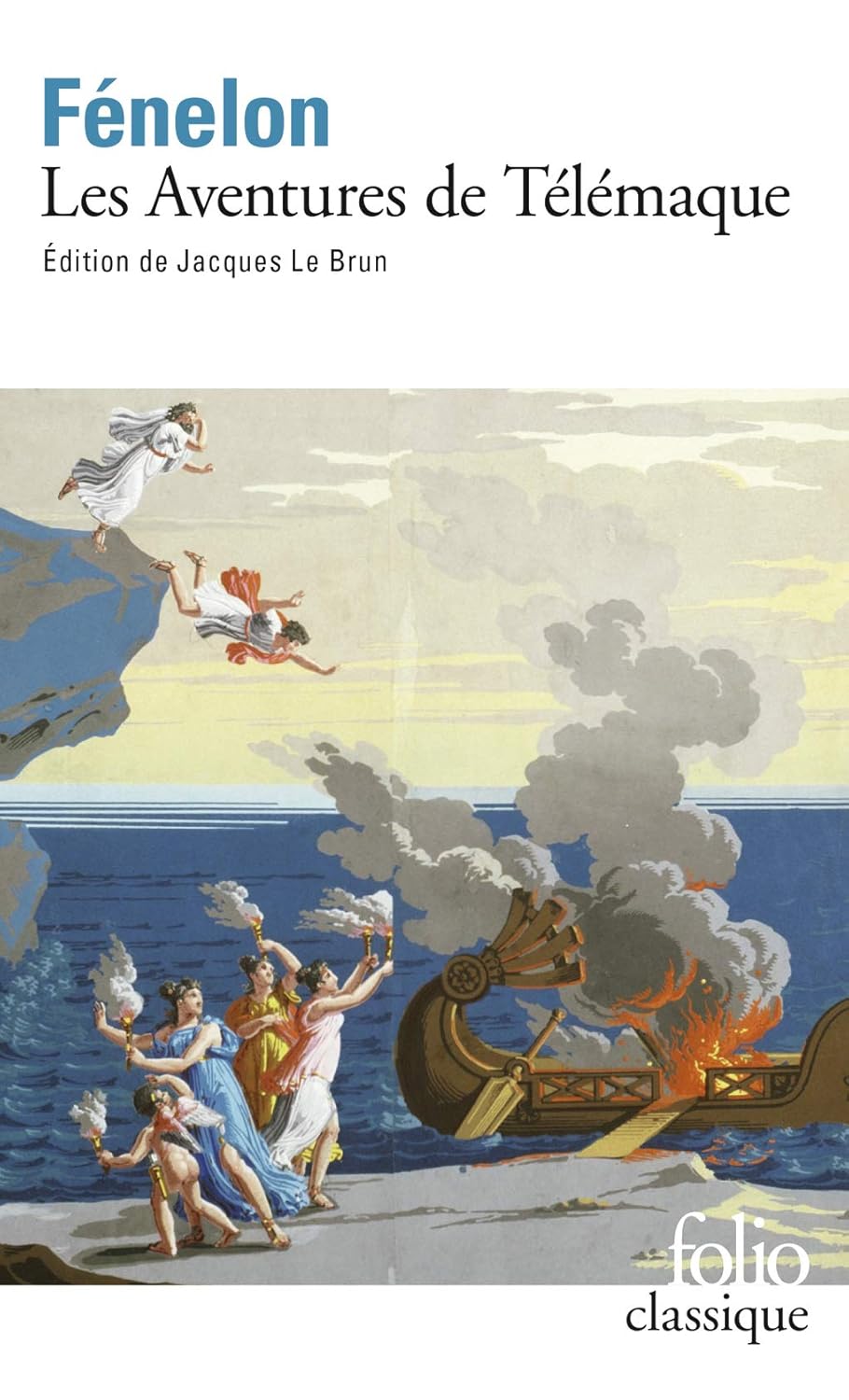
11 commentaires
Tania · 1 novembre 2018 à 14 h 26 min
Relire Mauriac aujourd’hui… Je me demande en lisant ce billet quelle impression il me ferait. « Thérèse Desqueyroux » devrait tenir le coup, il me semble. Jamais lu ce titre-ci.
Cléanthe · 1 novembre 2018 à 16 h 10 min
Je vais essayer « Thérèse Desqueyroux ». Ça m’ennuie de rester sur un mauvaise impression concernant un écrivain que j’estimais jusqu’alors.
christw · 4 novembre 2018 à 10 h 19 min
Je comprends que le catholicisme de Mauriac insupporte, c’est mon cas (il se montre plus critique dans « La pharisienne »). Et vous argumentez bien votre déception avec ce Mauriac « Le fleuve de feu » que je n’ai jamais lu.
J’éprouve pourtant des difficultés à comparer objectivement la langue de Greene à celle de Mauriac, mais je comprends qu’on préfère l’une à l’autre.
Cléanthe · 4 novembre 2018 à 10 h 47 min
Je pense tenter de nouveau l’expérience, peut-être avec « La pharisienne ».
Concernant la langue, ce que je voulais dire c’est que Mauriac justement ne me paraît pas capable de forger un style qui résiste au temps, afin de m’intéresser, moi lecteur d’une autre époque, à ces destins particuliers. En lisant Mauriac, j’avais un peu la même impression que lorsque j’ai lu du Pierre Benoît. Tout le contraire d’un Proust ou d’un Balzac, par exemple.
christw · 4 novembre 2018 à 13 h 37 min
Je comprends. De fait, le style Mauriac fait «vieux» de par une certaine préciosité (je ne sais pas si le mot convient) dont il pare son écriture.
Ça ne me dérange pas (j’aime ce style affecté) et ne m’empêche pas de suivre ses personnages avec intérêt et de les trouver vivants.
Ceci dit, votre ressenti est intéressant à souligner et de fait, la langue de Mauriac peut nuire à sa postérité, si ce n’est déjà le cas.
Bon dimanche.
ellettres · 9 novembre 2018 à 13 h 21 min
Ton billet me fait penser que je n’ai jamais réussi à finir un roman de Mauriac (sauf Thérèse Desqueyroux il y a longtemps), probablement pour les mêmes raisons que tu cites. Je pense que même à son époque il devait être décalé, et que son propos sur la pureté devait sonner un peu faux (sauf dans certains milieux catholiques très traditionnels). En te lisant, j’ai presque l’impression de lire un billet sur Berthe Bernage, la créatrice de la série des « Brigitte », monument de la bonne pensée catholique vieille-France de l’entre-deux-guerres. Mauriac est peut-être meilleur quand il parle de la bourgeoisie terrienne accrochée à son bout de lande et son domaine et prête à tout pour le conserver.
Cléanthe · 9 novembre 2018 à 16 h 44 min
C’est l’idée que j’avais de Mauriac en effet. Mais la question de la représentation de l’amour porte au-delà du catholicisme de Mauriac je pense. Pour avoir lu récemment un texte d’Alain de la même époque, j’ai l’impression que le rapport amoureux entre hommes et femmes n’a jamais été aussi compliqué qu’au début du XXème siècle. En deux mots, on reconnaît des sentiments aux femmes, voire des pulsions, des désirs, tout en les enfermant dans la pudeur qu’on attend d’elles. On ne comprend pas qu’une femme puisse dire « Je désire » (c’est ce qui m’a insupporté chez Mauriac), et pourtant l’époque est assez avancée aussi pour reconnaître que les femmes ont des désirs! Franchement, sur ces questions, je préfère lire des auteurs féminins. Et je comprends mieux, après ma lecture de Mauriac, pourquoi je trouve si convaincants les personnages de femmes des romans de Virginia Woolf.
ellettres · 12 novembre 2018 à 13 h 20 min
Ton propos sur la difficulté du rapport amoureux hommes-femmes au début du XXe siècle interpelle ma fibre historienne. C’est en effet quelque chose à creuser. Il y a des choses qui bougent à cette époque avec Freud et consorts (notamment), la première guerre mondiale et les années folles, mais en effet, il y a sans doute aussi une réaction de la société patriarcale à l’égard de ces changements de moeurs. Aragon est plutôt sensible à la cause des femmes, mais tous les auteurs masculins ne sont pas comme lui, loin de là. Je te rejoins sur Woolf.
Cléanthe · 12 novembre 2018 à 18 h 45 min
C’est vrai, j’oubliais Aragon… qui est justement avec Virginia Woolf (Et Giono, mais pour d’autres raisons) l’auteur que je préfère au XXème.
maggie · 10 novembre 2018 à 10 h 03 min
Je crois n’avoir rien lu de cet auteur mais ton billet confirme mes a priori sur son catholicisme. En plus, si le style ne rend pas remarquable le récit, ça ne donne pas particulièrement envie…
Cléanthe · 10 novembre 2018 à 10 h 09 min
J’aime beaucoup Bernanos, écrivain catholique lui aussi. Sans parler de Graham Greene, que je mets au panthéon de mes auteurs favoris. Le problème de Mauriac, si j’en crois ce roman-ci, c’est que ça a beaucoup vieilli.