John BARTH: Le Courtier en tabac
Le Courtier en tabac du romancier américain John Barth (deux volumes: * Le lauréat du Maryland / ** Malden recouvré, 702 et 700 pp., Le Livre de poche / Biblio, 2004) est l’un de ces livres étonnants dont les Etats-Unis, sous le nom de récit post-moderne, ont fait une spécialité (DeLillo, Pynchon, etc…). Paru initialement en 1960, le roman de celui qu’on considère outre-Atlantique comme le pape du post-modernisme a du attendre cependant l’année 2002 pour que, grâce aux efforts du Serpent à plume, il soit enfin accessible au lecteur français.
Faut-il s’en plaindre? Quand on sait qu’il est encore impossible de trouver aujourd’hui dans un format courant, par exemple en édition de poche, la plus grande partie des oeuvres de Smollett, c’est-à-dire de l’un des quatre plus grands romanciers anglais du XVIIIème siècle, on se dit que la traduction de John Barth n’aura pas trop tardé finalement. Certains aiment parler de la suprématie culturelle anglo-saxonne, sous l’effet de la mondialisation. Qu’on commence donc par pouvoir lire en France ce qu’on lit à Londres ou à New-York, et on verra si cette notion d’uniformisation a un sens. Mais passons.
Distance, efforts stylistiques, volonté d’ancrer le récit dans une mythologie, certes personnelle et retravaillée, et surtout clins d’œil aux références modernes que sont Swift, Sterne, Cervantès ou Rabelais sont les qualités de l’art de John Barth. Je ne raconte pas l’histoire: il n’y aurait rien à raconter; ou plutôt, il faudrait tout raconter. Prenant pour modèle les romans d’apprentissage du XVIIIème siècle, centrés sur un protagoniste candide qui fait l’expérience douloureuse du mal, Le Courtier en tabac relate les aventures du jeune Ebenezer Cooke, poète et puceau, parti composer dans le Maryland une épique Marylandiade qui glorifierait la province en chantant son histoire et ses habitants légendaires.
Mais ceci est davantage le prétexte que l’histoire. Il semble que, dans son roman, John Barth n’ait eu qu’une intention: ruiner le mythe de l’Amérique, et au passage celui du roman. La vision angélique du Nouveau Continent fait de terres vierges et nobles, sorte de « paradis retrouvé », face à un Vieux Monde corrompu, n’est qu’une chimère, une fiction mystificatrice que raconte bien cette histoire d’un benêt vierge et ridicule venu d’Angleterre découvrir une Amérique corruptrice. A vrai dire, l’action ne progresse guère, tout au long des 1400 pages qui composent le roman: la duplicité des personnages, les chausse-trappes dans lesquelles tombent le héros – et aussi le lecteur – et surtout une écriture guidée, semble-t-il, par le seul plaisir de l’auteur contribuent à ralentir l’action et à rendre inutiles les péripéties pourtant nombreuses de ce roman. Le « pire » est atteint lorsque après plus de 1000 pages consacrées à faire attendre, par des allusions grivoises, le dépucelage d’Ebenezer, John Barth choisit de frustrer son lecteur – une fois de plus – en laissant retomber un voile pudique sur l’événement. Mais on n’aura jamais pris un plaisir aussi intense à se laisser frustrer ainsi. Il faut dire qu’en l’occurrence le pucelage d’Ebenezer ne tenait plus à rien: on l’aura vu précédemment approcher le corps nu d’une prostituée; assister au viol d’un groupe de filles perdues parties refaire leur vie en Amérique; manquer de peu lui-même de violer cette même prostituée qu’il avait précédemment rencontré; contraint d’offrir son corps à des marins peu regardant sur le sexe de celui qui pourrait leur procurer du plaisir; apprendre que son précepteur l’aime secrètement; et, pour finir, découvrir les sentiments bien peu fraternels à son égard de sa propre sœur , sentiments sans doute réciproques
On a pris l’œuvre, à sa sortie, pour un roman nihiliste. Et il est vrai que John Barth écorne au passage quelques uns des topoi du roman de formation ou de l’aventure romanesque, et de la morale qui les sous-tend: le thème de l’ami plus âgé à la fois substitut d’un père tyrannique et d’un frère initiateur; la distinction du bien et du mal; l’amour; et même ces grands Hommes, ces pères fondateurs qui ont fait l’Amérique. Comme ces topoi fondent dans le même temps le mythe du Nouveau Monde, l’effet est garanti: les conquérants? Un ramassis de brutes et de truands. L’amour? Toujours pervers ou intéressé. Les grands Hommes? La version nouvelle de l’histoire de John Smith et de l’indienne Pocahontas est suffisamment savoureuse pour que je ne vous prive pas du plaisir de la découvrir par vous-même.
On a pris l’œuvre, à sa sortie, pour un roman nihiliste. Et il est vrai que John Barth écorne au passage quelques uns des topoi du roman de formation ou de l’aventure romanesque, et de la morale qui les sous-tend: le thème de l’ami plus âgé à la fois substitut d’un père tyrannique et d’un frère initiateur; la distinction du bien et du mal; l’amour; et même ces grands Hommes, ces pères fondateurs qui ont fait l’Amérique. Comme ces topoi fondent dans le même temps le mythe du Nouveau Monde, l’effet est garanti: les conquérants? Un ramassis de brutes et de truands. L’amour? Toujours pervers ou intéressé. Les grands Hommes? La version nouvelle de l’histoire de John Smith et de l’indienne Pocahontas est suffisamment savoureuse pour que je ne vous prive pas du plaisir de la découvrir par vous-même.
Alors, John Barth est-il vraiment nihiliste? Sans doute pas. Car en choisissant de renvoyer explicitement à des auteurs des XVIème et XVIIIème siècles (Rabelais, Cervantès, Swift ou Sterne) c’est-à-dire à un régime de la fiction conscient de l’artifice et des limites du romanesque, John Barth a réinventé en quelque sorte la modernité littéraire: chez lui, la mise à plat, le décapage des illusions de l’Amérique et des fictions du roman, loin de se résoudre en une dénonciation nihiliste des pouvoirs de l’idéologie, invente une façon nouvelle de continuer à jouir, malgré tout, mais en adultes, des plaisirs de la fiction, du mythe de l’Amérique.


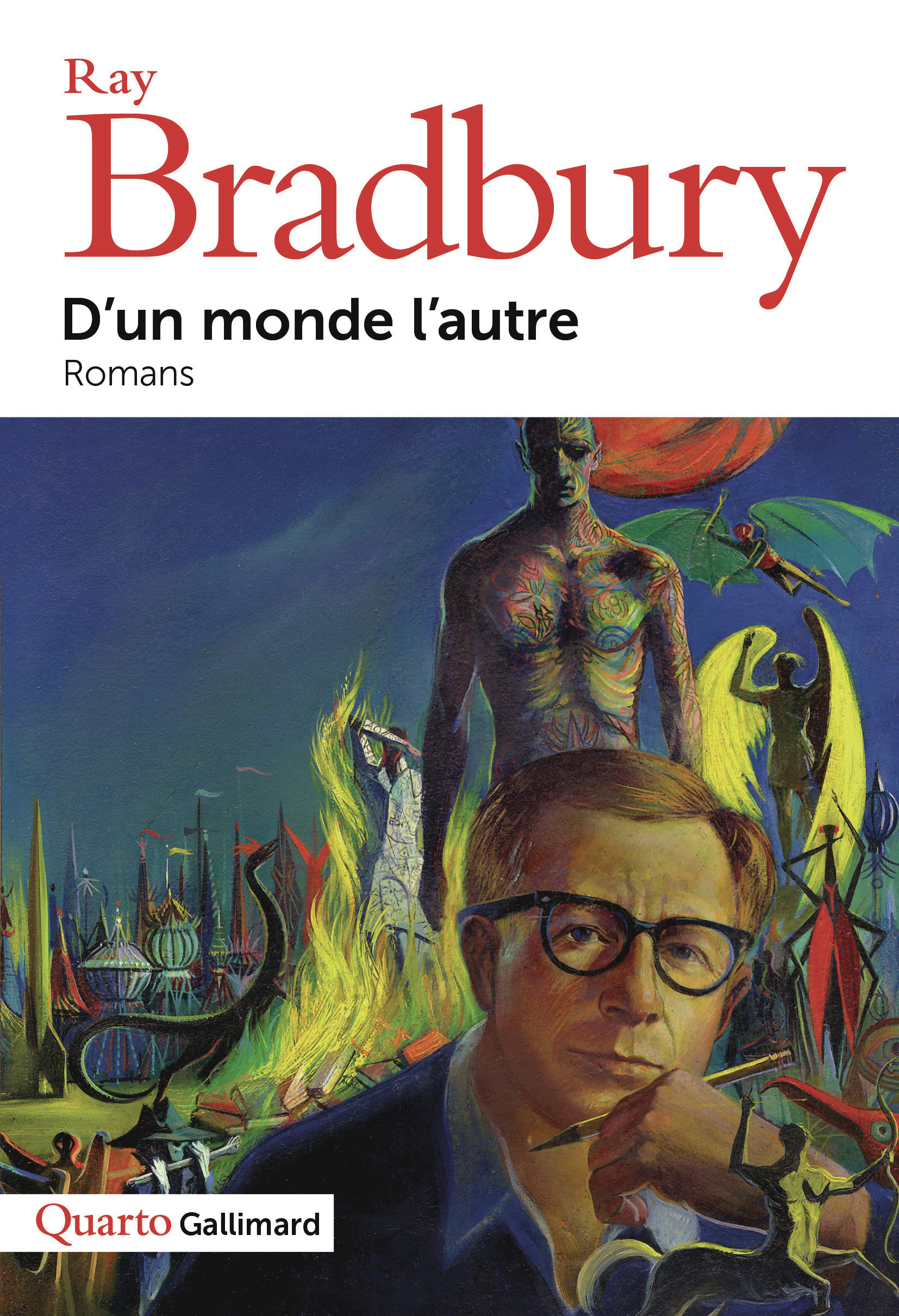
1 commentaire
Eeguab · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
J’ai lu il y a peu(et chroniqué) Opéra flottant et suis resté un peu perplexe,sans vraiment l’envie de plonger davantage chez John Barth.