Hannah ARENDT: Eichmann à Jérusalem
 Présente à Jérusalem, au procès Eichmann, d’où elle rapporte à destination de la presse américaine les chapitres qui constituent la matière de ce livre, Hannah Arendt s’interroge sur la nature du mal. Le sous-titre de l’ouvrage de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, dont on a voulu faire une théorie, alors que le texte est à ranger au contraire au rayon de ces (rares) textes philosophiques qui, au lieu de faire l’économie des faits pour bondir droit à la théorie ou au concept, consistent au contraire dans une lecture minutieuse, un examen des cas individuels, ne doit pas nous leurrer sur les intentions de Hannah Arendt, qui sont d’abord polémiques, au sens noble du terme, c’est-à-dire authentiquement philosophiques: que vaut l’opinion qui compare les nazis à des monstres et déduit du caractère exceptionnel des crimes commis une nature exceptionnelle (dans le crime, dans le goût pour le mal, quelque chose de diabolique) de ceux par qui ils ont été commis? Les juges de Jérusalem, appelés à juger le criminel nazi Eichmann, ont fourni la condition de possibilité du dépassement juridique de l’opinion: « Repoussant manifestement la thèse de l’accusation, ils dirent explicitement que des souffrances à ce point incommensurables étaient ‘au-delà de la compréhension humaine’, qu’elles étaient l’affaire ‘de grands écrivains et poètes’ et ne relevaient pas d’un tribunal, alors que les actes et mobiles qui en étaient la cause n’étaient au-delà ni de la compréhension ni du jugement. » Ce qui frappe dès lors, c’est l’attachement de Arendt au formalisme (au sens juridique) du procès, préparé en amont par les réserves de Karl Jaspers, qui figure parmi les correspondants dont les lettres complètent utilement cette édition du texte. Mesurer par le droit et la raison la responsabilité d’un homme et ce qu’elle éclaire du fonctionnement d’un régime qui a signifié pour des millions d’êtres humains, partant pour l’humanité tout entière, bien que d’une autre façon, la catastrophe, tel est le propos de Hannah Arendt.
Présente à Jérusalem, au procès Eichmann, d’où elle rapporte à destination de la presse américaine les chapitres qui constituent la matière de ce livre, Hannah Arendt s’interroge sur la nature du mal. Le sous-titre de l’ouvrage de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, dont on a voulu faire une théorie, alors que le texte est à ranger au contraire au rayon de ces (rares) textes philosophiques qui, au lieu de faire l’économie des faits pour bondir droit à la théorie ou au concept, consistent au contraire dans une lecture minutieuse, un examen des cas individuels, ne doit pas nous leurrer sur les intentions de Hannah Arendt, qui sont d’abord polémiques, au sens noble du terme, c’est-à-dire authentiquement philosophiques: que vaut l’opinion qui compare les nazis à des monstres et déduit du caractère exceptionnel des crimes commis une nature exceptionnelle (dans le crime, dans le goût pour le mal, quelque chose de diabolique) de ceux par qui ils ont été commis? Les juges de Jérusalem, appelés à juger le criminel nazi Eichmann, ont fourni la condition de possibilité du dépassement juridique de l’opinion: « Repoussant manifestement la thèse de l’accusation, ils dirent explicitement que des souffrances à ce point incommensurables étaient ‘au-delà de la compréhension humaine’, qu’elles étaient l’affaire ‘de grands écrivains et poètes’ et ne relevaient pas d’un tribunal, alors que les actes et mobiles qui en étaient la cause n’étaient au-delà ni de la compréhension ni du jugement. » Ce qui frappe dès lors, c’est l’attachement de Arendt au formalisme (au sens juridique) du procès, préparé en amont par les réserves de Karl Jaspers, qui figure parmi les correspondants dont les lettres complètent utilement cette édition du texte. Mesurer par le droit et la raison la responsabilité d’un homme et ce qu’elle éclaire du fonctionnement d’un régime qui a signifié pour des millions d’êtres humains, partant pour l’humanité tout entière, bien que d’une autre façon, la catastrophe, tel est le propos de Hannah Arendt.
Soucieuse de ne pas râter son objet, Arendt multiplie donc les notations visant à caractériser la spécificité du totalitarisme et des actions et motivations de ceux qui agissent pour lui, en un parcours qui suit les phases du procès: présentation de la cour, portrait de l’accusé et histoire de son parcours, définition de sa place dans l’appareil d’extermination nazi, mesure de son niveau de responsabilité, analyse de ses différents types d’intervention sur les différents terrains nationaux où il eut à intervenir et définition des limites de son pouvoir. Car Eichmann fut un rouage essentiel du régime nazi: responsable de la logistique de la « solution finale », c’est un fonctionnaire important, mais cependant pas suffisamment pour appartenir au premier cercle des dirigeants du parti. Son cas est donc symptomatique. Comment une homme ambitieux, mais déclassé socialement, peu doué, sinon d’un réel sens de l’organisation et d’« une incapacité quasi totale de considérer quoi que ce soit du point de vue de l’autre », que ses qualités médiocres ne prédisposait pas à être un criminel de masse (c’est du moins la thèse de départ de Hannah Arendt), en est-il venu à remplir la fonction de courroie sans laquelle la « solution finale » n’aurait pas été techniquement possible? De ce point de vue, l’un des moments les plus intéressants et bouleversants de l’ouvrage est celui que la philosophe consacre au « travail » d’Eichmann sur le terrain, à ses manoeuvres pour réaliser le plus efficacement sa tâche, malgré la réticence (évidente!) des victimes et les tensions entre les services de l’administration nazie, y compris dans l’organigramme des SS.
Parmi les thèses polémiques de l’ouvrage, celle qui fit l’objet de tant de controverses à l’époque de la publication, la participation des institutions représentatives de la communauté juive dans le processus de sélection et de déportation, si elle mérite d’être corrigée aujourd’hui par les travaux des historiens, semble valoir surtout pour l’intuition qu’elle porte concernant la spécificité du totalitarisme: la « vision » nazie n’épargne pas y compris les adversaires ou les victimes, et c’est en un système de désorientation et de brouillage des valeurs généralisé, et non en la seule tyrannie d’un groupe uni par une idéologie, que consiste l’essence du régime nazi. Arendt ne s’interdit jamais d’ailleurs de mettre à mal cette image d’une régime monolithique, qui serait noué par l’unité d’un fonctionnement, mais prend soin de relever les logiques contradictoires, l’écart des pratiques, les conflits de personnes, les ambitions différentes qui font de l’administration nazie un ensemble complexe tirant à hue et à dia; et le défi devient dès lors d’expliciter l’étonnante efficacité de cette machine au regard de l’Histoire, forme renouvelée du défi lancé à la philosophie, et à tout homme en général, par l’existence du mal – et l’effort que cela nous enjoint de refuser, si nous voulons vraiment rendre raison de la réalité de ce qui est contraire à la raison, à tout explication de type mythique ou mythologique, celle par exemple d’une nature diabolique ou de la prétendue perfection organisationnelle du régime totalitaire.
Certes Arendt sous-estime le rôle de la culpabilité de la jeune génération dans la reconstitution culturelle et morale de la nation allemande, qui devait s’exprimer par la remise en question de la légitimité des aînés dans les mouvements contestataires des années 60 et 70 et, sur un autre plan, dans la querelle des historiens (Historikerstreit) des années 80 et les retombées, dans l’opinion publique allemande, du débat cristallisé autour de la violente polémique qui opposa l’historien Ernst Nolte et le philosophe Jürgen Habermas. Tandis que le portrait d’une nation qui aurait suivi passivement les commandements de l’ordre totalitaire, « vertu » par ailleurs partagée par l’essentiel des peuples dominés par les nazis, selon la description d’Annah Arendt, utile à sa thèse, demande à être modéré par les travaux récents sur la question de la résistance allemande (Hans Mommsen, Alternative zu Hitler, Münich, 2000; Günther Weisenborn, Une Allemagne contre Hitler, trad. franç. Paris, 2000). Mais ce Rapport est le livre d’une philosophe, intellectuelle juive allemande, engagée d’abord biographiquement dans l’Histoire, qui règle ses comptes au passage avec la lâcheté de Heidegger, défend la position des émigrés, contraints de quitter (« abandonner » selon un mot encore en cours après-guerre) leur pays dès les premiers mois du régime, et entretient avec tour à tour l’Allemagne contemporaine et le sionisme un dialogue critique.
C’est aussi et surtout le Rapport d’une femme qui, placée devant l’un des pires monstres de l’Histoire, s’aperçoit que l’homme qui est devant elle n’a pas l’envergure d’un diable ou d’un démon, et qui cherche à comprendre, avec tous les moyens de sa culture et de sa raison, ce décalage entre le caractère exceptionnel et superlatif des crimes commis et la médiocrité de leur auteur, comprenant que dans ce décalage justement consiste la nouveauté d’un système à la connaissance duquel elle a par ailleurs contribué par ses études sur le totalitarisme. Le sens de l’expression de « banalité du mal » n’est pas à chercher ailleurs. Celle-ci s’appréhende en particulier à l’occasion des nombreuses analyses linguistiques dont Arendt émaille son texte: il y a un processus psychologique totalitaire (j’ai pensé bien des fois « sectaire »), qui s’exprime dans un certain rapport à la langue. Eichmann ne cesse de se qualifier d' »idéaliste ». Son discours est un processus linguistique assez élaboré de déni de la réalité: « Il était impossible de communiquer avec lui, non parce qu’il mentait, mais parce qu’il s’entourait du plus efficace des mécanismes de défense contre les mots et la présence des autres et, partant, contre la réalité en tant que telle. » Son mensonge n’est pas seulement un processus d’auto-mystification personnel, mais le système d’organisation politique et culturel d’une nation dominée par un système totalitaire: des expressions toutes faites, de scandaleux clichés, des euphémismes, de criminelles « règles de langage » (« solution finale », « évacuation » ou « traitement spécial » pour « tuerie »; « réinstallation » pour « déportation ») viennent prendre la place des formes naturelles, c’est-à-dire humaines, de la motivation et de la pensée qu’elles détournent dans le sens des buts recherchés par l’appareil d’Etat: « pour chaque période de sa vie et pour chacune de ses activités, l’accusé disposait d’un cliché euphorisant ». D’où un type très particulier de déresponsabilisation. A la question: ‘des hommes comme Eichmann se sont-ils assis sur leur conscience?’, Arendt répond: « L’effet exact produit par ce système de langage n’était pas d’empêcher les gens de savoir ce qu’ils faisaient, mais de les empêcher de mettre leurs actes en rapport avec leur ancienne notion ‘normale’ du meurtre et du mensonge. ». L’évocation, plusieurs chapitres plus loin, des réticences jusque dans les rangs de la Gestapo, devant l’application de la « solution finale » au Danemark, émises par des nazis en poste depuis quelques temps dans un pays où l’idée d’un « problème juif » n’allait pas de soi et où le roi en personne se porta en première ligne lorsqu’il s’agit de porter l’étoile jaune tend à souligner ce processus de fonctionnement « sectaire » du régime nazi.
L’ironie n’est pas la moindre des qualités de ce texte. Car pour répondre à la langue nazie, en désamorcer les effets, il faut savoir inventer à son tour une langue qui sache nous découvrir le point de vue de l’autre, même si l’autre est un monstre, mais n’en assume pas les séductions dangereuses. Héritière à la fois des traditions philosophique, allemande et juive, Hannah Arendt trouve dans le recours récurrent à l’ironie la condition de continuer à vivre malgré tout: « la leçon de ces histoires est simple et à la portée de tous. Politiquement parlant, elle est que, dans des conditions de terreur, la plupart de gens s’inclineront, mais que certains ne s’inclineront pas; de même, la leçon que nous donnent les pays où l’on a envisagé la Solution finale, est que ‘cela a pu arriver’ dans la plupart d’entre eux, mais que cela n’est pas arrivé partout. Humainement parlant, il n’en faut pas plus, et l’on ne peut raisonnablement pas en demander plus, pour que cette planète reste habitable pour l’humanité. »
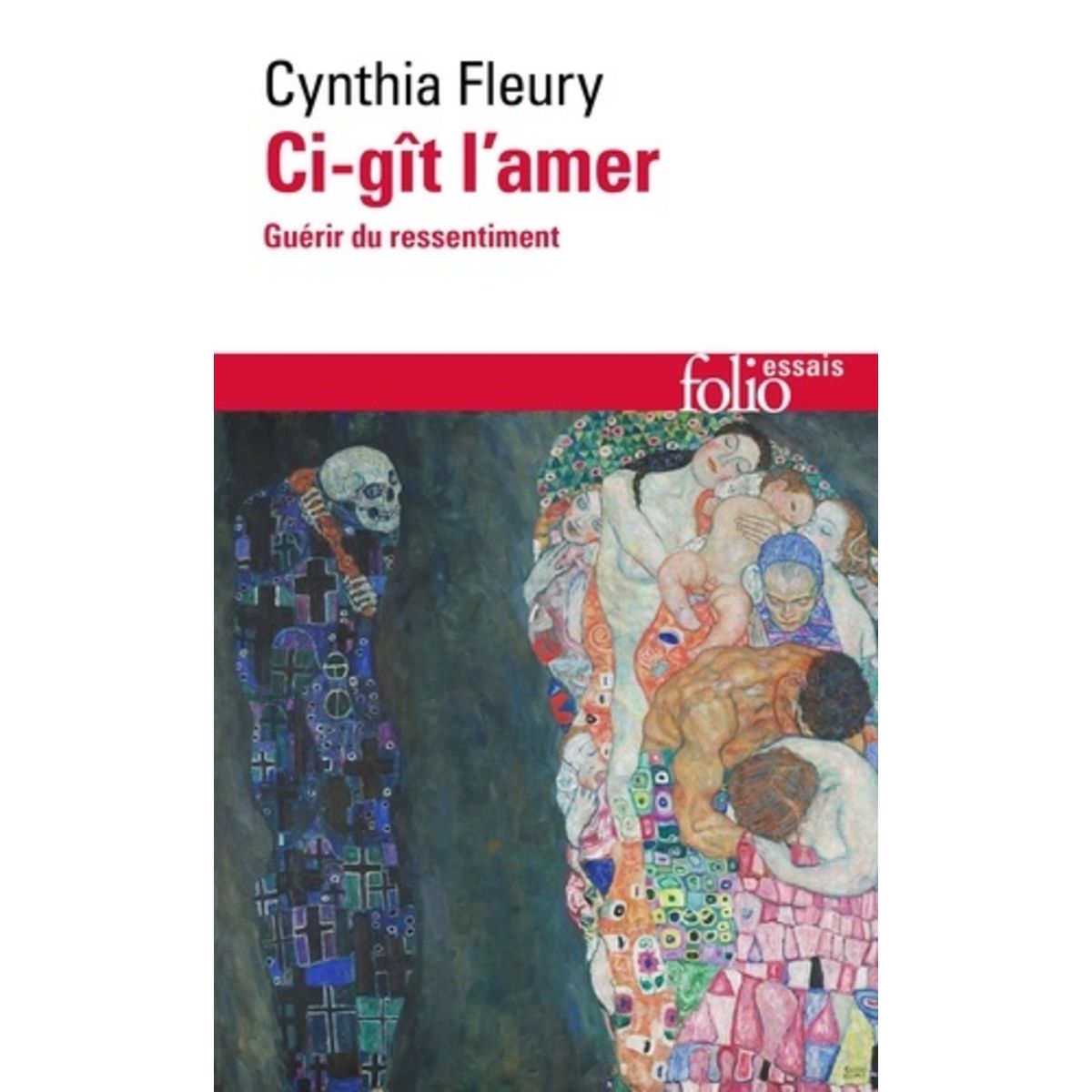
0 commentaire