Philip ROTH: La leçon d’anatomie
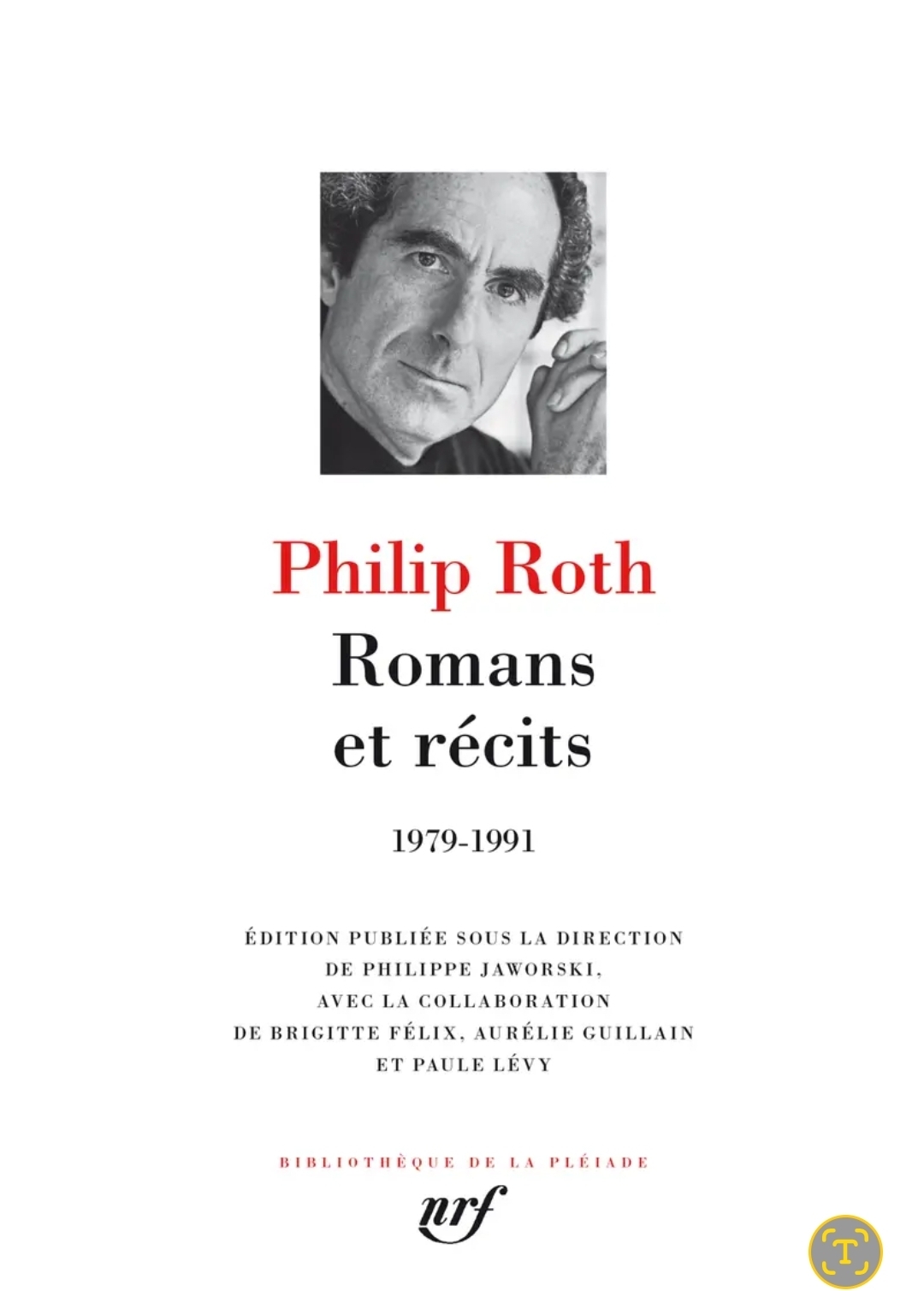
Une douleur fulgurante dans la nuque et les épaules, une douleur qui redescend dans la main droite, gênant même l’écriture, s’est installée, depuis des semaines, dans chaque geste, chaque pensée de Nathan Zuckerman, au point de transformer entièrement sa manière d’être au monde. Les médecins défilent, s’inquiètent, se contredisent, tandis que le mal s’affirme, opaque, sans cause, sans explication. Pour tenir, Zuckerman avale des calmants et les arrose de vodka, complétant ce régime par quelques joints quotidiens. Cette auto-médication, qui devrait l’apaiser, le fragilise encore davantage. Elle altère ses perceptions, épaissit sa confusion, le rend irritable, paranoïaque, vulnérable. Peu à peu, ce cocktail d’analgésiques et d’alcool ouvre en lui une brèche schizoïde: la douleur, au lieu de se calmer, se démultiplie en angoisses, en délires, en emballements imaginaires…
Troisième volet du cycle Zuckerman après L’Écrivain fantôme et Zuckerman délivré, La Leçon d’anatomie marque une inflexion décisive: l’écrivain en quête d’identité, tiraillé entre célébrité, héritage littéraire et responsabilité morale, laisse place ici à une figure bien plus vulnérable, dominée par un corps qui se cabre et refuse toute maîtrise. Là où les précédents romans mettaient en scène la fabrication d’un écrivain, celui-ci raconte la décomposition d’un organisme, l’effritement d’une subjectivité, la crise pure. Zuckerman ne cherche plus à comprendre sa vocation ni à défendre sa littérature: il tente simplement de survivre à la douleur et de maintenir une cohérence minimale dans un monde qui se défait.
Dans ce chaos, son corps semble n’obéir à aucune logique: paradoxalement diminué et pourtant priapique, Zuckerman multiplie les aventures avec Diana, Gloria, Jenny et Jaga, alors même qu’il vient de divorcer de sa troisième femme. Mais cette vigueur n’a rien d’une affirmation: elle révèle au contraire un état de faiblesse presque criant. Ses amantes, imposantes, autonomes, volontaires, surgissent comme des figures plus stables que lui, tandis que Nathan apparaît comme un corps offert, un homme qui cherche à masquer son désarroi derrière une activité sexuelle fébrile. Ce priapisme, loin d’être une dernière preuve de virilité, incarne une forme d’impuissance morale et existentielle: la fuite dans le désir pour échapper à la conscience d’un corps qui ne lui appartient plus vraiment.
À cette fragilité physique et sentimentale vient se superposer la douleur morale, lorsque sa mère meurt soudainement. Le choc est aussi brutal que la douleur somatique: une rupture nette, qui redouble son désordre intérieur. Rien ne tient ensemble: ni son corps, ni ses amours, ni ses repères familiaux. Le monde se désagrège en périphérie comme en son centre, et l’on sent Zuckerman vaciller, tenu debout seulement par les calmants et l’alcool qui l’éloignent encore davantage de lui-même.
C’est dans cet état d’instabilité extrême que s’inscrit l’un des épisodes les plus savoureux et les plus révélateurs du roman: la confrontation avec Milton Appel, critique prestigieux qui n’a cessé de l’attaquer publiquement. Durant un trajet en avion puis dans la limousine qui le conduit dans Chicago, Nathan, après avoir en vain tenté de se disputer avec le critique, finit par inventer un roman délirant, s’inventant une nouvelle identité où, sous le nom d’Appel il s’affiche comme un pornographe miteux, directeur d’un magazine intitulé Cracra-Mouille. Ce passage, véritable tourbillon d’inventions grotesques, pur moment rabelaisien, dévoile à la fois la verve satirique de Roth et l’immaturité profonde de Zuckerman, incapable de contenir sa rancœur autrement qu’en la transfigurant dans une comédie outrancière – mais qui est cependant la condition de l’écrivain. Ce défoulement imaginaire, drôle et inquiétant à la fois, montre combien la douleur et les substances qui l’accompagnent éveillent en lui des débordements schizoïdes: c’est toute sa psyché qui se fissure.
Cette dérive se prolonge lorsque Zuckerman, acculé, envisage sérieusement de reprendre des études de médecine et se persuade de devenir obstétricien. Ce fantasme de reconversion radicale révèle sa naïveté, presque son adolescence tardive: outre un beau retour à Chicago, sur les lieux de ses études universitaires, où il croit pouvoir reprendre tout à zéro, retour intéressant sur un plan littéraire, puisqu’il ouvre à quelques pages inspirées, dans la veine de celles consacrées à Newark dans les romans précédents, ce fantasme reste vain sur le plan psychologique, individuel. Roth y montre un homme incapable d’accepter la vulnérabilité, désireux de se réinventer ailleurs, autrement, comme si la transformation identitaire pouvait se substituer à la guérison.
Au fil du roman, Roth brouille encore les pistes en convoquant Rembrandt, Proust, T.S Eliot, Beckett, Thomas Mann, affichant des affinités littéraires, mais pour mieux renverser ce qu’ils représentent. Là où Proust et Mann, en effet, faisaient de la souffrance une voie de connaissance, lui la maintient dans sa trivialité brutale: la douleur ne révèle rien, ne purifie rien, ne conduit à aucune vérité. Et l’allusion au tableau de Rembrandt, La Leçon d’anatomie du docteur Tulp, vers lequel fait signe le titre du roman, devient alors ironique. Les médecins du roman ne comprennent rien, s’opposent, s’annulent; Zuckerman, lui, parle trop, déborde, se plaint, invente, délire. Le savoir chancelle, l’autorité se dissout, la hiérarchie traditionnelle entre le médecin et le malade s’inverse. C’est le corps qui commande, qui proteste, qui refuse obstinément d’être interprété.
Cette protestation atteint son paroxysme dans la chute finale: épuisé, ivre, abruti de calmants, Zuckerman s’effondre à Chicago, alors qu’il accompagne le père d’un ami d’université sur la tombe de sa femme récemment disparue, et se fracture la mâchoire. La crise tant redoutée éclate, condensant tout ce que le roman annonçait: douleur, confusion, perte de repères, schisme intérieur. Pourtant, au milieu de cet effondrement, quelque chose demeure: la littérature. Malgré les illusions, les fantasmes d’abandon, le désir absurde de recommencer ailleurs, Zuckerman revient toujours à l’écriture. Les dernières lignes du roman le rappellent avec une lucidité presque cruelle: il n’échappera jamais au joug de ce qu’il est. L’écriture reste son destin, la seule force qui refuse de choir alors que tout le reste s’écroule.
« Écoute, Bobby, aucun désir particulier ne me pousse à me confesser ou à confesser les autres et c’est principalement à ça que le public s’est intéressé. Ce n’était pas une renommée littéraire, c’était une renommée sexuelle, et la renommée sexuelle c’est de la merde. Non, je serai heureux d’y renoncer. Le génie le plus enviable dans l’histoire de la littérature c’est le type qui a inventé les nouilles alphabet pour mettre dans la soupe : personne ne sait qui c’est. Il n’y a rien de plus usant que de devoir se balader en faisant semblant d’être l’auteur d’un de ses propres livres – sauf de faire semblant de ne pas l’être. »
Philip Roth, La leçon d’anatomie (1983), traduction: Jean-Pierre Carasso, revue par: Aurélie Guillain, Pléiade/Gallimard
Le cycle Nathan Zuckerman:
L’Orgie de Prague (1985)
La Contrevie (1986)
J’ai épousé un communiste (1998)
Exit le fantôme (2007)
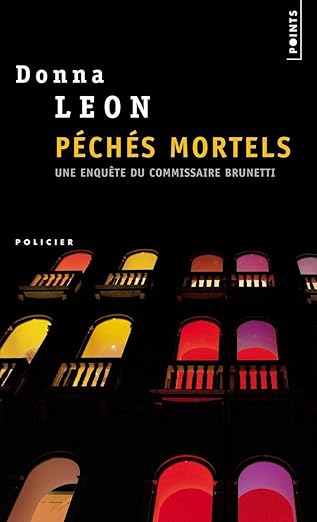
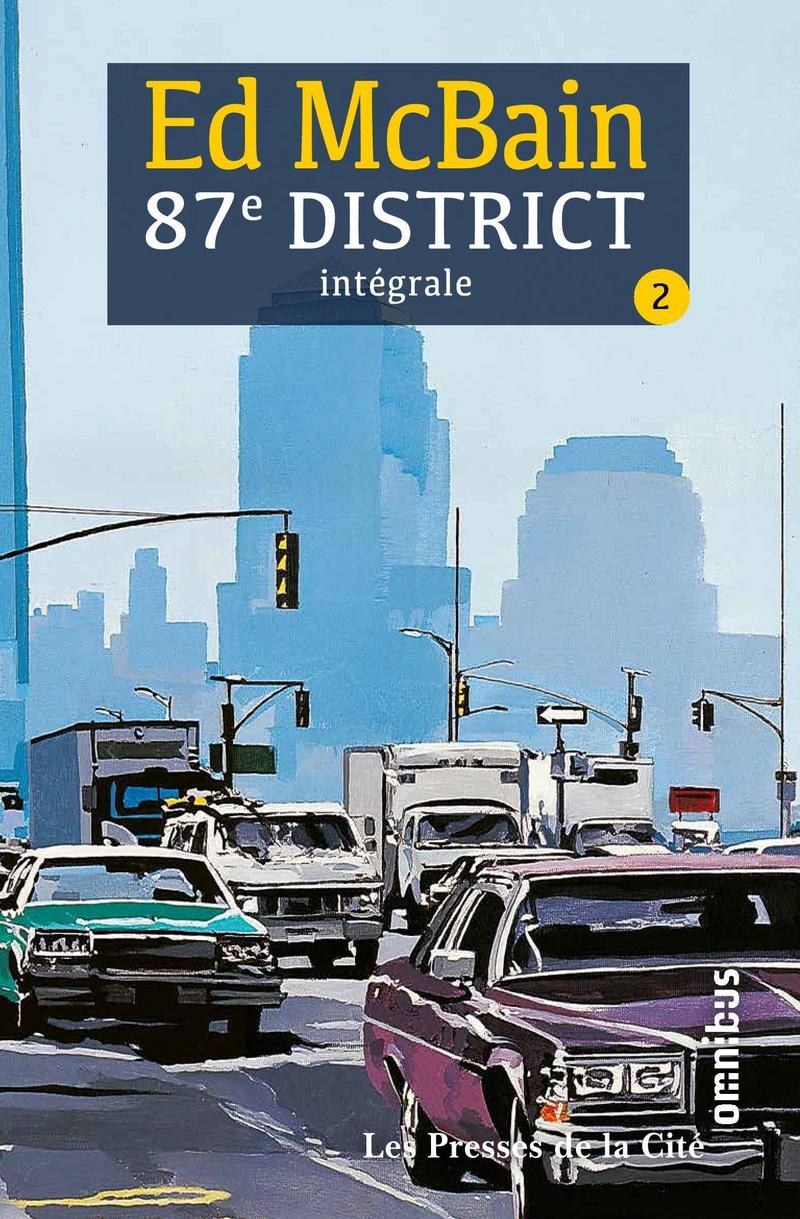
10 commentaires
Tania · 19 novembre 2025 à 15 h 57 min
Oui, cette Leçon d’anatomie est aussi une leçon de Roth sur la littérature, sur le pouvoir de l’écrivain – aussi diminué physiquement soit-il – à exprimer ses souffrances, ses jouissances, ses colères, ses contradictions même. Merci pour cet excellent billet de lecture qui me rappelle les heures intenses à lire les aventures de Zuckerman. Quel type !
Cléanthe · 19 novembre 2025 à 17 h 21 min
Je prends un plaisir immense à lire (et pour certains à relire) les romans de Philip Roth depuis qu’ils ont paru dans la Bibliothèque de la Pléiade. Du coup, j’ai un programme de lecture au moins pour les deux années qui viennent! Mais dans l’immédiat je vais m’efforcer d’abord de « boucler » le cycle Nathan Zuckerman. Celui-ci prend une toute autre cohérence à être lu ainsi à la suite et maintenant que le temps dont il parle est un peu retombé. Roth devient tout simplement un classique… 🙂
keisha · 20 novembre 2025 à 8 h 09 min
Je me promets de découvrir ce cycle, mais pas tout de suite. C’est chic de nous rappeler l’ordre, j’étais un peu perdue. Même si je doute d’en dire des choses aussi détaillées. Peu importe, d’ailleurs.
Cléanthe · 20 novembre 2025 à 11 h 34 min
Oui, peu importe, l’important, c’est de prendre plaisir à le lire.
alexandra · 20 novembre 2025 à 9 h 10 min
Si Keisha cherche une compagne de lecture dans cette aventure, je me joindrais peut-être à elle mais pas tout de suite non plus (j’aimerais élaguer ma PAL d’abord). J’ai lu au moins un des titres de la série (J’ai épousé un communiste), il y a bien longtemps. A l’époque, le titre m’avait semblé amusant et j’ignorais qu’il était rattaché à un cycle.
Cléanthe · 20 novembre 2025 à 11 h 35 min
Je suivrai avec plaisir vos lectures communes.
luocine · 21 novembre 2025 à 19 h 57 min
Ce romancier est un de ceux qui ne me déçoit jamais , en revanche je n’aime pas trop lire dans la Pléiade, papier bible trop fin et reliure trop souple, prix trop élevés ..
Cléanthe · 23 novembre 2025 à 16 h 33 min
Le prix en effet est une contrainte, d’autant que les volumes de la Pléiade ont eu tendance à bien augmenter ces dernières années – à cause en partie d’un lectorat moins nombreux. Eh oui, les éditions intégrales ne font plus rêver! Mais le papier bible ne me géne pas. Et surtout, l’apparat critique est de première qualité.
dasola · 27 novembre 2025 à 17 h 25 min
Bonsoir Cleanthe, il faudrait que je découvre les premières oeuvres de Philippe Roth. J’ai commencé à le lire avec Pastorale américaine et tous les autres qui ont suivi. C’est une collègue qui m’a donné envie de découvrir Philip Roth. Bonne soirée.
Cléanthe · 27 novembre 2025 à 18 h 54 min
Pastorale américaine reste mon préféré. Mais Roth y donne un autre tour à son personnage: plus en retrait, il se fait le témoin de la vie des autres, le porte voix de leur tragédie intérieure. La première série est plus nombrilique, plus centrée sur le personnage de Zuckerman, mais d’une certaine manière plus drôle aussi. Bonne soirée à toi aussi.