Philip ROTH: Zuckerman délivré
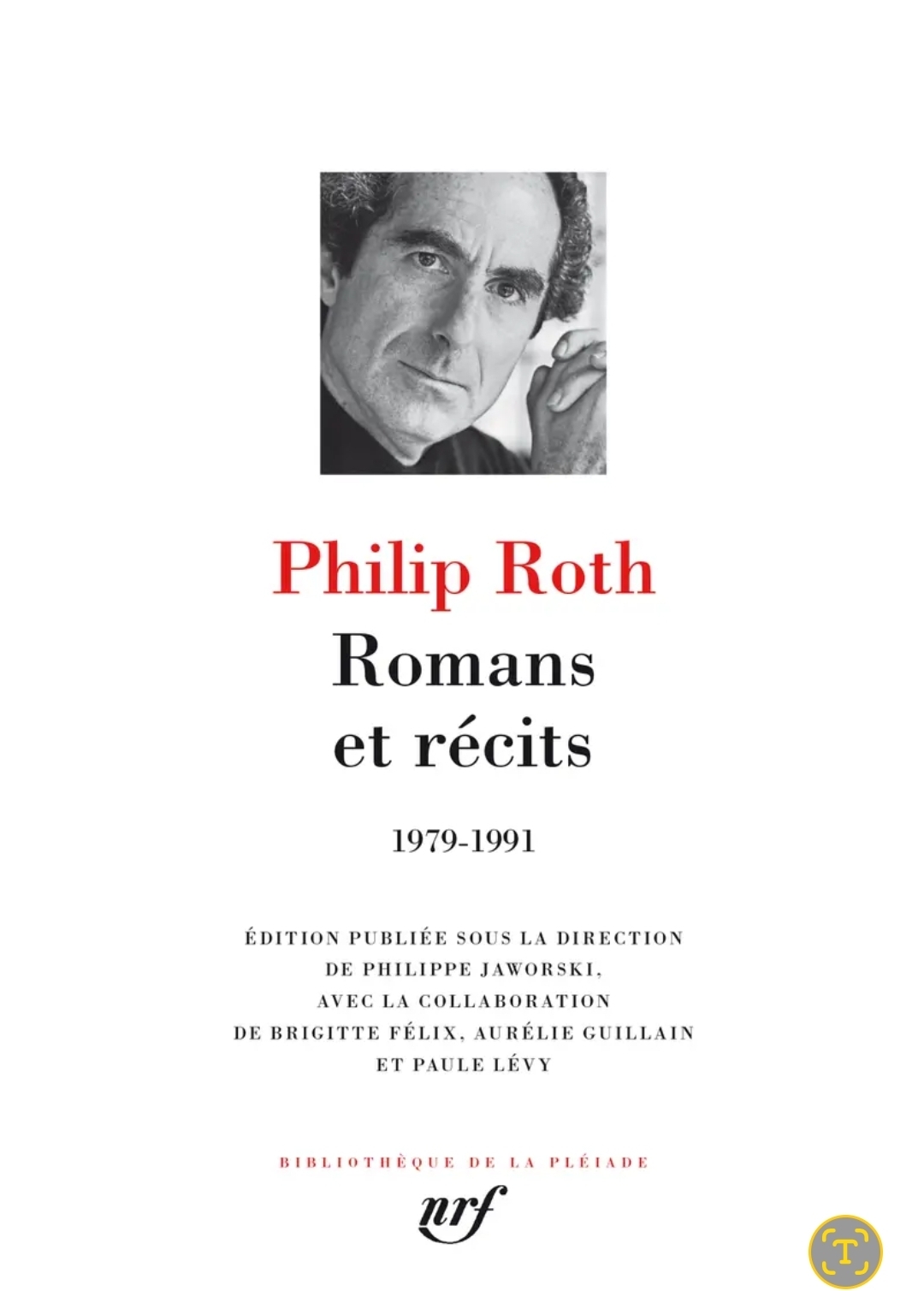
Dans un bus new-yorkais, Nathan Zuckerman, devenu célèbre grâce à un roman scandaleux qui a enflammé la presse et bouleversé sa communauté, se retrouve pris à partie par un jeune homme qui le reconnaît et l’apostrophe vigoureusement. Au sommet de la notoriété mais assiégé de toutes parts, l’écrivain est devenu la cible de lecteurs hostiles, d’admirateurs encombrants, qui lui écrivent ou qui lui téléphonent, de persécutions imaginaires. Plus possible de faire un pas sans qu’on lui parle de son roman. Les sous-entendus grivois abondent. La vie est devenue impossible! D’autant que Zuckerman, une nouvelle fois, est en plein divorce; qu’il n’a pas trouvé mieux que de s’installer, avec ses cartons de livres, dans un appartement au nord de Manhattan, avec vue sur une morgue. Et que son père, malade, risque lui aussi de mourir d’un instant à l’autre. On serait désorienté pour moins que cela…
Deuxième volume de la « trilogie Zuckerman » (trois romans et un épilogue réunis sous le titre de Zuckerman enchaîné), Zuckerman délivré trace le portrait d’un artiste pris dans le piège de son propre succès, érigé en icône malgré lui — et condamné à devenir le personnage de cette farce inquiétante. Car il s’agit bien d’une farce! Roman comique, Zuckerman délivré l’est d’abord en effet par sa manière d’envisager la condition de l’écrivain américain comme une chose qui prête essentiellement à rire. Car contrairement aux auteurs tchèques que, depuis le début de la décennie 1970, Roth a découvert à l’occasion de plusieurs voyages en Tchécoslovaquie, nouant des liens étroits avec plusieurs d’entre eux (Kundera notamment) et qu’il soutient en dirigeant chez Penguin une collection consacrée aux écrivains de cette autre Europe, Zuckerman n’est pas victime d’un régime totalitaire: la seule tyrannie qu’il subit est celle de la célébrité. Pressé qu’il est de toute part, incapable de s’isoler, contraint même de dîner face à sa propre image lorsqu’il allume la télévision, ses fantasmes de persécution, ses incohérences, ses obsessions deviennent rapidement matière à une comédie grinçante, où l’inflation des avis, conseils, réprimandes devient matière à narration.
Mais la drôlerie cache aussi une réflexion plus grave: le changement de statut de l’artiste à l’ère de la culture de masse a changé profondément la figure du grand écrivain. Rêvant d’un destin à la Henry James ou à la Thomas Mann, Zuckerman est d’abord l’auteur d’un best-seller: un succès de scandale, qu’il a bien cherché sans doute, mais qui le dépossède en partie de ses ambitions strictement littéraires. Car ce roman est aussi justement l’histoire d’une dépossession: celle de son roman par un public de lecteurs, d’une histoire dans laquelle chacun se projette. La scène inaugurale dans le bus ou encore son face-à-face avec Alvin Pepler — silhouette cauchemardesque de fan, à la fois ennemi, collaborateur et double de l’écrivain — révèlent cette tension entre prestige littéraire et vedettariat. Alvin, qui a grandi lui aussi à Newark, et qui fut pendant quelques semaines le champion d’un quizz télévisé, avec sa mémoire photographique, capable de citer de tête les dix principaux tubes de chaque année, incarne une version déformée du réalisme romanesque: il devient ainsi à la fois miroir et menace pour Zuckerman, peut-être même ce lecteur anonyme qui le harcèle au téléphone.
La notoriété a cependant aussi ses avantages. Trouvant dans la logorrhée d’Elvin Pepler un miroir à sa propre ambition d’écrivain réaliste à faire surgir la vie d’une accumulation de détails, Zuckerman note ses paroles, après chacune de leurs rencontres, entre amusement et effroi, relançant un temps sa créativité. La notoriété permet aussi de rencontrer des célébrités, de dîner avec elles, voire plus encore, telle Caesara O’Shea, vedette de cinéma, avec qui il passe la nuit, avant que celle-ci ne le plaque pour partir rejoindre Fidel Castro, son amant du moment.
Au-dela de la farce, Roth excelle dans ce roman, très éloigné du cadre intimiste du précédent, à rendre la théâtralité d’une ville de New York où, en cette fin des années 1960, tout devient mise en scène, spectacle, et où s’insinue peu à peu une certaine violence, conflagration de la situation politique et internationale contemporaine: dans la rue, sur les trottoirs, dans les bars, partout l’écrivain est confronté à des lecteurs exaltés. Qui peuvent vous admirer. Ou poser sur vous une cible. Et Zuckerman se voit au détour d’une phrase comme un nouveau Kennedy dans le viseur de Lee Harvey Oswald. Même si la paranoïa à laquelle cède Zuckerman est traitée par Philip Roth dans un registre de comédie, il n’empêche que le véritable cœur du récit est là: la rencontre déstabilisante avec le public. Comment continuer à écrire quand on est constamment interpellé, déformé, happé par ceux qui s’approprient vos mots ?
La fin donne au roman une gravité inattendue. Après tant de scènes de comédie, elle se clôt par un récit de deuil – celui du père de Nathan. Et un retour à Newark – autre récit de deuil -, sa ville natale, que j’ai trouvé particulièrement émouvant. A un homme qui traîne là et qui lui demande qui il est, Zuckerman, répond: «Personne » dans un écho aux propos d’Ulysse au cyclope. Non, Newark n’est pas Ithaque, mais tout au plus un passage, dont il faut s’éloigner et se libérer. Retourner à Newark, c’est se condamner à mesurer combien tout y a changé, combien la ville est devenue la négation d’elle-même et que la ville n’existe plus que dans le souvenir et les livres que Zuckerman peut en écrire. Un tournant proustien dans l’écriture de Philip Roth? C’est en tout cas comme cela que j’ai lu ce Zuckerman délivré.
« Ce que je voulais faire? Oh, j’étais moi aussi un bon petit garçon bien sage avec mon col rond et je croyais tout ce que m’avait appris Aristote sur la littérature. la tragédie épuise la pitié et la crainte en poussant ces émotions a leur paroxysme, et la comédie engendre dans le public insouciance et légèreté d’esprit en montrant aux spectateurs qu’il serait absurde de prendre au sérieux l’action représentée. Eh bien, Aristote m’a déçu. Il n’a fait aucune allusion au théâtre du ridicule où je joue maintenant un des rôles principaux – à cause de la littérature.
Philip Roth, Zukerman délivré (Zuckerman Unbond, 1981), traduction: Henri Rebillot, révisée par Aurélie Guillain, Pléiade/Gallimard
Le cycle Nathan Zuckerman:
L’Orgie de Prague (1985)
La Contrevie (1986)
J’ai épousé un communiste (1998)
Exit le fantôme (2007)
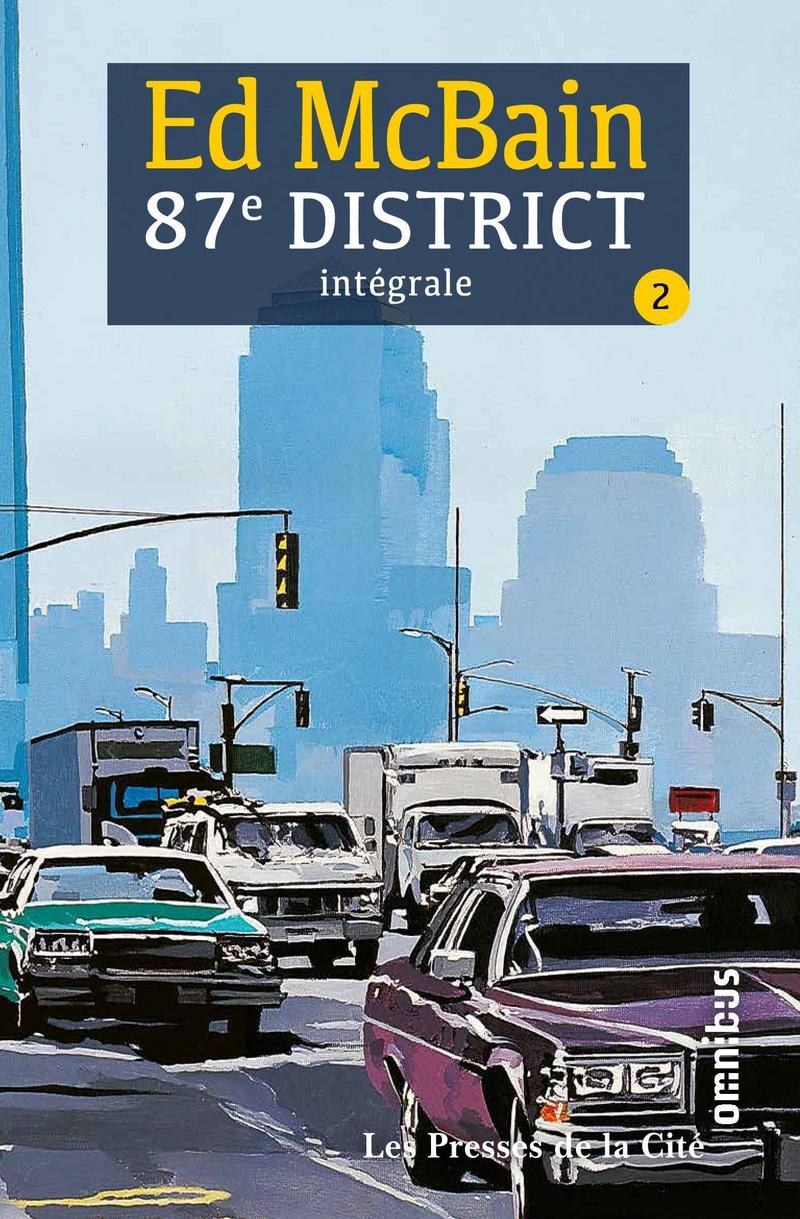
2 commentaires
Tania · 10 octobre 2025 à 15 h 01 min
Roth n’a pas reçu le prix Nobel dont on pensait chaque fois qu’il était un bon candidat, mais aujourd’hui je me réjouis qu’il aille à László Krasznahorkai – un grand écrivain hongrois que je ne lis que depuis un an à peine.
Cléanthe · 10 octobre 2025 à 16 h 36 min
Oui, j’ai l’impression que c’est un très bon prix Nobel. Je n’ai encore rien lu de lui, mais j’accumule depuis quelques temps plusieurs de ses livres. Je ne vais plus avoir d’excuse pour me lancer.