C.F. RAMUZ: Le Garçon savoyard
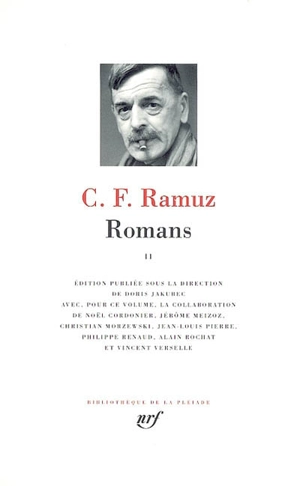
Joseph, jeune homme rêveur promis à Georgette, se sent déjà à l’étroit dans l’existence qu’on lui prépare. Pour voir autre chose, pour “changer”, il s’est engagé sur le lac à convoyer des marchandises entre la Savoie et Lausanne. Un soir, après le travail, alors qu’il se trouve sur la rive suisse, il quitte ses camarades et monte seul vers la ville, happé par les lumières. Il traverse les rues en pente, porté par une inquiétude confuse, jusqu’à se laisser entraîner vers une fête foraine où éclatent projecteurs, miroirs et musiques. Devant le cirque illuminé, le monde bascule: des continents peints, des bêtes fantastiques, et surtout une funembule suspendue dans les airs. C’est une rupture intime, l’instant où ce garçon promis à une existence tracée découvre la tentation vertigineuse d’une autre vie. Quand il revient sur la rive savoyarde, Joseph n’est plus vraiment le même…
Ramuz, écrivain majeur du 20e siècle, est un auteur qu’on lit peu, bien trop peu à mon goût. Je connaissais essentiellement jusqu’alors ses romans « valaisans »: La Grande Peur dans la montagne, Derborence… que je tiens pour des sommets de la littérature francophone du 20e siècle.. J’ai donc profité d’un court séjour à Lausanne, pour compléter ma découverte de l’auteur et me plonger dans ce roman peu connu d’un écrivain trop peu connu, merveilleusement habité par la présence du Léman. Derrière l’apparente simplicité d’une chronique lacustre, Ramuz y déploie une méditation implacable sur le désir d’absolu et sur l’impossibilité de vivre quand le monde réel ne suffit plus.
Le choix du titre en dit long. Ramuz a longtemps hésité avant d’arrêter Le Garçon savoyard, abandonnant des intitulés qui faisaient directement signe vers une quête de perfection ou une incapacité existentielle: L’Image de la perfection, Besoin de perfection, L’Impossibilité de vivre. Le titre définitif marque un déplacement décisif: les premiers romans de Ramuz, inspirés du genre du Bildungsroman, s’étaient faits une spécialité du portrait psychologique d’un individu singulier; Le Garçon savoyard sera l’histoire exemplaire d’un homme parmi d’autres, issu de ce peuple de mariniers, pêcheurs, vignerons et porteurs d’eau qui habitent son univers. Joseph Jacquet n’est pas un héros, mais une figure, presque un type,un simple, confronté à une expérience et à des questions qui le dépassent, le débordent. Et c’est précisément ce qui donne à son destin une portée tragique.
Dense et économe de moyens, le récit épouse une temporalité brève, resserrée sur quelques jours. Cette concentration donne au roman un air de chronique: un premier voyage à Lausanne, la nuit du cirque, le retour sur la Vaudaire, voilier bientôt remisé avec la mise en service des premiers navires à vapeur, un second départ, une bagarre au café du Petit Marin, l’égarement amoureux avec Mercédès, la nouvelle serveuse du café, la tentative de retour vers Georgette, puis la disparition du père Pinget, sa mort, la veillée, le meurtre, la fuite dans la montagne et, enfin, la noyade. Rien n’est précipité, mais tout s’enchaîne avec une logique inexorable. La brièveté du temps n’empêche pas la profondeur: chaque épisode agit comme une station dans un itinéraire intérieur.
Lausanne occupe dans ce parcours une place singulière. Elle n’est jamais présentée comme un lieu de salut ou d’accomplissement, mais comme l’endroit où surgit l’image de l’idéal. La rencontre avec le cirque constitue le véritable point de bascule du roman. Nomade, éclatant, artificiel, il offre à Joseph une vision du monde décomposée et recomposée, faite de fragments, de lumières, de miroirs, de corps suspendus. Ce n’est pas un hasard si Joseph est marinier: son existence est déjà faite de va-et-vient, de traversées incessantes d’une rive à l’autre. Le cirque ne fait que cristalliser cette oscillation permanente, cette incapacité à se fixer, à consentir à un monde trop étroit.
Sans doute parce qu’il n’est pas artiste, Joseph apparaît cependant comme un homme mal ajusté au réel. Il ne manque ni de sensibilité ni de désir, mais d’une faculté essentielle: celle d’adhérer pleinement à ce qui est. Tout chez lui semble légèrement décalé, comme s’il regardait le monde à travers un voile. La funambule du cirque, Miss Annabella – rencontre qui précipite toute la suite du récit, révèle ce malaise. Son apparition agit comme une secousse initiale, une promesse fulgurante d’élévation qui rend désormais tout le reste insuffisant. Que Ramuz ait confié cette révélation initiale à une danseuse de corde n’a rien d’anodin. Le cirque, avec ses artistes misérables et sublimes, le fascine, comme beaucoup d’artistes de son époque. Des plasticiens surtout. Le regard de Ramuz est résolument tourné vers les arts plastiques. Il voit dans le cirque une forme d’art extrême, capable d’atteindre une vérité plus haute que le réel ordinaire. Mais Le Garçon savoyard montre aussi l’envers de cette puissance: ce que l’art révèle peut devenir mortel pour celui qui n’a pas la force de revenir sur terre. Joseph n’est pas un artiste; il est un spectateur sans défense. Et c’est peut-être là, dans cette confusion fatale entre la vie et l’image, que réside la noirceur profonde et durable de ce roman.
À la vision lumineuse de la danseuse répond, plus tard, une autre expérience verticale, beaucoup plus sombre: la mort du père Pinget. Vieil homme attaché à un ordre ancien, incapable de supporter la disparition des repères qui structuraient son monde, il incarne une autre manière d’échapper au présent. Mais là où Annabella s’élèvait dans la lumière, Pinget s’abolit dans la chute, décidant d’en finir avec la vie en se pendant au bout d’une corde depuis un rocher dominant le lac. Entre ces deux figures, Joseph apprend que le monde n’offre ni permanence ni refuge, seulement le changement, la perte et l’usure.
Et les femmes que cotoie Joseph n’y pourront rien. Les femmes du roman, Annabella, Georgette et Mercédès, occupent pourtant une place centrale dans cette fable sur la fascination. Annabella, l’artiste de cirque, incarne la séduction absolue, consciente de son artifice. Georgette représente la stabilité, la terre, la loi d’un monde réglé par le devoir et la continuité. Mercédès, enfin, partage avec Joseph le désir de partir, mais elle tente aussi de lui ouvrir les yeux sur la fausseté de l’idéal qui l’obsède. Chacune, à sa manière, cherche à le ramener au réel. Toutes échouent. Car Le Garçon savoyard peut se lire comme une méditation sur le pouvoir trompeur des images. Joseph confond sans cesse le vrai et le réel, la beauté et l’existence. Il est incapable de supporter que l’idéal soit une construction, un leurre nécessaire mais dangereux. Même lorsque Mercédès s’efforce de le désillusionner, elle ne fait qu’accélérer sa chute: détruire l’idole revient, pour Joseph, à détruire le monde lui-même.
La scène finale pousse cette logique jusqu’à son terme. Réfugié dans la montagne, Joseph croit enfin accéder à une vérité débarrassée des faux-semblants. Le paysage lui apparaît purifié, comme éclairé de l’intérieur. Mais cette révélation est une illusion ultime. Ne pouvant réconcilier le monde tel qu’il est avec le monde tel qu’il le désire, Joseph choisit de s’abolir dans le lac. Sa noyade n’est ni un geste héroïque ni une libération: elle signe l’échec total d’une quête impossible.
Reste l’art — le roman lui-même — et cette expérience esthétique saisissante à laquelle Charles-Ferdinand Ramuz convie son lecteur. Elle suffirait à elle seule à dissiper tout malentendu: si son récit s’enracine dans une géographie précise (Lausanne, le lac Léman, la Savoie) Ramuz n’est en rien un écrivain régionaliste. Le local, chez lui, n’est pas une fin, encore moins le prétexte à des développements pittoresques, mais un dispositif tragique, une scène resserrée où se jouent des tensions universelles. Ramuz part du proche pour atteindre l’essentiel, du visible pour sonder l’invisible.
Cette ambition se lit dans la forme. Le premier chapitre, avec sa construction heurtée, son montage de perceptions discontinues, ses brusques changements de focale, relève presque d’une esthétique expressionniste, voire cubiste. On pense à l’ouverture de Berlin Alexanderplatz, tant Ramuz fragmente l’espace, superpose les sensations. Le monde n’est plus perçu comme une continuité, mais par éclats : lumières, bruits, mouvements, corps, fragments d’images qui s’entrechoquent. Cette dislocation formelle n’est pas un effet gratuit ; elle épouse l’état intérieur de Joseph et fait sentir au lecteur, physiquement, la perte d’un centre stable.
La peinture irrigue profondément cette écriture. Ramuz multiplie les visions plastiques: jeux de couleurs, contrastes violents, figures figées puis soudain animées, comme sorties d’une toile. Les projecteurs du cirque découpent les corps. Les paysages se composent par aplats. On songe à Hodler, à Vallotton, ces grands paysagistes suisses:
« vers l’ouest, venaient les vignes, avec leurs murs aux belles lignes, mis les uns au-dessus des autres, jaunâtres en ce matin de la fin de juillet, jaunâtres et gris, avec un peu de bleu, au-dessus de l’eau très bleue.
« L’eau n’avait plus été rose ; elle était verte, elle est devenue noire peu à peu. On avait vu, sur l’autre rive, des quantités de points de feu s’allumer tous ensemble, ce qui avait fait là-bas, le long de la rive, comme beaucoup de barres de lumière qui flottaient parallèlement sur l’eau tranquille. »
Les figures humaines semblent parfois peintes avant d’être vivantes. Ou ne sont que des silhouettes:
« Il y avait une femme qui était toute noire devant le lac faiblement éclairé, à cause de la lumière venant du café, passant par-dessous les platanes. »
Poétique, l’image assume sa proximité avec la peinture:
« Comme il continuait à faire sec, le père Taponnier continuait à faire ses voyages. Il allait jusqu’à la source qui sortait de terre au bas d’un pré où elle faisait une tache d’un vert cru, comme si on avait renversé un pot de couleur dans l’herbe brûlée ; il s’en revenait ensuite vers le village. »
Sous la plume de Ramuz, le monde est vu comme une surface à la fois fascinante et trompeuse, offerte au regard mais toujours menacée d’irréalité. Cette obsession de l’image n’est donc jamais décorative, mais est au cœur même de la réflexion du roman sur la fascination, l’illusion et la perte du réel.
La musique, enfin, joue un rôle tout aussi essentiel, accompagnant, mieux, structurant l’action. Pianos mécaniques, fanfares, orchestrions, rythmes répétitifs scandent la narration et lui imposent une cadence presque hypnotique. Un visage apparaît surmonté d’une portée de musique:
« Il faisait si chaud que Mme Jacquet avait ôté son mouchoir de tête rouge. On voyait son front qui était blanc au-dessus d’une figure brune ; trois grandes rides s’y marquaient comme une portée de musique. »
La phrase ramuzienne, avec ses reprises, ses variations, ses insistances, fonctionne elle-même comme une partition. Et le monde se transforme en instrument de musique:
« Les marches elles-mêmes, qui ne tenaient plus, s’enfonçaient drôlement sous votre poids comme des touches de piano. »
C’est dans cette alliance singulière de la forme et du sens que réside la grandeur du Garçon savoyard: un roman profondément ancré dans un lieu, mais tendu de toutes ses forces vers une tragédie humaine qui dépasse infiniment ses rives.
Où est-ce qu’il va? il ne sait pas bien : c’est que rien ne tient dans le monde. Il cède à son poids sur la pente; il se laisse aller à son poids. Il a été mené ainsi jusque sur le mur du quai; là, il est sous les etoiles. Il sort de dessous le plafond des platanes pour être sous un granc ciel où les étoiles bougent et il y en a qui ne bougent pas. Une petite bise fait clapoter faiblement, au pied du mur où il s’est assis, l’eau languissante qui est autour des deux chalands, qui se soulèvent à peine par moment et retombent, prolongés jusqu’au fond de l’eau par une espèce de mur noir. Plus loin, il y a des mâts qui montent jusque dans le ciel et bougent, comme quand avec une perche on cherche à abattre des fruits.
On causait de nouveau bruyamment dans le café : c’etait Clérici et les autres qui devaient être revenus, comme ils avaient dit qu’ils feraient. On se tait. Le piano mécanique joue un air; le temps passe.
Il était calme et triste, voilà tout. Il s’était assis sur le mur en face des chalands et de la Vaudaire, qui sont aux hommes : alors ils se servent du vent qui est une force pas à eux, puis ils s’inventent une force à eux. D’abord ils ne font qu’emprunter par des voiles au bord extrême du mouvement de l’air qui se fait sans eux et au-dessus d’eux, courant en grand désordre à cinq ou six sur le pont; puis il a un homme qui est assis devant un cadran. Tout change. Et il y a un petit vieux qui ne peut plus changer. Tout change et meurt, voila les hommes, c’est ce qu’il se disait, regardant les étoiles bouger la-haut comme elles font depuis toujours et pour toujours, dans le repos, et l’eau venir et s’en aller avec repos; parce qu’on ne se repose pas, nous, les hommes. Mais il en a une, quelque part (c’est ce gu’il se dit) qui oh ! tellement légère, tellement au-dessus de nous. Il y en a une quand même qui ne change peut-être pas, étant parmi les choses qui durent; ou bien est-ce que j’ai rêvé? »
C.F. RAMUZ, Le Garçon savoyard, chapitre IX



0 commentaire