Orhan PAMUK: Mon nom est rouge
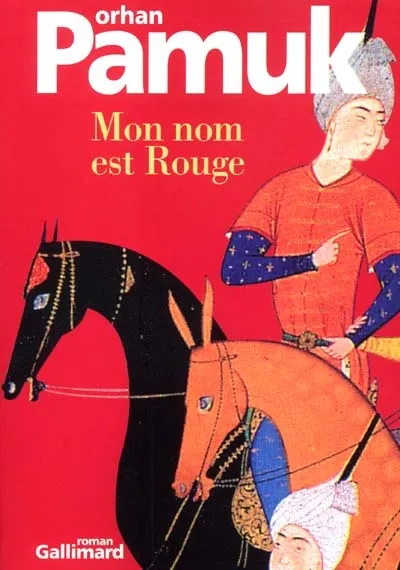
Dans les rues d’Istanbul, en cet hiver 1591, la neige semble avoir avalé les couleurs. Et pourtant, sous cette blancheur silencieuse, un homme est mort, et sa voix — chose impossible — nous parle depuis le fond du puits où son corps a été jeté. Ce mort, c’est un enlumineur. Un artisan de l’image. Et ce qu’il a vu, ce qu’il savait, ce qu’il allait peut-être révéler, menace de faire basculer tout un monde. Ce monde, c’est celui des ateliers impériaux à la fin du XVIᵉ siècle, au temps du sultan Murat III. Un monde de patience et de discipline, de lignes fines et de pigments précieux, où l’on apprend à dessiner non pas pour s’affirmer, mais pour s’effacer, imiter les maîtres anciens, répéter les formes, tendre vers l’idéal d’une image qui ne doit rien à la singularité d’un regard. Dans la miniature ottomane, l’artiste n’est pas un génie original, il n’invente pas, il ne met pas en avant sa singularité. Il est la main de la tradition, se nourrissant de l’exemple des grands maîtres passés dont il a assimilé les formes. Et c’est justement cette logique, presque mystique, qui vacille quand l’atelier se trouve confronté à une tentation venue d’Occident: la perspective, le portrait, la ressemblance, autrement dit l’idée scandaleuse que l’image pourrait devenir un miroir — et que l’homme pourrait s’y reconnaître…
J’ai acheté Mon nom est rouge à sa sortie, ce devait être au début des années 2000. J’étais sûr d’aimer ce livre. Et cela n’a pas manqué. Je sors tout enthousiaste de cette lecture, où se mêlent contes, roman historique, histoire sentimentale, intrigue policière, ainsi qu’une puissante réflexion sur la peinture, nourrie de l’art des miniaturistes perses et ottomans. Le roman d’Orhan Pamuk m’aura simplement attendu pendant bien des années. Mais j’aime aussi remplir ma bibliothèque de livres dont je sais que j’y prendrai un plaisir intense, et que je prends le temps d’ouvrir. Sinon, à quoi sert une bibliothèque? Bref, cette étape stanbouliote des Escapades européennes aura été l’occasion qu’il me fallait. (Oserai-je confesser que je n’ai pas choisi Istanbul pour rien et que j’avais déjà ma petite idée en proposant l’étape de ce mois-ci?)
Dans l’Istanbul de la fin du 16e siècle, un homme, donc, un enlumineur est tué, pour une obscure histoire qui a à voir avec l’art de la miniature, l’influence de l’art vénitien et la montée du fondamentalisme religieux. A partir de cette intrigue, Pamuk construit son roman comme une enquête policière. Une enquête d’un genre particulier cependant. Monsieur Délicat a été tué, sans doute par l’un des trois grands peintres – Olive, Cigogne ou Papillon – de l’Atelier du sultan que conduit Maître Osman, et qui ont participé en secret à l’élaboration d’un manuscrit mystérieux dirigée par monsieur l’Oncle, ambassadeur de l’empire ottoman à Venise et amateur de peinture occidentale. Il y a bien un meurtrier. L’intrigue avance au rythme des soupçons, des rivalités, des confidences arrachées dans l’ombre. Mais à mesure qu’on progresse, l’évidence s’impose que le véritable crime est peut-être ailleurs: dans la question même de ce que l’on a le droit de représenter. Dans le danger de la ressemblance. Dans la possibilité que le dessin devienne une signature, et la signature un orgueil.
À cette dispute esthétique sous forme d’une intrigue policière, s’ajoute une tension plus intime, sentimentale: celle de Le Noir, revenu à Istanbul après douze années d’exil, appelé par Monsieur l’Oncle, pour travailler sur le mystérieux livre secret commandé par le sultan. Mais en retournant à Istanbul, Le Noir revient aussi vers un passé qu’il n’a jamais tout à fait quitté et qui a pour nom Shékuré, la femme qu’il a aimée, qu’il retrouve enfermée dans une vie incertaine, entre un mari disparu à la guerre et une belle-famille menaçante, et qu’il rêve toujours d’épouser. Et l’on sent très vite que l’enquête criminelle et l’intrigue amoureuse se répondent. Il s’agit de déchiffrer des signes, de deviner derrière les apparences, de savoir qui ment — et pourquoi, d’autant que dans leurs amours Le Noir et Shékuré font singulièrement penser à ces héros de la poésie persane, dont se nourrissent justement les peintres de miniatures.
Singulier dans son propos, Mon nom est Rouge, l’est aussi dans sa forme: un roman polyphonique où chaque chapitre donne la parole à un narrateur différent: Le Noir, Shékuré, les enlumineurs, l’oncle, Esther l’entremetteuse, le meurtrier lui-même… mais aussi un chien, un arbre, une pièce de monnaie, la couleur rouge, et même le diable! Ce procédé à lui seul rend le roman passionnant. Aussi bien dans les débats sur la peinture, qu’il rapporte avec minutie (et qui m’ont donné sacrément envie de me pencher sérieusement sur l’histoire de la miniature perse et ottomane!) que dans le cours de l’intrigue policière ou de l’aventure amoureuse (le lecteur cherchant des indices dans les discours qui lui sont proposés), Pamuk se sert de la multiplication des voix narratives pour rappeler que tout justement est affaire de point de vue, que toute vérité dépend d’un regard, et que le récit — comme l’image — est une construction. La voix du chien, notamment, est un moment saisissant: elle raille les hommes, leurs prétentions, leurs dogmes. La voix du diable aussi, retournant avec espièglerie contre eux-mêmes les obsessions de pureté des tenants d’un Islam radical. Ou bien la voix de la femme, offrant au vieux conteur qui l’incarne une expérience de travesti, qui est l’autre grand pouvoir de la littérature: ouvrir des passages entre des identités trop cloisonnées. L’espièglerie de Pamuk est certaine. Et c’est un autre des plaisirs de ce grand roman.
Et puis il y a Istanbul, bien sûr. Non pas la carte postale, mais la ville vivante, dangereuse, stratifiée: les ruelles, les mosquées, les maisons où l’on se cache, les ateliers où l’on complote, les cafés où l’on raconte des histoires, les ombres qui se déplacent dans la neige et le palais du sultan, Palais de la porte des canons (ou Topkapi), renfermant des trésors de livres, d’images dont l’exploration offre un des grands moments du roman. Car la ville est un théâtre où tout peut arriver, et où l’on passe sans transition de la beauté la plus délicate à la violence la plus brutale. Grand romancier d’Istanbul, sa ville, qu’il explore de livre en livre, depuis près de cinquante ans, Pamuk excelle à faire sentir cette coexistence: l’enluminure la plus raffinée, tracée au pinceau avec une précision infinie, côtoie la peur, la jalousie, la menace d’un couteau dans une ruelle ou la pratique de la torture par le pouvoir.
La situation particulière d’Istanbul, au carrefour de plusieurs mondes, aux portes de l’Asie et de l’Europe, entre Orient et Occident occupe une place centrale dans le roman. Roman des seuils historiques, culturels, géographiques, Mon nom est Rouge est d’abord un roman sur le regard. Sur le regard et sur ce qu’il coûte. Regarder autrement, peindre autrement, raconter autrement, c’est s’exposer. C’est risquer d’être accusé d’hérésie, de trahison, de vanité. C’est risquer aussi d’être seul. Ainsi Venise (l’Occident), vers laquelle se tournent tous les regards du roman n’est pas seulement un ailleurs géographique: elle devient une métaphore de la singularité moderne, de l’individu qui se détache du collectif, avec sa passion pour le portrait et la ressemblance, une métaphore de l’artiste qui veut être reconnu comme un auteur. Cela aurait pu donner lieu à un débat idéologique, à une fausse littérature d’engagement, qu’on ne trouvera jamais sous cette forme caricaturale chez un écrivain aussi fin qu’Orhan Pamuk, et tellement attaché à la singularité de sa Turquie natale. Plutôt que de trancher entre Orient et Occident, le roman historique permet plutôt d’explorer une fracture, un moment de bascule, une zone de trouble où deux conceptions du monde se heurtent sans pouvoir se comprendre pleinement.
On comprendra donc que par dessus tout Mon nom est Rouge est traversé par une nostalgie sourde, une özlem, sentiment dont Pamuk a fait l’un des motifs principaux de son oeuvre. L’özlem en effet est l’un des nombreux termes par lesquels les différentes langues désignent la nostalgie, mais qui d’une langue à l’autre ne signifient jamais exactement la même chose: à côté de la saudade portugaise, de la Sehnsucht allemande ou de la tęsknota polonaise, et un peu différemment d’elles donc, l’özlem turque ne désigne pas d’abord le regret d’un passé perdu, mais surtout le sentiment d’un manque qui colle à la peau, d’une absence qui devient une manière d’habiter le monde, d’une langueur occupée de ce qui n’est plus là. On la sent dans la neige qui, en cet hiver de la fin du 16e siècle, tombe sur Istanbul, dans la mélancolie des ruelles et des intérieurs, mais surtout dans l’angoisse des enlumineurs face à la fin d’un art. Car en cette fin de 16è siècle, la beauté de la peinture est déjà un souvenir. Dans leurs ateliers, les peintres travaillent comme si l’âge d’or était derrière eux, comme si chaque miniature portait, en secret, le pressentiment de sa propre disparition. L’özlem, ici, n’est donc pas seulement personnelle (celle de Le Noir par exemple revenant vers Shékuré, celle d’un amour resté suspendu), elle est historique, collective, elle est la nostalgie d’un monde où l’image n’était pas encore “moderne”, où l’artiste pouvait s’effacer derrière la tradition, où l’on croyait encore que peindre consistait à se rapprocher de la vision de Dieu, et non à imposer la sienne. Cette nostalgie n’idéalise pas; elle est douloureuse, ambiguë, presque coupable, parce qu’elle sait que le passé était aussi fait de contraintes, de peur et de violence — mais elle demeure, malgré tout, comme une fidélité intime à ce qui s’éloigne. Chez Pamuk, l’özlem est la couleur secrète sous le rouge: la teinte de ce qui se perd au moment même où on le touche.
« Le monde m’est apparu soudain comme un immense palais dont les pièces communiquent entre elles par mille portes grandes ouvertes: et nous étions surement capables de passer d’une pièce à l’autre par la grâce de la mémoire et de notre imagination. Mais la plupart des gens sont trop paresseux pour faire usage de ce don, et préfèrent rester cloîtrés dans une seule et même pièce. »
Orhan PAMUK, Mon nom est rouge (Benim adim kirmizi, 1998), traduction Gilles Authier
Billet publié dans le cadre des
Escapades en Europe – décembre 25: Contes et contes de fées

Les autres participants:
Tullia – Jason GOODWIN: Le Complot des janissaires
Nathalie – Orham PAMUK: Istanbul et Serge GRUZINSKI: Quelle heure est-il là-bas?
Tadloiduciné – William HAYES: Midnight express
Nathalie (Délivrer des livres) – Elif SHAFAK: La bâtarde d’Istanbul

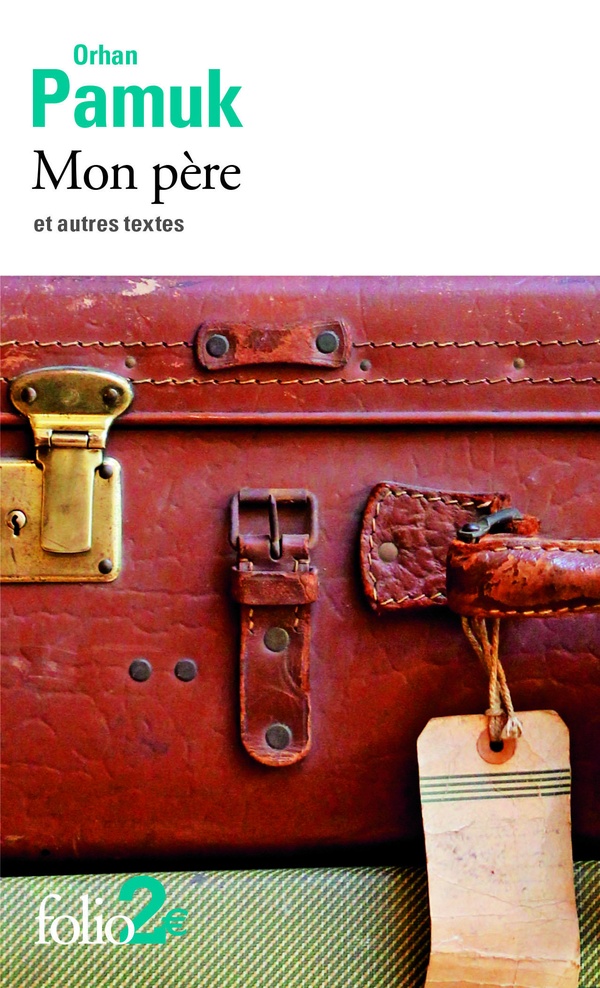
16 commentaires
nathalie · 15 janvier 2026 à 12 h 42 min
Ahhhhh tu as donc lu ce roman que deux personnes me recommandent en commentaire de mon billet ! J’y vois un signe, je crois que je ne vais pas tarder à me le procurer. Un ami m’a aussi parlé du Livre noir, je ne sais pas si tu l’as lu.
Bref, merci pour ce beau billet.
Cléanthe · 15 janvier 2026 à 13 h 54 min
Cela fait longtemps que je tourne autour de l’oeuvre de Pamuk. Mais c’est le premier que je lis. Le Livre Noir, avec Istanbul, est sur ma liste.
Ingannmic · 15 janvier 2026 à 14 h 08 min
Bon, j’ai fait faux bond ce mois ci encore, je n’ai rien trouvé qui me faisait envie sur la thématique, et entre l’Hiver polar, les gravillons, et les lectures de l’Holocauste, j’avais déjà programmé pas mal de lectures… j’hésite à recruter une assistante ! 🙂
Allez, trêve de plaisanterie, il a l’air très bien en fait celui-là, et en février, je serai des vôtres !
Cléanthe · 15 janvier 2026 à 14 h 32 min
Tu as raison, cela devient presque une activité à plein temps tous ces challenges! 😉 Istanbul a peu inspiré apparemment. Nous serons sans doute plus nombreux le mois prochain.
tadoiducine · 15 janvier 2026 à 17 h 15 min
Bonjour Cléanthe
Bravo pour ce billet publié dans le cadre d’Istanbul (sans être un conte de fées).
Il me semble que le livre pourrait aussi s’inscrire dans tel ou tel des challenges « polar » qui se déroulent actuellement…
Pour ma part, je suis plus contemporain (quoique déjà un demi-siècle se soit écoulé!) en parlant de Midnight express (https://dasola.canalblog.com/2026/01/15/midnight-express-william-hayes.html).
(s) ta d loi du cine, « squatter » chez dasola
Cléanthe · 22 janvier 2026 à 12 h 48 min
Je viens repêcher tes billets dans les spams. Pour les challenges polars, oui, j’y participe aussi, même si je n’ai pas mis le logo sur ce billet-ci.
Alexandra · 15 janvier 2026 à 17 h 40 min
Oh comme je comprends ton enthousiasme ! Contrairement à toi, j’ai lu cet ouvrage dès sa sortie (ce qui fait très longtemps) mais je me souviens d’avoir grandement apprécié cette lecture. Ce roman original m’a incitée à lire d’autres livres de Pamuk que j’ai trouvé plaisants aussi. Je regrette d’avoir raté le RDV du mois mais je n’ai pas trouvé d’idée de lecture pour me joindre à vous.
Cléanthe · 16 janvier 2026 à 12 h 59 min
L’étape de ce mois-ci n’a pas attiré grand monde. Mais je ne suis pas mécontent d’avoir enfin pu lire ce roman de Pamuk qui m’attendait sur mes étagères depuis si longtemps.
aifelle · 17 janvier 2026 à 6 h 53 min
Un auteur que je veux lire depuis longtemps mais je ne l’ai pas encore fait. J’espère y arrive un jour même si les challenges n’arrangent rien côté envies exponentielles ..
Cléanthe · 18 janvier 2026 à 22 h 19 min
Oui, les challenges, c’est terrible pour les envies! 🙂
tadloiducine · 17 janvier 2026 à 9 h 12 min
Bonjour Cléanthe
J’insiste peut-être trop, mais j’ai posté plusieurs commentaires sur ton blog pour signaler ma propre contribution du 15 janvier sur le blog de dasola, et je ne les vois pas publiés chez toi…
Passé en SPAM sans que tu les aies vus? Blacklistés via tel ou tel algorithme (moi ou l’oeuvre en question)?
(s) ta d loi du cine, « squatter » chez dasola
Cléanthe · 18 janvier 2026 à 22 h 12 min
Désolé, je n’ai pas vu tes commentaires ! Ils ont sans doute basculé en spam. Je rajoute immédiatement le lien vers ton billet… et comme les derniers jours ont été chargés pour moi et que j’attends jusqu’à demain pour rédiger le billet recap, tu pourras en faire partie ce mois-ci!
Nathalie · 18 janvier 2026 à 21 h 17 min
Ouch, j’ai raté la date. J’essaie de terminer mon billet demain. J’ai lu et beaucoup aimé « La bâtarde d’Istanbul » d’Elif Shafak dont je découvrais à cette occasion la plume vivante et drôle !
Cléanthe · 18 janvier 2026 à 22 h 16 min
Les derniers jours ont été bien remplis de mon côté, du coup je ne publierai que demain mon billet recap.
claudialucia · 24 janvier 2026 à 14 h 28 min
Un livre très intéressant que j’ai lu à sa sortie mais qu’il me faudrait relire depuis !
Cléanthe · 28 janvier 2026 à 11 h 52 min
J’ai attendu pour le lire, mais je ne suis pas déçu de cette lecture.