Ismaïl KADARÉ: Avril brisé
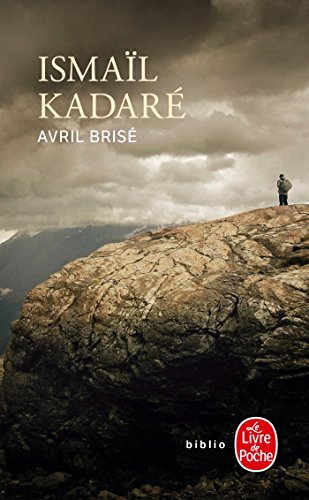
Dans le haut plateau du Rrafsh, au nord de l’Albanie, le jeune Gjorg, vingt-six ans, vient d’accomplir l’acte qui scelle son destin: il a tué, pour laver l’honneur de sa famille, selon les préceptes séculaires du Kanun. Dans le froid du matin, au milieu d’un silence presque rituel, il a tiré sur son ennemi. Et aussitôt, sans joie, sans rage, il comprend que son geste n’ouvre pas une vie nouvelle. Dès qu’il aura payé le «droit de sang» en or à la tour des gardiens du Kanun, il devra attendre, pour être à son tour abattu, le moment où la famille adverse, libérée par la mort de leur parent, viendra réclamer sa revanche. Cette suspension terrible, ce répit dérisoire, cette parenthèse d’avril que la tradition laisse aux condamnés avant que la haute saison des vendettas ne reprenne, voilà tout ce qu’il lui reste…
J’avais gardé un excellent souvenir de ma lecture de L’Hiver de la grande solitude l’an dernier: un roman politique d’une puissance rare, écrit au cœur d’un climat d’oppression où l’élan esthétique se heurte sans cesse aux contraintes d’un pouvoir soupçonneux. Autant dire que je brûlais de découvrir une autre facette de l’œuvre de Kadaré. Et je n’ai pas été déçu : avec Avril brisé, changement total d’atmosphère. Le lecteur est immédiatement projeté dans un monde presque hors du temps. Certes, quelques allusions laissent entendre que l’action se déroule à l’époque de la monarchie, donc au début du XXᵉ siècle, mais ces repères historiques semblent vite s’effacer devant la puissance d’un décor archaïque. Sur ces hauts plateaux albanais règne une forme d’intemporalité, qui plonge ses racines dans un Moyen Âge encore vivant, et au-delà, dans une mémoire plus ancienne, presque épique, où l’on croirait entendre résonner la voix d’Homère. Ce paysage austère, ces lois ancestrales, cette conception du destin composent un climat où le tragique affleure à chaque pas.
Tout le roman se déploie à partir de ce moment inaugural: un geste imposé, dicté par la coutume, et dont la portée tragique enveloppe déjà Gjorg. La précision glacée avec laquelle Kadaré décrit le meurtre, puis la marche vers la kulla d’Orosh, où doit être versé le tribu du sang, donne au texte une dimension quasi mythique. Rien de psychologique, ni passionnel, rien d’accidentel: tout obéit à un réseau de règles implacables qui, loin d’apaiser les conflits, les reproduit indéfiniment. Le Kanun n’est pas seulement une loi ancienne, c’est une machine à fabriquer de la mort, où chaque acte engendre un autre acte, où chaque vie se tient au bord d’un précipice invisible mais toujours présent, et qui pèse sur les habitants de ces hauts plateaux sans qu’aucun – ce serait se déshonorer – ne songe à s’y soustraire.
La seconde ligne narrative vient rompre brutalement ce fatalisme: un jeune couple venu de Tirana, Bessian et Diane Vorpsi, intellectuels raffinés qui entreprennent une sorte de voyage de noces ethnographique au cœur des montagnes du Nord, fascinés par les légendes et les coutumes d’une Albanie immémoriale qu’ils imaginent volontiers pittoresque. Leur regard extérieur, romantique et naïf, crée d’emblée un double contraste: d’un côté, la modernité citadine face à l’archaïsme montagnard; de l’autre, la violence réelle des vendettas face au mythe littéraire qu’ils projettent sur ces terres. Kadaré joue admirablement de cette ironie: ce que le couple observe comme un folklore vivant n’est pour Gjorg qu’une condamnation sans recours. Et le lecteur lui-même, happé au début du roman par la beauté sévère de ce monde régi par des lois ancestrales, par ce climat d’épopée antique qui enveloppe les soixante premières pages, se trouve soudain ramené à lui-même. À travers les yeux de ces deux touristes fascinés par ce qui n’est d’abord pour eux qu’un spectacle troublant, il est invité à interroger le romantisme de son propre regard et la manière dont il abordait ce texte.
L’ingénieux dispositif romanesque permet alors un jeu de miroirs saisissant. Tandis que Gjorg erre dans un temps suspendu, guettant des signes, observant les cycles de la vie qu’il ne connaîtra plus, le couple se tend, les deux époux s’éloignent, et Diane découvre peu à peu que la fascination esthétique qu’éprouve son mari pour le Kanun confine au morbide. Le voyage de noces devient une traversée de l’ombre. Diane observe les hommes qui vivent dans la crainte permanente, entend des récits où l’exaltation de l’honneur masque la destruction systématique des familles, et perçoit, de manière confuse mais poignante, le destin de Gjorg qui croise fugitivement son chemin.
L’un des moments les plus marquants du roman est d’ailleurs cette scène brève et silencieuse où, l’espace d’un instant, les regards de Gjorg et de Diane se croisent: un éclair presque irréel, suspendu au milieu de la fatalité. Pour Diane, ce regard, venu d’un homme déjà promis à la mort, agit comme une déchirure intime, un appel muet qui fissure l’imaginaire romantique que son mari entretenait autour du Kanun. Pour Gjorg, c’est la révélation fulgurante d’un autre monde possible, un monde où l’on pourrait vivre selon d’autres lois que celles du sang, et qu’incarne la beauté de la jeune femme à la recherche de laquelle il va consacrer ses dernières journées de liberté. Ce très court moment, que Kadaré décrit avec une sobriété bouleversante, ouvre une brèche dans le cercle étroit de la vendetta: une étincelle d’humanité qui ne change rien aux règles, mais qui change tout à la perception qu’en ont ceux qui les subissent ou les contemplent. C’est peut-être là que le roman atteint sa plus grande profondeur, dans cette rencontre qui ne peut rien empêcher, mais qui fait soudain sentir ce que la tradition détruit: la possibilité d’une vie qui ne serait pas immédiatement vouée au sacrifice.
D’autres scènes fortes scandent le récit: la visite de Gjorg à la tour de l’Hospitalité, où l’on paie le droit de sang comme on règle une dette administrative – car après tout le prix du sang est aussi un commerce; la conversation fascinée de Bessian avec un érudit du Kanun, autour de la beauté formelle des articles qui codifient la mort; la lente montée vers l’inéluctable qui ponctue les derniers jours de Gjorg. Ces épisodes, très visuels, donnent au roman une puissance presque cinématographique: on y sent les pierres, la lumière dure, la poussière, la pluie, les silhouettes des hommes armés qui apparaissent dans un chemin.
C’est cet aspect sensible, presque charnel du récit qui donne toute sa force à la méditation d’Avril brisé sur la manière dont une société peut ériger la mort en système, sacraliser le sang, perpétuer le mal tout en le recouvrant d’un vernis de légitimité. La voix narrative, tour à tour précise et poétique, réaliste et mythique, rend cette critique d’autant plus implacable que, comme je le disais plus haut, elle en épouse d’abord la beauté extérieure.
« Gjorg tressaillit. Il regarda autour de lui, sans trop savoir pourquoi. C’était une salle d’auberge, malpropre, avec une âcre odeur de fumée et de laine mouillée, et,comme si cela n’avait pas suffi, la bouche qui parlait de cette femme émettait en même temps que ses mots une mauvaise odeur de tabac et d’oignon. Gjorg tourna les yeux dans tous les sens comme pour dire: mais attendez donc; cet endroit est-il digne qu’on y évoque son nom? Mais ils continuaient de parler, de rire. Gjorg resta comme pris à un piège, dans un état intermédiaire entre l’audition et la non-audition, avec un bourdonnement dans ses oreilles. Et, subitement, se révéla à lui dans toute sa clarté la raison pour laquelle il avait entrepris ce voyage. Il avait voulu se la cacher. Il l’avait chassée obstinément de son esprit, l’avait refoulée, Mais la raison était là, juste au centre de son être: s’il s’était mis en route, ce n’était pas pour contempler les montagnes, mais avant tout pour revoir cette femme. Il avait cherché, sans savoir lui-même pourquoi, cette voiture aux formes contournées, qui roulait, roulait constamment à travers le Plateau, pendant que lui, de loin, lui murmurait: «Pourquoi erres-tu dans ces parages, voiture-papillon?» En réalité, avec son aspect morne, ses poignées de portière en bronze et ses lignes compliquées, elle lui rappelait un cercueil qu’il avait vu naguère, au cours de son seul voyage à Shkodër, dans la Grande Eglise, entre un cortège funèbre et une grave musique d’orgue. Et à l’intérieur de cette voiture, cercueil-libellule, se trouvait le regard de cette femme aux cheveux châtains, qui l’avait aspiré avec une douceur et une émotion qu’il n’avait ressenties au contact d’aucun être au monde. Il avait fixé bien des yeux de femmes dans sa vie et beaucoup de ces yeux ardents, pudiques, troublants, délicats, rusés ou fiers, l’avaient aussi fixé, mais jamais de tels yeux. Ils étaient à la fois distants et proches, compréhensibles et énigmatiques, insensibles et compatissants. Ce regard, en même temps qu’il éveillait le désir, avait quelque chose qui vous éteignait, vous transportait au loin, au-delà de la vie, au-delà de la tombe, d’où l’on pouvait se regarder avec sérénité.
Au cours de ses nuits (que des tronçons de sommeil s’efforçaient de remplir de façon désordonnée, comme les rares étoiles cherchent à peupler un ciel sombre d’automne), ce regard était la seule chose que son sommeil n’effaçait pas. Il restait là au milieu de lui, brillant perdu, pour la création duquel toute la lumière du monde avait été consumée.Oui, c’était pour rencontrer encore une fois ces yeux qu’il s’était mis en route à travers le Grand Plateau. »
Ismaïl Kadaré, Avril brisé (Prilli i thyer, 1980), traduction Jusuf Vrioni, Fayard, Livre de poche
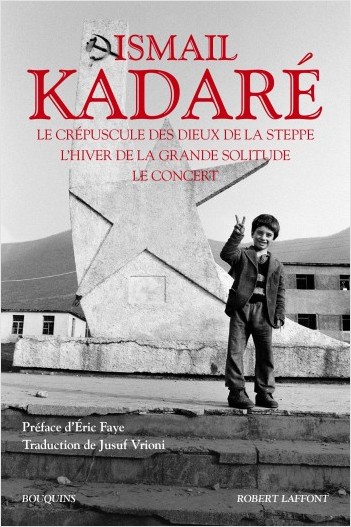
10 commentaires
Aifelle · 11 décembre 2025 à 6 h 48 min
De cet auteur je n’ai lu que « le grand hiver » (autre titre de « l’hiver de la grande solitude ». Je me promettais de continuer et puis je n’ai pas trouvé le temps. Je note « avril brisé » si jamais j’en ai l’occasion.
Cléanthe · 11 décembre 2025 à 15 h 45 min
Je l’ai trouvé d’une lecture plus aisée. Et l’évocation des plateaux du nord de l’Albanie est vraiment fascinante.
nathalie · 11 décembre 2025 à 7 h 36 min
J’avais beaucoup aimé également mais ton billet dépasse largement le mien. Il me donne envie de le relire. Décidément un grand auteur.
Cléanthe · 11 décembre 2025 à 15 h 44 min
Un très grand auteur en effet. Heureusement, il reste tant à découvrir encore.
Alexandra · 11 décembre 2025 à 8 h 50 min
Les ouvrages d’Ismaël Kadaré ne sont pas toujours faciles à lire (je pense par exemple au Général de l’armée morte) mais ils valent le coup de se donner un peu de mal !
Cléanthe · 11 décembre 2025 à 15 h 43 min
J’avais trouvé le précédent passionnant, mais un peu rugueux en effet, ce qui n’est pas du tout le cas de celui-ci. J’ai l’impression que Kadaré a pratiqué des formes très différentes d’un roman à l’autre.
Choup · 11 décembre 2025 à 18 h 53 min
Il y a longtemps je m’étais promis de le lire, mais j’ai hésité sur le titre pour débuter la découverte, et puis le temps a passé. Tu me le remets en mémoire, et je noterai donc Avril brisé pour entrer dans son univers. J’ai découvert le Kanun, il y a quelques temps, à travers un roman, et j’étais consternée par ces règles d’honneur qui ne servent en effet qu’à détruire des familles dans une spirale infernale et sans fin. Que de tragédies!
Cléanthe · 14 décembre 2025 à 22 h 10 min
Je crois que ce livre-ci alors est pour toi. On avance en pleine tragédie.
Patrice · 10 janvier 2026 à 17 h 27 min
Je garde un très bon souvenir de ce livre que j’ai découvert à l’occasion de la lecture commune que tu avais organisé l’année de la mort de Kadaré et je suis heureux de me souvenir de cette lecture en parcourant ton billet qui restitue très bien l’atmosphère du livre. Merci !
Cléanthe · 13 janvier 2026 à 21 h 21 min
Merci à toi surtout! Je me souviens de ton billet. J’avais d’ailleurs noté ce titre pour une prochaine lecture. C’est à présent chose faite, et je ne suis pas déçu.