Albert MEMMI: La Statue de sel

Au lendemain de la guerre, le jour de son examen de philosophie, Alexandre Mordekhai Benillouche, incapable de composer, se souvient… Né dans une famille modeste de la Hara, le quartier juif pauvre de Tunis, entouré d’une mère analphabète et très pieuse et d’un père asthmatique, l’enfant grandit dans une impasse, avant que la famille ne déménage dans une habitation tout aussi modeste, partagée avec d’autres membres de sa famille maternelle. Enfant, il découvre la vie dans un quartier populaire de Tunis, où se mêlent ferveur religieuse, traditions sépharades et promiscuité quotidienne. Ce sont des années faites d’odeurs d’épices, de cris de marchands, de cours d’école où l’on apprend à se mesurer aux autres. Il observe avec curiosité les adultes, les rituels, les bruits et les odeurs du quartier, tout en percevant déjà, confusément, que son horizon sera différent de celui des siens. Très tôt, son intelligence vive attire l’attention, et l’école devient pour lui un espace d’ouverture autant qu’un lieu de rupture: on lui explique qu’il pourra poursuivre ses études hors de la Hara, peut-être même au lycée français…
Au retour de Tunisie, en octobre dernier, j’ai réuni quelques livres, quelque chose comme une bibliothèque tunisienne, dans laquelle piocher de temps en temps. J’en ai d’autres (des « bibliothèques » napolitaine, vénitienne, polonaise, « rothienne »…), certaines négligées pendant plusieurs mois, que je réveille cependant parfois et qui viennent nourrir régulièrement mes lectures. Et mes billets de blog! Et j’aime bien alterner entre ces différents livres, qui constituent comme un bruit de fond de mes lectures, quelque chose comme des cycles, mieux: comme des vagues de lecture. C’est l’occasion parfois de belles découvertes, comme le roman d’Albert Memmi justement, qui jusqu’à présent n’était pour moi qu’un nom, que je rangeais vaguement entre littérature et critique du colonialisme, mais sans en savoir beaucoup plus.
Il faut dire pourtant que ce livre, La Statue de sel, a une belle histoire, qui suffirait à faire prendre l’auteur au sérieux: ce premier roman, très autobiographique, au point qu’Albert Memmi peut être considéré comme l’un des créateurs de ce qui ne s’appelait pas encore « autofiction », a été remarqué par Albert Camus qui lui a offert une rapide mais efficace préface à sa parution en 1953 – on trouve parrainage moins illustre! Et Camus ne s’y est pas trompé. Je sors tout enthousiasmé de cette lecture!
Ce roman est d’abord une successions de scènes marquantes. Il y a la description de la maison familiale, sombre et étroite, où la pauvreté et la piété de la mère imprègnent chaque geste: un décor qui enferme autant qu’il protège. Il y a aussi les rituels juifs — les repas du sabbat, les prières, les fêtes — dans lesquels le jeune garçon ressent déjà une distance, comme s’il observait sa propre communauté derrière une vitre. Enfin, l’entrée à l’école française, avec ses maîtres sévères et ses camarades issus d’autres milieux, marque une rupture décisive: c’est là qu’il comprend pour la première fois qu’il est «autre» partout, trop juif pour les uns, trop pauvre pour les autres, étranger dans toutes les langues qu’il parle. Ces scènes, qui oscillent entre tendresse, humiliation et émerveillement, dessinent les premières lézardes d’une identité en devenir. À mesure que le narrateur grandit, l’école française devient le véritable pivot de son existence. Boursier, admis dans un établissement prestigieux fréquenté par les enfants de colons et de notables, il découvre un monde dont il ignore les codes et dont il pressent d’emblée qu’il ne lui appartiendra jamais tout à fait. Le français, qu’il apprend avec passion, devient pour lui un outil d’émancipation autant qu’un instrument de séparation: il parle désormais une langue que les siens ne comprennent pas complètement, et dans laquelle il commence à penser. À l’adolescence, entre les livres qui l’ouvrent à un univers plus vaste et les humiliations de classe qui lui rappellent son origine modeste, il avance dans une zone instable, convaincu que la réussite scolaire pourrait le libérer, mais conscient déjà qu’elle l’éloigne de ses racines. C’est dans cet entre-deux qu’il se forme, partagé entre un désir de reconnaissance et un sentiment croissant d’exil intérieur. Certaines scènes donnent à cette tension une intensité poignante. Il y a par exemple celle de son premier grand amour, où il croit un instant que la barrière des origines peut s’effacer — avant que la jeune femme, gênée, ne lui laisse entendre que leur futur est impossible. Et toutes les scènes de la guerre, notamment celle de l’expérience des camps de travail imposés par l’occupant nazi aux juifs, sous couvert de l’administration coloniale française, ou celle du retour à la paix où Alexandre découvre que, parce qu’il a refusé de se soumettre à Vichy et a démissionné de son emploi de surveillant, il ne retrouvera pas son poste ni son ancienneté malgré la Libération!
Memmi, on le voit, compose ici un récit d’une rare justesse, où l’exploration de soi devient le miroir d’une société tunisienne déchirée entre colonisation et aspirations nationales. Son narrateur – Alexandre Mordekhai Benillouche – grandit en portant en lui les contradictions d’un monde hétérogène: juif dans un pays arabe, nord-africain pour les Européens, francophone dans un environnement où le français est une langue de prestige autant que d’exclusion. Cette identité en mosaïque, loin de se stabiliser, se complexifie à mesure qu’il avance dans les études, découvre la littérature et se confronte à des modèles qui ne sont jamais parfaitement les siens. Memmi excelle à mettre en scène ce dédoublement intérieur: l’enfant, puis l’adolescent, comprend que pour progresser dans l’école coloniale il doit renier une partie de ses origines, adopter les codes d’un autre monde, intérioriser une hiérarchie qui le blesse mais dont il espère tirer une libération. Le roman devient alors une chronique d’émancipation ambivalente, poignante, où l’ascension sociale passe par des renoncements. Loin de s’en réjouir, Memmi montre la tension douloureuse entre le désir de se libérer de la misère familiale et la culpabilité d’abandonner ceux qui ne pourront pas le suivre. Le livre prend ainsi toute sa force dans cette écriture précise, franche, jamais sentimentaliste, qui dévoile avec une lucidité implacable la construction d’un «je» fragmenté.
Car La Statue de sel n’est pas seulement l’histoire d’un jeune homme qui cherche sa place: c’est celui d’un pays qui change, d’une société où cohabitent plusieurs appartenances sans parvenir à s’accorder. À travers le parcours singulier d’un jeune garçon juif tunisien et d’une variation auto-fictionnelle doublement ironique sur le genre du roman de formation, genre occidental par excellence, Memmi touche au plus universel, et à une vérité sociologique: la difficulté de devenir soi quand l’héritage, la langue, la religion et l’Histoire tirent chacun dans une direction différente. Roman d’apprentissage, donc, récit des blessures de l’identité coloniale, livre de clairvoyance et de sincérité, La Statue de sel demeure bouleversant par la modernité de cette voix cherchant obstinément, malgré les déchirements et les impasses, une vérité personnelle – même si cette vérité, comme une statue de sel trop exposée au monde, risque toujours de se dissoudre. Ou quelle soit la malédiction qui, comme la femme de Loth, frappe ceux qui s’éloignent des commandements de la communauté. On comprend qu’Albert Camus n’ait pu qu’être séduit par la lecture d’un tel roman!
« Mon examen abandonné, je n’ai plus repassé la grande porte de l’Université. Je n’ai pas voulu quitter Alger, cependant, avant la remise en ordre de mon histoire, au bout de quoi, me voici bien en face de moi-même. Si je vis, je n’oublierai jamais cette extraordinaire rencontre, cette étrange coïncidence avec moi-même.
Ainsi, j’ai passé de crise en crise, retrouvant chaque fois un nouvel équilibre, plus précaire, mais toujours il me restait quelque chose à détruire. Cette fois le bilan est fait: rien, enfin, ne me cache à mes yeux. Avec l’Impasse, j’ai rompu, parce que ce n’était qu’un rêve d’enfance, avec mon père et ma mère et j’ai eu honte d’eux, avec les valeurs de la communauté parce qu’elles sont périmées, avec l’ambition et les bourgeois parce qu’ils sont injustes et d’idéal frelaté, avec la ville parce qu’elle vit au moyen âge oriental et ne m’aime pas, avec l’Occident parce qu’il est menteur et égoïste. Et chaque fois s’écroulait une partie de moi. »
Albert Memmi, La Statue de sel (1953)
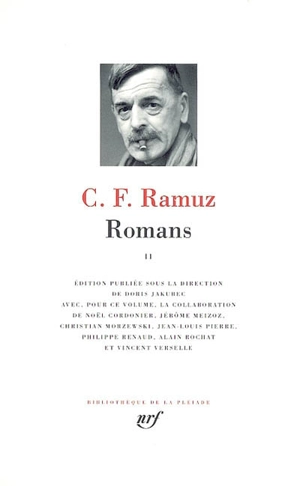


8 commentaires
Ingannmic · 3 décembre 2025 à 20 h 44 min
Eh bien moi je le connaissais même pas de nom… lacune réparée, grâce à ton billet, qui donne fort envie d’aller plus loin.
Cléanthe · 4 décembre 2025 à 8 h 58 min
Je te le conseille, cela vaut vraiment le coup.
nathalie · 4 décembre 2025 à 7 h 47 min
Comme Ingannmic, je ne connaissais pas du tout, mais tout cela a l’air passionnant. Je vais noter son nom et essayer de le trouver.
Cléanthe · 4 décembre 2025 à 8 h 59 min
Je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Moi, en tout cas, j’ai été conquis.
aifelle · 4 décembre 2025 à 8 h 47 min
Je le connais de nom, j’ai même failli le lire, seul le temps m’a manqué à l’époque. Il n’est jamais trop tard.
Cléanthe · 4 décembre 2025 à 9 h 01 min
Oui, c’est le drame de la lecture. Comment trouver le temps de lire tous ces livres passionnants qui nous tendent leurs pages?
choup · 4 décembre 2025 à 10 h 48 min
Inconnu au bataillon pour moi… tu ouvres des perspectives! Je vois que ma médiathèque a plusieurs ouvrages de cet auteur, dont celui-ci, je me note donc de découvrir cet auteur en 2026.
Cléanthe · 4 décembre 2025 à 18 h 03 min
J’ai hâte de lire ton avis. J’espère que ce sera pour toi aussi une belle découverte.