Philip ROTH: L’Écrivain fantôme
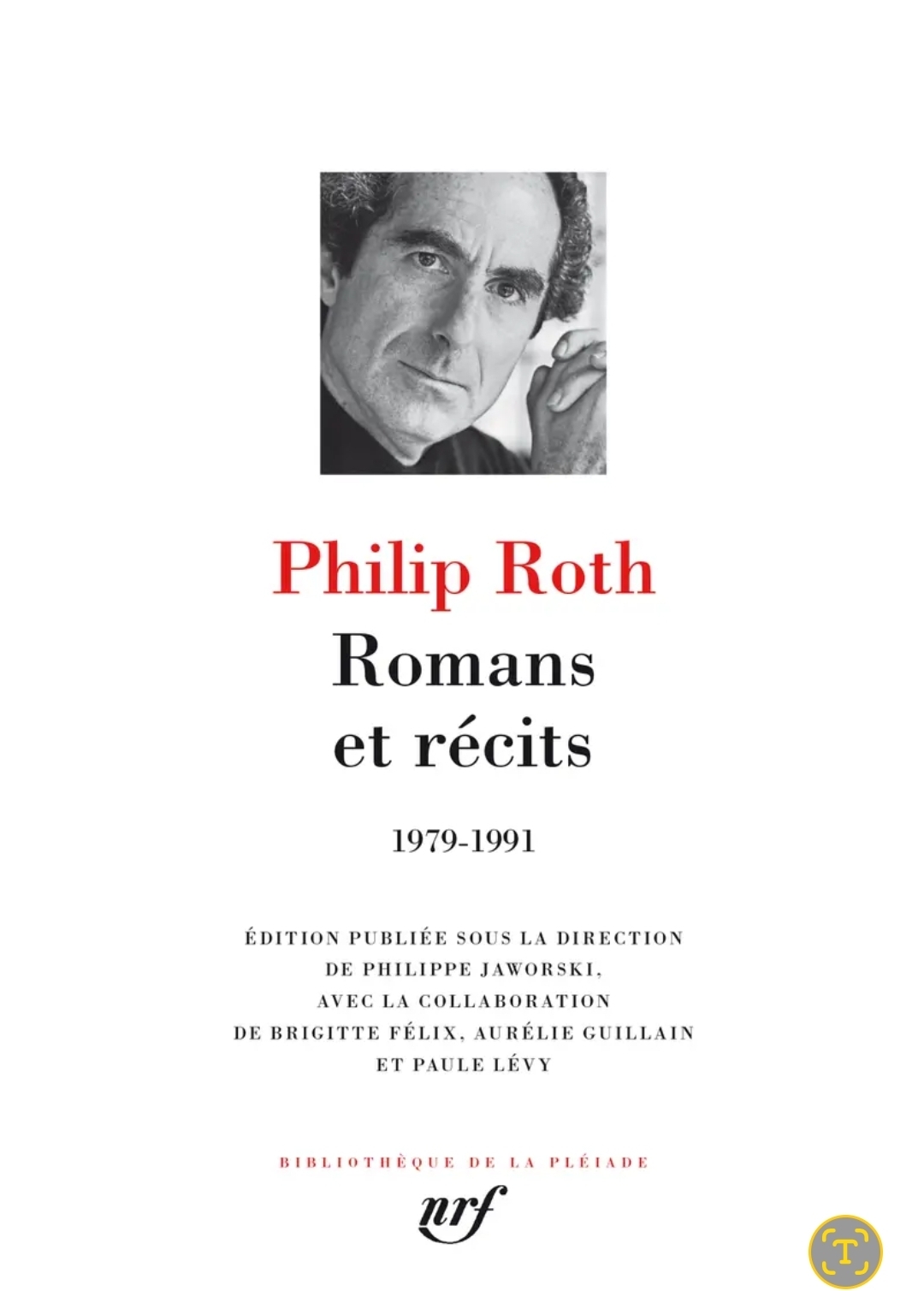
Par une neigeuse soirée d’hiver, Nathan Zuckerman, en conflit avec sa famille et les notables de la communauté juive, se rend chez un écrivain célèbre, E. I. Lonoff, en qui il espère trouver un père spirituel. Chez Lonoff, Nathan entraperçoit Amy Bellette, une jeune femme mystérieuse hébergée par l’écrivain, dont il tombe immédiatement amoureux. Il dîne avec ses hôtes, converse en tête à tête avec l’écrivain, passe une nuit agitée où se déchaînent fantasmes et spéculations, puis assiste, au petit matin, à l’explosion de jalousie de Hope, l’épouse de Lonoff, envers Amy. Mais dans le ferment de ces quelques dix-huit heures, quelque chose a levé: outre les délires priapiques d’un jeune écrivain sensible aux émois de la chair, ce sont des textes, des auteurs, des suggestions narratives, et un appétit de vivre débordant d’imagination. Et d’abord qui est cette Amy, aux charmes envoûtants? L’espace d’un instant, Nathan Zuckerman aperçoit la possibilité qu’elle ne soit autre qu’Anne Frank, rescapée des camps…
Aussitôt refermé le troisième volume de la « trilogie américaine », qui mettait en scène un Nathan Zuckerman au soir de sa vie, explorant les désordres d’une Amérique et ses conflagrations sur les tragédies individuelles, j’ai eu envie de remonter aux sources, au moment où Philip Roth construisait la figure de cet alter ego fictionnel qui l’accompagnera pendant la majeure partie de sa vie d’écrivain. Ayant découvert le romancier avec ses derniers romans, c’est une période que je connaissais peu. Direction donc Zuckerman enchaîné, titre sous lequel Roth réunit son premier cycle romanesque consacré à Nathan Zuckerman (en fait, trois romans et un épilogue: L’Écrivain fantôme, Zuckerman délivré, La leçon d’anatomie, L’Orgie de Prague).
Avec L’Écrivain fantôme (1979), Philip Roth, reprenant un personnage qui était apparu dans un précédent roman, ouvrait en effet un cycle qui deviendra monumental et comprendra en tout neuf romans. L’Écrivain fantôme est ainsi le premier volet d’une trilogie qui suit l’apprentissage, les triomphes et les désillusions d’un écrivain, Nathan Zuckerman, de sa jeunesse pleine de doutes à la confrontation avec le succès et la crise de la vocation. Un cycle où Roth brouille sans cesse les frontières entre autobiographie et fiction. Premier volet de la «trilogie Zuckerman», le roman s’écrit aussi en réponse au formidable succès – et au scandale – de Portnoy et son complexe. À ses détracteurs, Roth réplique ici par une « mise en abyme » ironique: au-delà de la question de «l’écrivain juif», qui occupe une place centrale, il s’agit surtout de réfléchir, selon les mots mêmes de l’écrivain, sur « les circonstances imprévisibles de l’art, sur la façon dont les lecteurs font usage des livres, ce qui constitue souvent une source d’étonnement pour les écrivains». Au centre de ces récits, Roth place un personnage conçu en partie à son image: comme lui, Zuckerman est natif de Newark, il a étudié à l’Université de Chicago, a publié des nouvelles, puis un roman qui fit scandale … mais il ne faut pas s’y tromper : Zuckerman est un alter ego de fiction. Il ne se confond pas avec Roth; il doit être lu comme une figure littéraire, un masque à travers lequel l’auteur explore sa propre condition d’écrivain.
J’ai beaucoup aimé ce premier volume consacré à la jeunesse de l’artiste même si le style est très différent des grands romans de la maturité. Centré sur la jeunesse de Zuckerman, développé comme dans le théâtre classique en une action s’étalant sur moins d’une journée, il se donne comme un roman d’initiation, le récit d’un pèlerinage littéraire. Ce texte si ténu contient pourtant deux récits enchâssés. L’un renvoie à la vie «réelle» de Nathan: sa brouille avec son père, ses démêlés avec la communauté, qui le juge traître pour avoir tourné en dérision une sordide querelle familiale dans une nouvelle jugée iconoclaste. L’autre, qui occupe près d’un quart du roman, est un pur délire d’imagination: Amy serait en réalité Anne Frank, miraculeusement rescapée des camps et réfugiée incognito aux États-Unis! Fantasme vertigineux, où se brouillent mémoire, invention et culpabilité.
La richesse du roman tient beaucoup à cette structure. Le récit progresse de manière oblique, interrompu de digressions, d’emboîtements, de fluctuations, comme si le bouillonnement intérieur du narrateur contaminait la narration elle-même. C’est un récit à la première personne, conté longtemps après les faits, et traversé d’une étonnante prolifération d’échos littéraires : on pense à Joyce et au jeune Dedalus, à Henry James (Roth insère même un résumé des Années médianes, une nouvelle de James que Zuckerman lit – et nous raconte – pendant sa nuit chez Lonoff). La visite à Lonoff se transforme ainsi en un voyage à travers les textes, une initiation aussi bien littéraire que biographique.
Au-delà de son intrigue, L’Écrivain fantôme est ainsi une méditation sur le prix de la littérature. Lonoff (inspiré sans aucun doute de Bernard Malamud, l’autre grand écrivain juif américain, malheureusement trop peu connu en France, malgré le beau travail réalisé depuis une dizaine d’année par les éditions Rivages, mais dans lequel on retrouve aussi des traits de Philip Roth lui-même à l’époque où il écrit L’Ecrivain fantôme – nouveau vertige des masques et doubles par lesquels le romancier se montre et se voile en même temps) incarne la figure de l’écrivain absolu, enfermé dans une vie consacrée à l’art, mais vouée à une certaine solitude. Zuckerman, fasciné et inquiet, devine qu’écrire implique une forme de trahison: trahison des siens, de sa communauté, de la vie ordinaire, en même temps qu’il se trouve au centre de contradictions qui le tiraillent: celle de sa vocation littéraire et de ses appétits charnels, des exigences de son art et des exigences de son milieu, et par lesquelles Roth transpose sur le mode burlesque toutes les accusations qui lui furent adressées dans la réalité.
J’ai retrouvé dans ce premier Zuckerman ce mélange de verve et de lucidité qui m’avait frappé dans la Trilogie américaine, mais ici plus resserré, plus intime. C’est un roman bref, mais décisif: Roth raconte sa propre naissance d’écrivain sous le masque de la fiction, et montre déjà ce qui fera la force de son œuvre – la capacité à transformer sa vie en matière romanesque, à interroger sans relâche la frontière entre réalité et invention, fidélité et transgression.
La trilogie se poursuit avec Zuckerman délivré (1981), que j’ai commencé à lire dans la foulée, et dont je reparlerai ici même d’ici quelques jours, où Nathan, désormais auréolé d’un succès retentissant, affronte la notoriété et ses effets corrosifs: harcèlement médiatique, réactions violentes de ses lecteurs, sentiment d’isolement… et une certaine paranoïa qui est le pendant peut-être de l’imagination créatrice. A suivre!
Le cycle Nathan Zuckerman:
L’Orgie de Prague (1985)
La Contrevie (1986)
J’ai épousé un communiste (1998)
Exit le fantôme (2007)
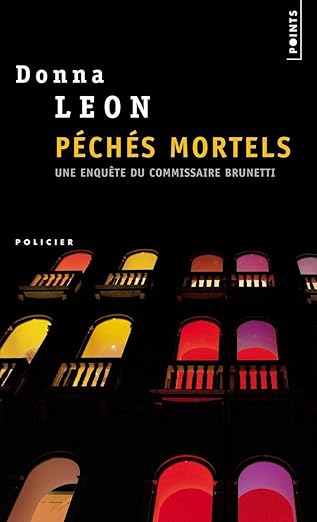
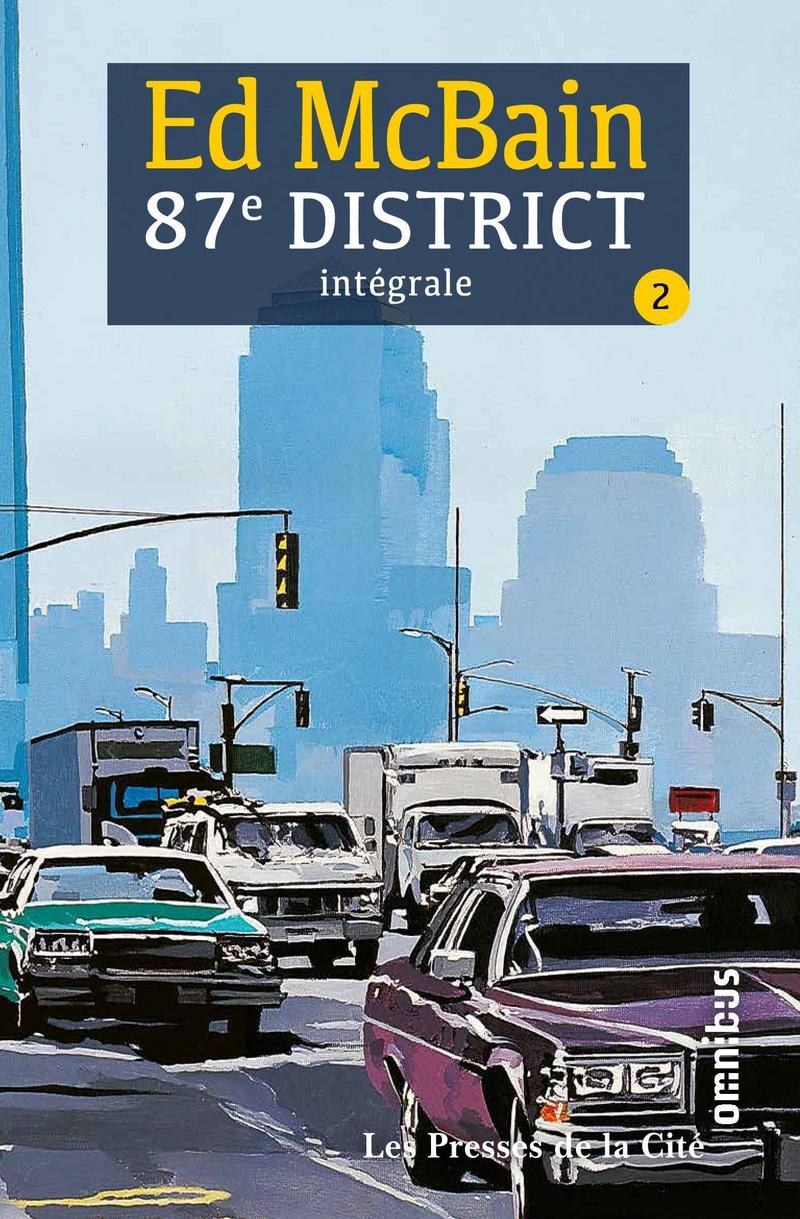
2 commentaires
Tania · 10 octobre 2025 à 14 h 55 min
Philip Roth m’a fascinée avec « les aventures » de son Zuckerman. Je pense souvent à lui, à Paul Auster aussi bien qu’ils soient très différents, en suivant l’actualité de cette Amérique qui ne fait plus rêver sinon en donnant des cauchemars.
Cléanthe · 10 octobre 2025 à 16 h 31 min
J’aime à imaginer que cette Amérique que nous aimions n’est pas morte et que le trumpisme est une de ces crispations que le pays connaît régulièrement dans son histoire. Un peu comme le maccarthysme. C’est ce qui m’avait frappé déjà dans Le Complot contre l’Amerique: à la fin du roman les États-Unis finissent par renouer avec leur histoire démocratique et reprendre un cours « normal ». Je me méfie toujours de l’effet de sidération de régimes comme celui de Trump qui tendent à nous faire oublier qu’ils n’occupent pas seuls tout l’espace politique. Mais peut-être suis-je trop optimiste…