Mario VARGAS LLOSA: Tours et détours de la vilaine fille
Dans le Lima tranquille des années 1950, Ricardo est un adolescent sage, rêveur, un peu littéraire. Insolente, vive, étrange, un rien mythomane, elle se fait appeler Lily, prétend être chilienne, et fait tourner la tête à toute une bande de garçons de Miraflores, le quartier chic de la ville. Ricardo tombe amoureux. Mais la jeune fille est une imposture : des années plus tard, il apprendra qu’elle n’était pas chilienne du tout, et qu’elle avait tout inventé. Ce sera la première d’une longue série de fuites. La première métamorphose, le premier coup de foudre, la première déception. Et le début d’une obsession.Quelques années plus tard, au commencement des années 1960, Ricardo, désormais adulte, vit à Paris, où il travaille comme traducteur à l’Unesco. Il reconnaît Lily dans une militante révolutionnaire péruvienne surnommée « la camarade Arlette ». Elle feint d’abord de ne pas le connaître, puis finit par céder à ses avances. Mais leur relation est brève : elle s’envole vers Cuba, puis Moscou, fidèle à sa quête d’ascension et d’effacement. Puis ce seront Londres, Tokyo, Madrid. Une vie de bon garçon hantée par une vilaine fille, le récit d’un amour fou…
Inganmic proposait de se retrouver le 31 août, pour une lecture commune en hommage à Mario Vargas Llosa, décédé en avril dernier. J’ai pris un peu de retard dans ma lecture. Mais me voici finalement, avec quelques jours de décalage, au rendez-vous. J’ai découvert Mario Vargas Llosa il y a de nombreuses années (je devrais dire décennies) avec La Tante Julia et le scribouillard, du temps où je dévorais les auteurs d’Amérique latine: Fuentès, Cortazar, Carpentier, Garcia Marquez… Ce roman m’avait enchanté. Trente ans après, j’ai trouvé le même plaisir avec ce Tours et détours de la vilaine fille. Et la conviction qu’il ne faudra pas que j’attende autant d’années avant de me replonger dans un autre livre de l’auteur!
Ce roman m’a fasciné, parfois dérangé. Et pourtant, je n’ai pas pu le lâcher. Il y a une tension étrange entre la limpidité du style et la noirceur du sujet. Au centre du roman, « la vilaine fille », et ses réapparitions. À Paris, à Londres, à Tokyo. Chaque fois, Ricardo la reconnaît — parfois avant qu’elle n’accepte de le reconnaître. Et chaque fois, il retombe sous son emprise. Elle change de nom, d’accent, d’identité. Elle devient tour à tour révolutionnaire, femme entretenue, épouse d’un riche diplomate, geisha presque captive, femme malade. Ricardo devient son ombre fidèle, son refuge occasionnel, son chien battu aussi. Il sait qu’elle le méprise un peu, qu’elle se sert de lui, qu’elle ne l’aimera jamais vraiment. Et pourtant, il attend. Il l’attend toujours.
Sous une forme relativement simple, chronologique, plus linéaire que d’autres romans de l’auteur, Tours et détours de la vilaine fille reste cependant une subtile machinerie littéraire dans laquelle on trouve à la fois une histoire d’amour fou, quelques belles histoires d’amitiés, le récit d’une relation toxique, un portrait du second XXème siècle, une narration décentrée, mondialisée, passant de Lima à Paris, Londres, Tokyo, Madrid pour finir dans le sud de la France, non loin de Sète, un miroir peut-être aussi de la vie errante d’un écrivain, ayant vécu entre l’Amérique du sud et l’Europe, un écrivain désenchanté, un hommage enfin à quelques grands romans et poètes qui couve sous la surface du récit. La construction même du roman demanderait d’ailleurs à être commentée, la linéarité du développement chronologique dissimulant une structure faite d’une suite de séquences successives, un peu à la manière de nouvelles, centrées sur de nouveaux personnages (le gros Paúl, le guérillero; Juan Barreto, peintre hippie dans le Londres des années 70; Salomón Toledano, le collègue polyglotte de l’Unesco; Simon et Elena Gravoski, et Ylal, leur fils adoptif, les voisins fidèles), un lieu, un épisode de la vie de Ricardo, un moment de son identité émotionnelle, sentimentale, intellectuelle. Et une nouvelle métamorphose de la « vilaine fille ».
Car ce roman n’est pas une simple histoire d’amour, ou alors une histoire d’amour sans retour. C’est un roman de l’obsession. D’un homme qui sacrifie sa vie à une image, une voix, une absence. Qui sait qu’il est dupe, mais persiste. La «vilaine fille» est cruelle, insaisissable, menteuse, blessée aussi, et donc aussi dans une certaine mesure vulnérable — et peut-être que c’est ce mélange qui la rend inoubliable. Et pour une part curieusement attachante. Elle est le contraire de Ricardo, « le bon garçon ». Lui est constant, modeste, transparent. Elle est tout mouvement, opportunisme, fuite. Elle fascine parce qu’elle échappe. Ajoutons que Vargas Llosa ne juge jamais son personnage féminin — il la donne à voir, telle qu’elle est, telle qu’elle se rêve, telle que Ricardo aussi la rêve, jusque dans l’intimité la plus crue (Ah les cunnilingus, source d’inspiration poétique inépuisable sous la plume de l’auteur qui, on le reconnaîtra, sait bien tourner la chose…! 😉 ). Mené par le récit que lui en donne Ricardo, le lecteur oscille entre le rejet et la tendresse. Elle est odieuse, sans doute. Mais libre aussi. Elle ne s’attache pas, ne s’excuse pas, ne se laisse pas définir. Jusqu’à la fin, elle gardera son mystère. Et Ricardo, jusqu’au bout, l’aimera.
Mais l’auteur ne s’en tient pas là. À travers ce duo tragique et dérangeant, Vargas Llosa raconte aussi l’histoire d’une époque: le Paris des années 60 et ses révolutionnaires en mal d’action, le Londres des années 70, le Tokyo glacé et ultra-moderne des années 80. Ricardo est traducteur, il traverse les langues, les frontières, les décors — mais reste toujours en marge. Il vit dans les interstices, dans l’attente de ses retrouvailles. Il regarde le monde passer, les femmes s’éloigner, les années défiler.
A bien des égards, je dirai donc que Tours et détours de la vilaine fille m’est apparu comme le roman de la maturité de l’auteur – c’est d’ailleurs par ce roman que Vargas Llosa a choisi d’achever les deux volumes que la Bibliothèque de la Pléiade lui a consacré: retrouvant le décalage humoristique de ses premiers romans, Vargas Llosa semble, comme l’écrit avec justesse Stéphane Michaud dans sa notice, donner « son congé au romantisme, celui de la révolution comme de l’amour unique ». Il y a du Philip Roth dans ce désenchantement, comme dans l’ironie qui le porte. C’est en tout cas à cet auteur que m’a fait penser le premier chapitre du roman: l’évocation d’un été merveilleux, dans le quartier de Miraflores, à Lima, porté par le temps des vacances, le beau temps et le souvenir des émois amoureux.
Dans ce roman truffé de références littéraires, il n’est pas impossible que Vargas Llosa ait songé lui aussi à cet illustre contemporain, même si les renvois les plus explicites vont à L’Education sentimentale de Flaubert (la « vilaine fille » ne réapparaît-elle pas au chapitre 3, mariée à un diplomate français, sous le nom de Madame Arnoux?), à Nadja de Breton (le rôle des rencontres de hasard, le thème de l’amour fou et jusqu’à l’invitation faite à la fin par la vilaine fille à Ricardo de devenir l’auteur d’un roman racontant leur histoire – ce roman que justement nous lisons!), à Proust, à Tanizaki (tout l’épisode tokyoïte, avec ses perversions et dissimulations, pouvant être lu comme un hommage à l’auteur japonais), à Pablo Neruda ou au Cimetière marin de Paul Valery. Tout un jeu de réminiscences littéraires, une esthétique du déjà-vu porte ainsi le récit, donnant une profondeur à cette histoire, pour ceux en tout cas qui, avec l’auteur, sont convaincus que la fiction littéraire ne détourne pas du réel, mais est au contraire l’instrument de la vérité.
« Ce fut un fabuleux été. Pérez Grado vint à Lima avec son orchestre de douze musiciens professionnels pour animer les bals de carnaval au club Terrazas de Miraflores et au Lawn tennis, un championnat national de mambo fut organisé aux arênes d’Acho, qui remporta un grand succès malgré les menaces du cardinal Juan Gualberto Guevara, archevêque de la ville, d’excommunier tous les couples participants; et puis le quartier du Barrio Alegre, des rues Diego Ferré, Juan Fanning et Colón, à Miraflores, disputa les olympiades de foot, cuclisme, athlétisme et natation contre le quartier de la rue San Martin, et l’on gagna, bien sûr.
Il se passa des choses vraiment extraordinaires durant cet été de 1950. Claudico Lañas leva pour la première fois une fille – cette rouquine de Seminauel – qui, à la grande surprise de tout Miraflores, lui dit oui. Claudico, oubliant sa patte folle, se pavanait dans les rues en gonflant ses pectoraux comme un Charles Atlas. Tico Tiravante rompit avec Ilse et tomba Laurita, Víctor Ojeda tomba Ilse et rompit avec Inge, Juan Barreto tomba Inge et rompit avec Ilse. Une telle recomposition sentimentale au sein du groupe nous donna le tournis: les amourettes se défaisaient et se refaisaient, et à l’issue des surprises-parties du samedi les couples n’étaient jamais les mêmes qu’au départ. «Quelle indécence!» s’écriait, scandalisée, ma tante Alberta, avec qui je vivais depuis la mort de mes parents.
Les vagues sur la plage de Miraflores se brisaient à deux reprises au large, d’abord à deux cents mètres du sable, et nous, les cœurs vaillants, allions là-bas les affronter à poitrine nue en nous laissant drosser pendant cent mètres, sur la crête, où les vagues ne mouraient que pour reconstituer d’arrogants rouleaux et se briser derechef, en un second déferlement qui faisait glisser les surfeurs jusqu’aux petits galets de la plage.
Cet été prodigieux, aux soirées de Miraflores, le mambo fit table rase des valses, corridos, blues, boléros et autres guarachas. Le mambo, un séisme qui fit sauter, bondir, se tortiller et déhancher tous les couples enfantins, adolescents et mûrs du quartier. Il en allait sûrement de même hors les murs de Miraflores, au-delà du monde et de la vie, dans les quartiers de Lince, Breña, Chorrillos, ou ceux, encore plus exotiques, de La Victoria, au centre de Lima, du Rímac et de Porvenir, où nous, les Miraflorins, n’avions mis ni ne pensions jamais mettre les pieds.
Et tout comme on était passés des valses créoles et des guarachas, des sambas
et des polkas au mambo, on était aussi passé des patins et de la trottinette au vélo, et certains même, tels Tato Monje et Tony Espejo, à la moto, voire, pour un ou deux, à la voiture, comme Luchín, le grand dadais de la bande, qui volait parfois la Chevrolet décapotable de son père et nous emmenait faire un tour sur le front de mer, depuis le Terrazas jusqu’à la Quebrada de Amendàriz, à cent à l’heure.
Mais le grand événement de cet été-là fut l’arrivée à Miraflores, en provenance du Chili, leur lointain pays, de deux sœurs dont le physique provocant et l’inimitable façon de parler, à toute allure, escamotant les dernières syllabes des mots, finissant leurs phrases sur une espèce d’exclamation qui ressemblait à un pff, nous tourneboula tous, nous qui venions d’échanger nos culottes courtes comme des pantalons. Et moi, plus que tous les autres. »
Mario VARGAS LLOSA, Tours et détours de la vilaine fille (2006), traduction: Albert Bensoussan, revue par Anne Picard, chapitre 1
Une lecture commune proposée en hommage à l’auteur, décédé en avril de cette année.
Sandrine et Inganmic ont lu La tante Julia et le scribouillard
Anne-yes Temps sauvages
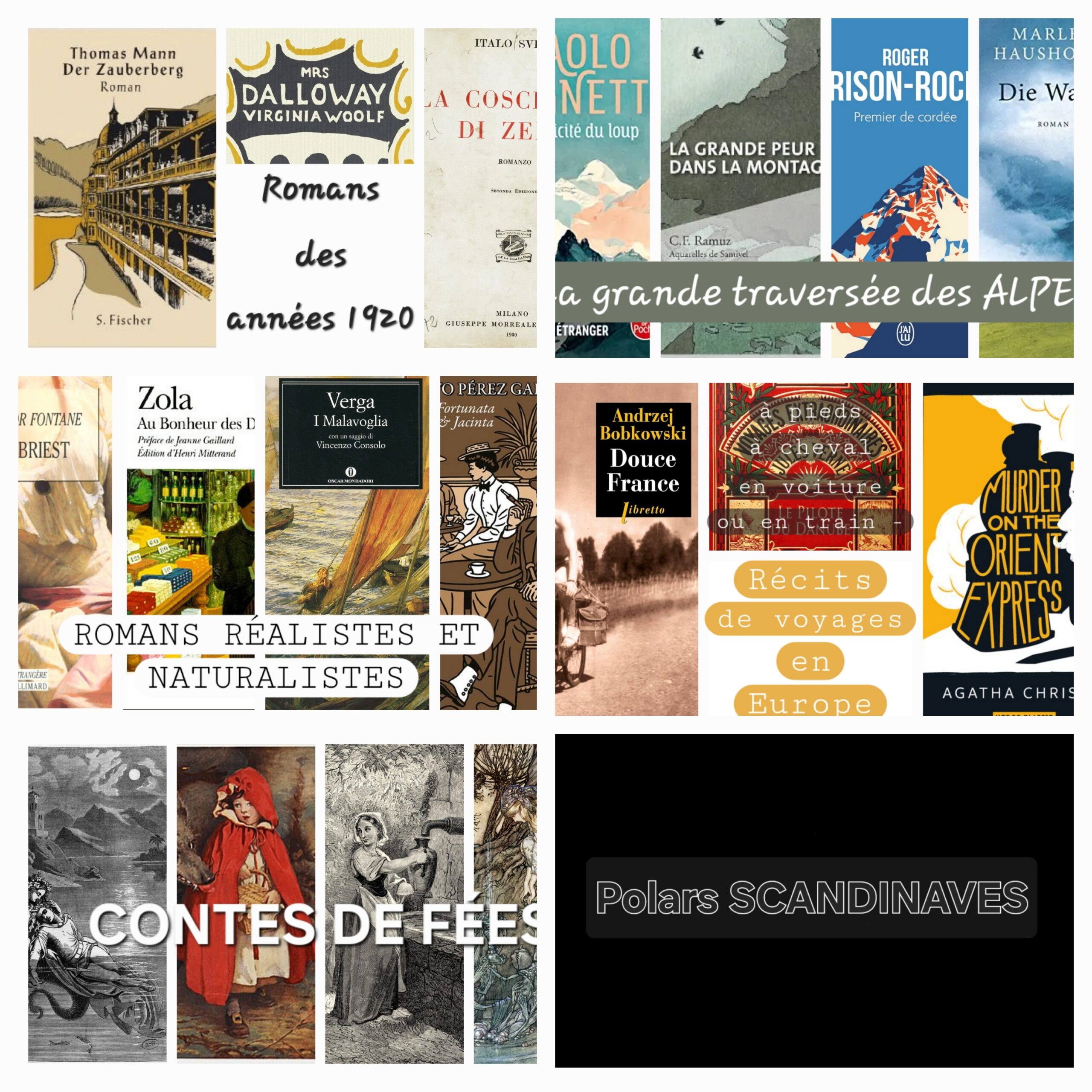
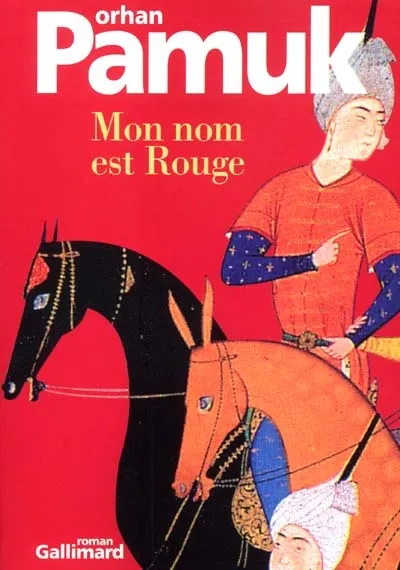
8 commentaires
Athalie · 3 août 2025 à 7 h 18 min
« Une subtile machinerie littéraire » dis tu … Une machinerie que je retiens pour découvrir cet auteur ! Et oui, malgré ma grande époque littérature sud américaine où comme toi je dévorais tous les auteurs que tu cites ( plus Borgès), je n’ai jamais lu Vargas Llosa.
Cléanthe · 4 août 2025 à 21 h 45 min
Celui-ci est très bien. Mais si tu n’as jamais lu Vargas Llosa, je te conseillerais plutôt de commencer par « La Tante Julia et le scribouillard ». Un chef d’œuvre!
Sandrine · 3 août 2025 à 8 h 40 min
Tu me tentes avec cette subtile machinerie littéraire que je n’ai pas encore lue.
Cléanthe · 4 août 2025 à 21 h 46 min
C’est un Vargas Llosa en apparence plus classique dans la narration, mais d’une belle subtilité quand on y regarde de plus près.
Ingannmic · 3 août 2025 à 9 h 09 min
Merci pour ta participation ! Tu me donnes bien envie de poursuivre ma découverte de Vargas Llosa avec ce titre..
Cléanthe · 4 août 2025 à 21 h 47 min
C’était une belle idée, ce rendez-vous. Il m’a permis de me replonger dans un auteur que j’aime beaucoup, mais que j’avais trop longtemps délaissé.
Anne-yes · 7 août 2025 à 7 h 16 min
Vos comptes-rendus me donnent envie de poursuivre ma découverte de l’oeuvre de Vargas Llosa. Très bien cette lecture commune.
Cléanthe · 7 août 2025 à 12 h 56 min
Cette lecture commune m’a donné envie moi aussi de poursuivre la lecture de Vargas Llosa.