Italo SVEVO: La Conscience de Zeno
Nous sommes à Trieste, à la veille du premier conflit mondial. À la demande de son psychanalyste, Zeno Cosini entreprend de raconter sa vie : ses tentatives toujours repoussées d’arrêter de fumer, sa relation trouble avec son père mourant, son mariage conclu comme un acte manqué, son adultère à demi assumé, ses affaires financières hasardeuses, et enfin sa propre psychanalyse, qu’il interrompt sans ménagement. Mais attention : le récit de Zeno n’est pas une confession franche. Tissu de contradictions, d’aveux douteux, de souvenirs réécrits, le récit de Zeno gonfle comme un roman où le lecteur ne sait jamais si le narrateur se ment à lui-même ou nous mène en bateau. Ironique, obsessionnel, terriblement humain, Zeno raconte moins ce qu’il a vécu que ce qu’il est incapable d’éclaircir. Sous prétexte de se soigner, Zeno s’analyse jusqu’à l’absurde…

Pour cette première étape des Escapades en Europe – Voyages dans les littératures européennes, consacrées ce mois-ci aux Romans des années 1920, j’ai mis le cap sur Trieste, ville de contrastes au carrefour de plusieurs mondes, qu’elle a su tricoter comme nulle autre: port austro-hongrois sur la Méditerranée avant d’être rattachée à l’Italie, après 1918, porte ouvrant sur les Balkans, entourée par la Slovénie, la ville a abrité une assez importante communauté juive, dont reste aujourd’hui encore une très belle synagogue, l’une des plus importantes d’Europe par sa taille. Une ville discrète, une ville frontière, concentrée plus en apparence sur le commerce et le négoce que sur le développement des arts et de la littérature… mais dont l’un des paradoxes est d’y avoir vu naître quelques-unes des plus grandes voix de la littérature européenne – une tradition poursuivie aujourd’hui par des auteurs comme Claudio Magris ou Paolo Rumiz.
Né à Trieste en 1861, Ettore Schmitz, qui prit le nom de plume d’Italo Svevo (mot à mot: Italien Souabe) est l’un de ces écrivains discrets… mais majeurs. Enfant de la bourgeoisie multiculturelle de Trieste (un père juif allemand aux origines rhénanes et hongroises; une mère italienne originaire de Vénétie), au croisement des mondes germanique et vénète, Svevo découvre Schopenhauer alors qu’il suit en Bavière la formation d’une école de commerce où l’avait envoyé son père et entreprend, tout en travaillant d’abord dans la Banque puis à la tête d’un entreprise de négoce, de construire une œuvre romanesque qui ne parvint pas à rencontrer son public. Après deux échecs (Une vie – 1892; Senilità – 1898) et avoir abandonné l’écriture pendant près de vingt ans, Svevo rencontre à Trieste, pour les besoins du développement de l’entreprise de négoce qu’il dirige, un jeune irlandais qui lui enseigne l’anglais: James Joyce. Cette rencontre, et l’amitié qui s’en suit, est l’une des plus importantes de l’histoire de la littérature moderne: encouragé par Joyce, qui a lu avec admiration ses deux précédents livres, en quelques mois, Svevo rédige La Conscience de Zeno, publié en 1923, que l’écrivain irlandais aide à faire connaître, notamment à l’étranger.
Il faut dire qu’à une époque où le roman se cherche de nouvelles formes, Svevo aura bousculé les règles du jeu. Et on ne s’étonne pas qu’il ait fallu un Joyce pour être sensible à son génie. Le roman, en effet, peut désorienter: pas de trame continue, pas de héros exemplaire, pas de rédemption; seulement un homme qui pense, doute, se contredit et s’observe vivre. Pour cette raison, La Conscience de Zeno est un des grands romans du 20e siècle, qui s’impose comme un jalon du roman moderniste, entre introspection proustienne, ironie joycienne et lucidité freudienne.
Le titre lui-même participe de cette modernité: La Conscience de Zeno – comme si, dès l’incipit, le roman assumait de lui-même une forme d’ambiguïté dans cela même qu’il nous donne à lire. Si Zeno a constamment mauvaise conscience, cette histoire est aussi celle en effet d’une prise de conscience – voilà un titre, pour me faire mieux comprendre, qui a dû mettre bien dans l’embarras les traducteurs allemands du roman de Svevo, la langue allemande disposant justement de deux mots, Gewissen et Bewusstsein, la conscience morale et la conscience comme connaissance de soi, là où l’italien coscienza, comme le français conscience, permet justement de ne pas choisir. Cette ambiguité est fondatrice de la démarche du roman. On ne pouvait pas mieux placer un récit-confession sous le double patronage de la plus grande clairvoyance et de l’illusion sur soi!
Le livre lui-même n’est pas un récit chronologique, mais un collage de chapitres thématiques (Le tabac, La mort du père, Le mariage, L’amante, Les affaires, La psychanalyse), comme autant de tiroirs ouverts dans la mémoire de Zeno. Si ce roman ne saurait se concevoir sans Trieste, qui est le cadre permanent de la confession de Zeno, celui-ci ne décrit pas sa ville: il explore ses propres paysages intérieurs, confus, changeants, ironiques. Parmi les scènes clés du roman, celles des innombrables « dernières cigarettes », toutes promises comme les dernières, toutes suivies d’un recommencement immédiat, suffit dès le début du roman à planter le personnage – métaphores parfaites de son rapport au monde : lucide, mais incapable d’agir, du moins le prétend-il.
Car Zeno est un hypocondriaque de génie, hanté par sa faiblesse et son manque de résolution, par ces maladies imaginaires qui l’affectent, qu’il ne nomme jamais mais qui, dans un splendide développement de mauvaise-foi, lui servent de prétexte à une médiocrité qu’il revendique cependant comme une liberté suprême. Et en cela, Zeno est aussi une figure de la modernité. Zeno se définit par sa maladie — sans jamais vraiment la nommer. Il s’invente des symptômes, s’observe sans relâche, transforme chaque évènement en indice de sa dégradation. Mais cette maladie est aussi son alibi, son masque. Que valent d’ailleurs les humiliations qu’il confesse, telle la gifle reçue de son père mourant et racontée dans une scène majeure du roman? Cette gifle est-elle elle-même réelle ou fantasmée, un souvenir humiliant sur lequel Zeno parvient à mettre des mots au cours de sa confession ou un souvenir inventé, dans un retournement ironique de la théorie freudienne du souvenir-écran, pour mener en bateau son psychanalyste? Où est la vérité, le mensonge?
Zeno écrit pour se guérir, mais il ment. À son psychanalyste. À lui-même. À nous. Et il le sait. Ce mélange de lucidité et de mauvaise foi crée un jeu de miroirs fascinant, où le lecteur finit par se prendre à son tour. Témoin, son mariage, scène désopilante où au cours d’une même soirée Zeno finit par demander la main de sa future épouse, Augusta, après avoir été éconduit successivement par ses deux soeurs. Il n’est pas commun d’avouer qu’on a épousé par hasard la bonne personne, après avoir désiré toutes ses soeurs, et continué peut-être de les désirer jusqu’après le mariage! Zeno dit des choses qu’on ne dit pas : qu’il a épousé par défaut, qu’il a désiré toutes ses belles-sœurs, qu’il est fidèle à sa femme… en la trompant. Il nous choque, nous amuse, nous embarrasse. Mais de cette faiblesse, et des lâchetés qui l’accompagnent, Zeno tire une force. Car si Zeno prétend vouloir devenir un homme meilleur, il sait, au fond, que le changement, le vrai, serait une fixation définitive. Or la forme définitive, c’est la mort. Cette mort qui, dans un renversement ironique, finit par abattre tous ceux qui incarnaient autour de lui une force et avaient trouvé leur voie: son père, son beau-père, son beau-frère. Zeno préfère rester en mouvement, insaisissable, imparfait. Témoin cet autre moment fort du roman, où l’humour de Svevo devient même humour noir: la mort de Guido, le beau-frère de Zeno, incarnation de la réussite sociale et physique (Il est beau, riche, joue du violon en virtuose, place son plaisir avant tout et, après avoir ravi le coeur d’Ana, la soeur aînée d’Augusta, dont Zeno était éperdument amoureux, trompe ostensiblement sa femme avec sa belle et jeune secrétaire, dont les charmes ne laissent pas indifférent Zeno qui un jour tente même une approche…). Or que cache la mort de Guido? Un subterfuge de suicide qui a mal tourné? Une tragique comédie? Un acte manqué du narrateur, à qui Guido était venu demander quelques temps auparavant des renseignements sur les substances propres à précipiter ou non la mort de celui qui les ingérerait? La farce du destin? En s’effondrant, Guido confirme en tout cas à Zeno sa théorie : les hommes forts meurent, lui survit — par faiblesse, mais aussi par lucidité.
La Conscience de Zeno est ainsi le roman d’un homme qui veut guérir, mais s’arrange pour rester malade. Un homme qui nous ressemble, un peu trop peut-être. Svevo ne donne aucune leçon de morale, aucun plan de salut – pas même celui de la psychanalyse, emporté, comme tout le reste dans l’entreprise de désacralisation des discours un peu trop sûrs d’eux-mêmes. Il invente, dans cette faille humaine, une forme romanesque d’une étonnante modernité. Et d’une réjouissante drôlerie!
« Avec émotion, je me remémorais mon lointain passé de chimiste. J’évoquais des souvenirs d’analyses authentiques et honnêtes : un tube de verre, un réactif et moi. Le corps analysé sommeille jusqu’à l’instant où le réactif le stimule. Dans le tube, la résistance est nulle, on cède à la moindre élévation de température; la simulation est impossible. Pour complaire au Dr S.., j’inventais sur mon enfance des détails propres à confirmer le diagnostic de Sophocle. Dans le tube, rien de pareil. Tout est vérité. Emprisonné dans l’éprouvette, le corps à analyser, toujours égal à lui-même, attend le réactif et, quand il se présente, lui donne toujours la même réponse. En psychanalyse, jamais les mêmes images ne se reproduisent deux fois, jamais ne se répètent les mêmes mots. Pour désigner cela, le mot analyse convient mal. J’aimerais mieux “aventure psychique”.C’est bien cela: au début d’une séance, on a l’impression d’entrer dans un bois où l’on ne sait trop si on tombera sur un ami ou sur un brigand. L’aventure terminée on n’en sait d’ailleurs pas davantage. En quoi la psychanalyse s’apparente au spiritisme. »
Italo Svevo: La Conscience de Zeno (La Coscienza di Zeno, 1923), traduit de l’italien par Paul-Henri Michel, nouvelle édition revue par Mario Fusco, Folio/Gallimard
Escapades en Europe – mai 25: Romans des années 1920
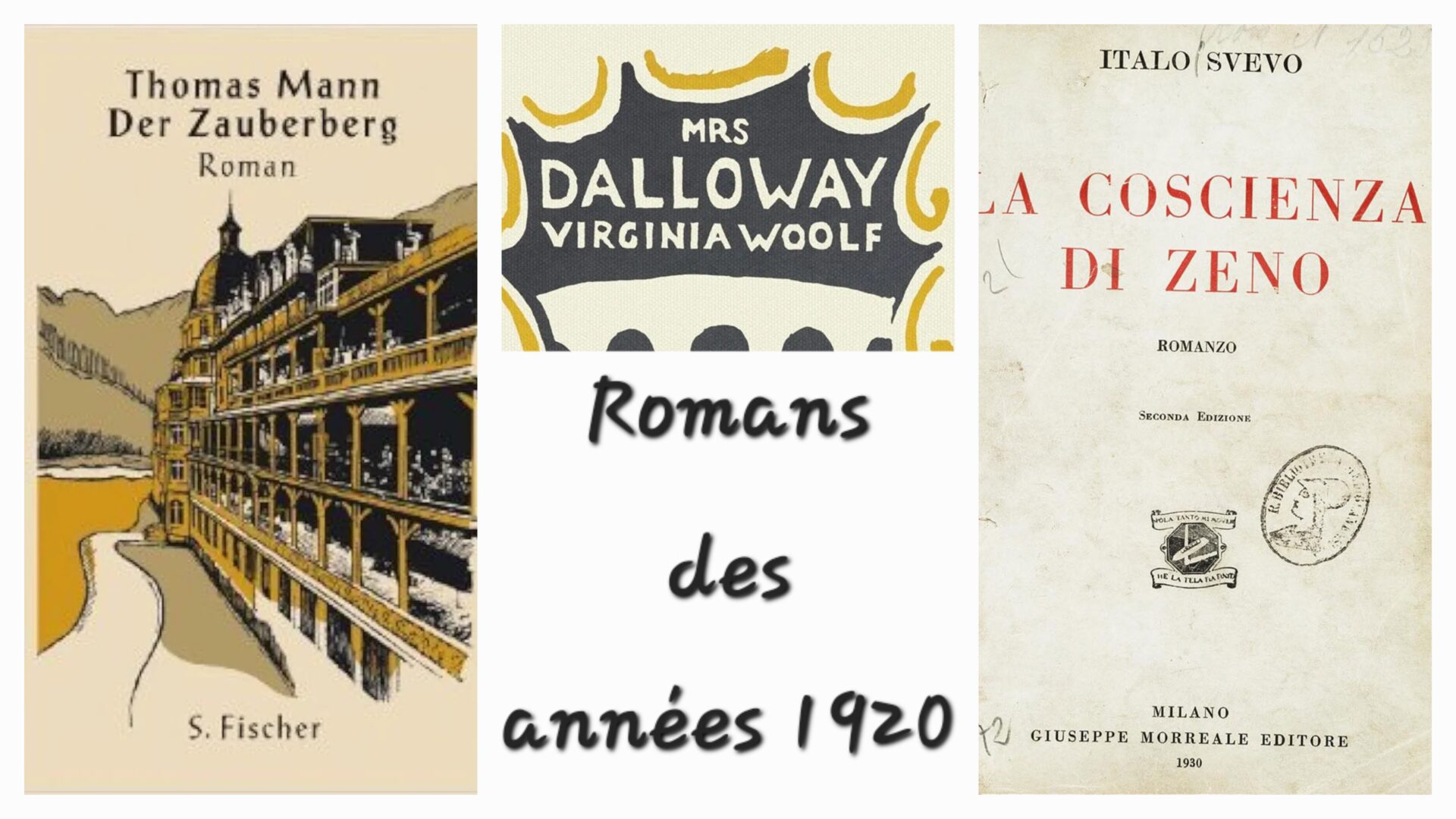
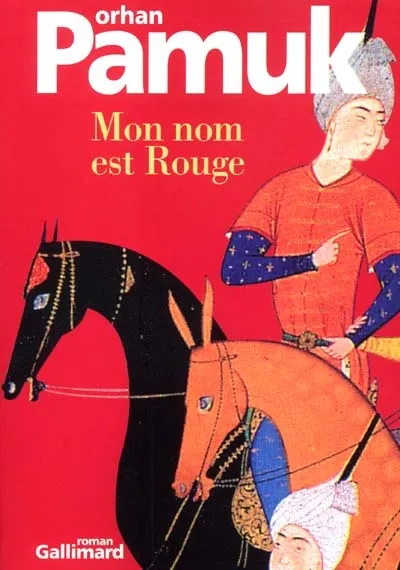
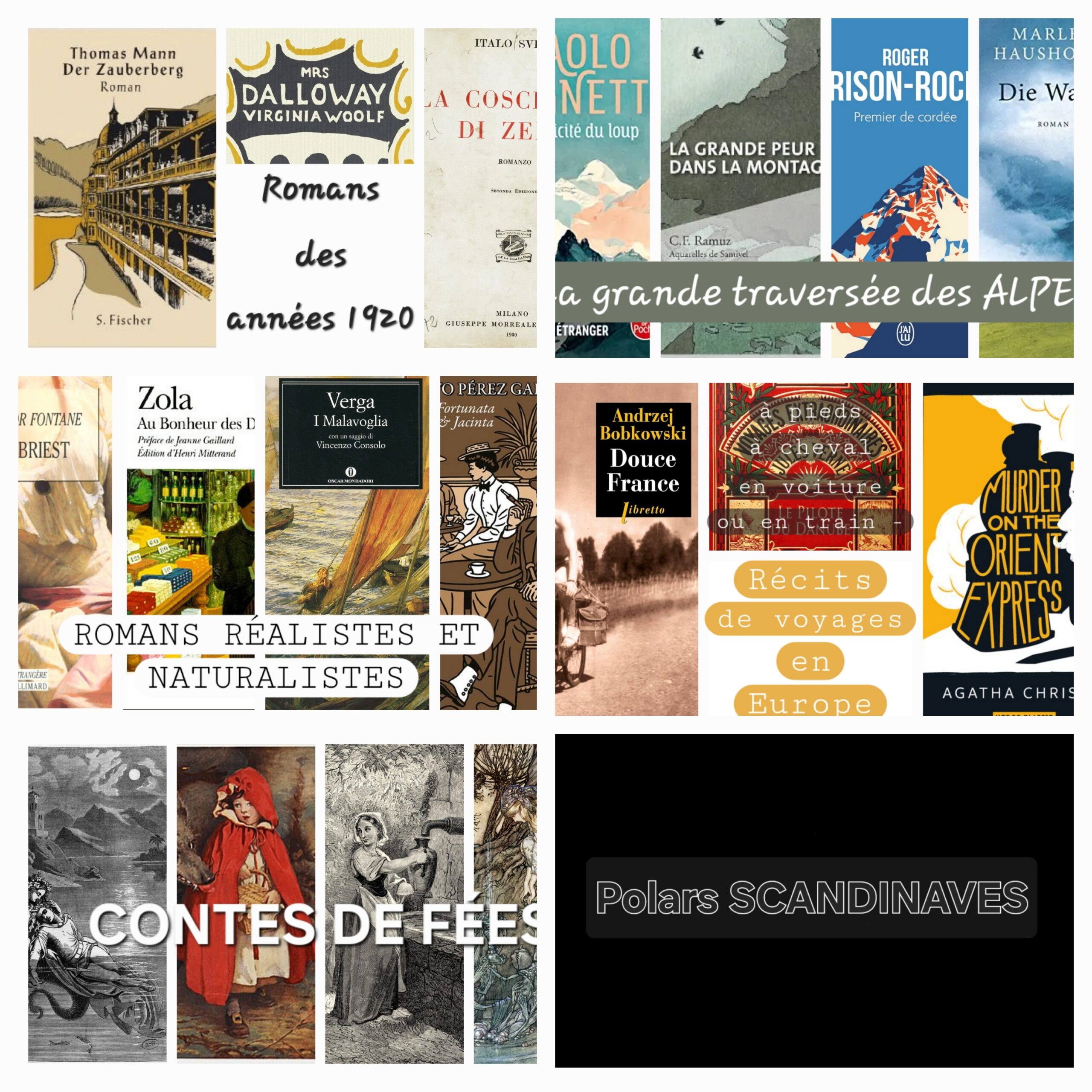
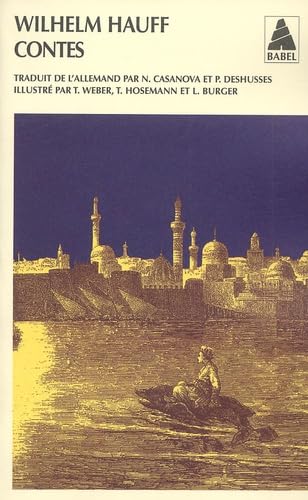
8 commentaires
je lis je blogue · 15 mai 2025 à 7 h 02 min
Bravo pour cette belle analyse de l’œuvre de Svevo ! Je me rends vraiment compte aujourd’hui de l’influence de James Joyce sur la littérature de son temps. Dans Mrs Dalloway, l’ouvrage que j’ai choisi pour cette 1ère étape des Escapades, elle apparait également. Il y a plusieurs points communs entre le roman de Virginia Woolf et celui d’Italo Svevo : les circonvolutions introspectives, par exemple. J’ai hâte de découvrir les choix des autres blogueurs !
Cléanthe · 15 mai 2025 à 10 h 41 min
Je dois avouer que je n’ai encore jamais lu une ligne de Joyce, un manque sans doute au regard des auteurs sur lesquels il a eu une influence et que j’apprécie tout partulièrement…. Il y a un air de famille entre Woolf et Svevo, en effet, mais l’écriture en est très différente. Pour cette raison, je crois préférer Woolf, même si j’ai beaucoup apprécié de découvrir enfin ce roman de Svevo. Merci pour ta participation à ce premier rendez-vous du challenge!
Sacha · 15 mai 2025 à 13 h 19 min
Je ne pense pas que ce soit un roman pour moi, mais ton billet est absolument passionnant. C’est une très bonne idée de nous replacer dans le contexte géographique, politique et littéraire dans lequel ce roman a été écrit. Les années 1920 ont provoqué d’énormes bouleversements à tous points de vue, c’est indéniable à travers le portrait de cet auteur et de son oeuvre.
Cléanthe · 15 mai 2025 à 14 h 22 min
Oui, ce sont des années d’extraordinaire créativité littéraire… mais entre deux tempêtes! il faut dire que l’Histoire n’a pas épargné cette première moitié du 20e siècle, et il y avait sans doute une urgence pour les écrivains à trouver des formes à la hauteur de ces bouleversements. J’aime bien les années 20, parce que malgré le traumatisme de la guerre, le futur reste encore ouvert. Dix ans plus tard, ce sera une tout autre histoire!
Ingannmic · 16 mai 2025 à 8 h 29 min
Ah, Joyce… encore un incontournable que je ne lirai sans doute jamais ! Je serais assez tentée par ce titre en revanche, à tester donc !
Cléanthe · 16 mai 2025 à 10 h 37 min
J’ai essayé de lire Ulysse, qui m’est tombé des mains. Mais je ne désespére pas de retenter l’expérience.
nathalie · 18 mai 2025 à 12 h 42 min
On me l’a prêté et j’ai tellement aimé que je l’ai acheté. Je pourrai donc le relire, un jour en l’autre. C’est un roman passionnant, avec ce narrateur qui trompe son lecteur (et tu l’as décortiqué avec passion !).
Cléanthe · 18 mai 2025 à 14 h 20 min
Oui, je voulais le lire depuis longtemps, et je n’ai pas été déçu. Je pense cependant que la traduction fait passer à côté de certaines choses, Svevo s’exprimant dans un italien (le toscan), qui reste pour lui une langue étrangère. Je tenterai sans doute un jour l’aventure de découvrir cela en VO.