Annie ERNAUX: Les Armoires vides
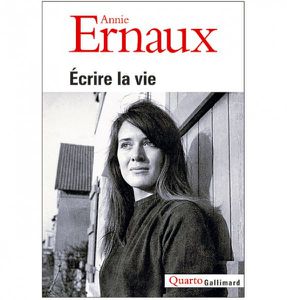 Au cours de son avortement par une faiseuse d’ange, une jeune fille, coincée dans sa chambre d’étudiante, se remémore son enfance. De la honte, de la douleur surgissent comme dans un coup de poing de plus de 200 pages le souvenir de ces années passées entre l’école, où elle réussit brillamment, et le café-épicerie familial, dans un faubourg d’Yvetot, en Normandie.
Au cours de son avortement par une faiseuse d’ange, une jeune fille, coincée dans sa chambre d’étudiante, se remémore son enfance. De la honte, de la douleur surgissent comme dans un coup de poing de plus de 200 pages le souvenir de ces années passées entre l’école, où elle réussit brillamment, et le café-épicerie familial, dans un faubourg d’Yvetot, en Normandie.
Après ma découverte mitigée des Années, dont je veux bien reconnaître aussi qu’il est un livre important, il fallait que je revienne à Annie Ernaux, tellement l’insatisfaction de ma lecture de ce livre était associée au souvenir de pages superbes de dénuement. Son projet, d’une sincérité absolue, la radicalité de sa position esthétique réclamait donc que j’y revienne. Une façon aussi peut-être d’éclaircir ma position face à une certaine forme de la littérature française contemporaine – ce tropisme français centré sur le récit de soi et le refus radical des métaphores, le mouvement déprimant d’une littérature pour laquelle il n’y a rien à sauver, mais seulement une nécessité de dire, c’est-à-dire d’arracher des situations, des figures au cours aliénant d’une existence dans le dessein toujours renouvelé de restituer la vie. Or il faut dire qu’Annie Ernaux est la plus grande de tous sans doute en la matière.
Au risque de contredire immédiatement cette idée d’un tropisme français, je dois dire que ces Armoires vides m’ont fait immédiatement penser à une autre auteur, qui n’a rien de français : depuis Les exclus d’Elfriede Jelinek, je n’avais jamais lu en effet rien d’autre d’aussi radical ni d’aussi violent. Le style est touffu. L’énonciation tient comme dans une expiration, qui est un cri de souffrance, la plainte sauvage d’une bête traquée. Pas de pause dans la phrase, ni même entre les phrases qui permette au lecteur de reprendre sa respiration. Nous voici donc coincé, comme cette jeune fille qui en des temps antérieurs à la loi de Simone Veil sur l’IVG attend sur le lit de sa chambre d’étudiante que le travail initié par la faiseuse d’ange se fasse, portant au creux de son ventre sa révolte, ce mixte de honte et de volonté de revanche, cette existence séparée entre deux moitiés inconciliables qui est la condition des filles du peuple qui ont réussi.
D’emblée, Annie Ernaux nous précipite de l’autre côté du miroir de la méritocratie, de l’intégration sociale à la française. La réussite est une machine à produire de la haine. Pour intégrer cette existence bourgeoise, cultivée, raffinée qui est la sienne aujourd’hui, il lui a fallu apprendre à haïr son milieu. La découverte de la beauté des textes et des raffinements de la culture scolaire est aussi un lent exercice de la haine : du café familial, repère d’ivrognes, de vieux qui lui reluquent la culotte, avec sa tinette au fond de la cour, les propos grossiers qu’on y échange, le manque de raffinement, la laideur des murs et de l’ameublement ; une haine aussi, et c’est plus grave, de l’amour parental, de la sollicitude même de sa mère : les pages où on la voit offrir à sa fille, parce qu’elle aime lire, des romans à l’eau de rose , des revues sentimentales que lui conseille le marchand de journaux-tabac sont particulièrement poignantes. Dès son premier roman, l’inspiration d’Annie Ernaux est déjà bourdieusienne. La culture est fondée sur la séparation.
Mais c’est une inspiration sociologique qu’Annie Ernaux prend en charge du côté du roman, d’une écriture romanesque, centrée sur la représentation d’une expérience existentielle (la sienne, même si dans ce premier roman elle prend encore la forme d’un personnage de fiction) : l’expérience existentielle d’un être divisé. D’emblée Annie Ernaux, cette grande amatrice de Proust, produit une version aggravée de La Recherche du temps perdu, dans une vision presque panique, où le côté de chez Swann et le côté de Guermantes seraient séparés à jamais. Pas de bal de têtes chez Annie Ernaux. L’exercice de mémoire de son héroïne échoue non dans le grotesque et la satire sociale du Temps retrouvé mais dans les contractions douloureuses d’une fille en train d’avorter.
Moins abouti sans doute sur le plan formel que Les années, plus brusque et plus brutal, Les armoires vides ont cependant l’avantage pour moi de rester concentré sur le récit d’une expérience individuelle dans ce qu’elle a de singulier (les pages qu’elle consacre à sa jeunesse dans Les années sont d’ailleurs celles que je trouve les plus réussies). Roman de la division, de la rupture, elle est une très belle réflexion aussi sur l’aliénation et les usages de la langue. Cette adolescente qui se sépare de son milieu est d’abord une fille qui n’a pas les mots pour nommer sa condition que ne sauraient lui donner non plus encore la culture scolaire : « Je n’ai jamais pensé que les différences puissent venir de l’argent, je croyais que c’était inné, la propreté ou la crasse, le goût des belles affaires ou le laisser-aller. Les soûlographies, les boites de corned-beef, le papier journal accroché au clou près de la tinette, je croyais qu’ils les avaient choisi, qu’ils étaient heureux. Il faut des tas de réflexions, des lectures, des cours, pour ne pas penser comme çà, surtout quand on est gamine, que tout est installé. » Les pages qu’elle consacre aux mots des écrivains sur son milieu, à la distance qu’il s’agit pour elle de maintenir avec un certain usage de la langue, qui embellit ou considère avec condescendance, sont au fondement de son esthétique.
Je ne sais pas dire encore cependant si j’aime ou pas. Ce n’est peut-être pas le propos. Comme pour Jelinek, dont je parlais plus haut. La radicalité du projet de ces deux écrivains se mesure sans doute à ce que leur œuvre est bâtie pour l’une comme pour l’autre sur un semblable refus de l’horizon d’attente esthétique qui motive habituellement nos lectures. Une question qui reste à éclaircir, ce dont le judicieux recueil de douze des romans d’Annie Ernaux que publie Gallimard sous le titre d’Ecrire la vie va fournir l’occasion.

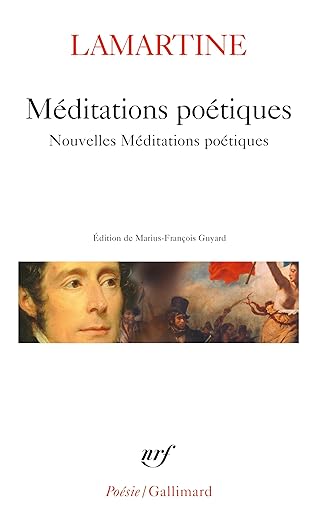
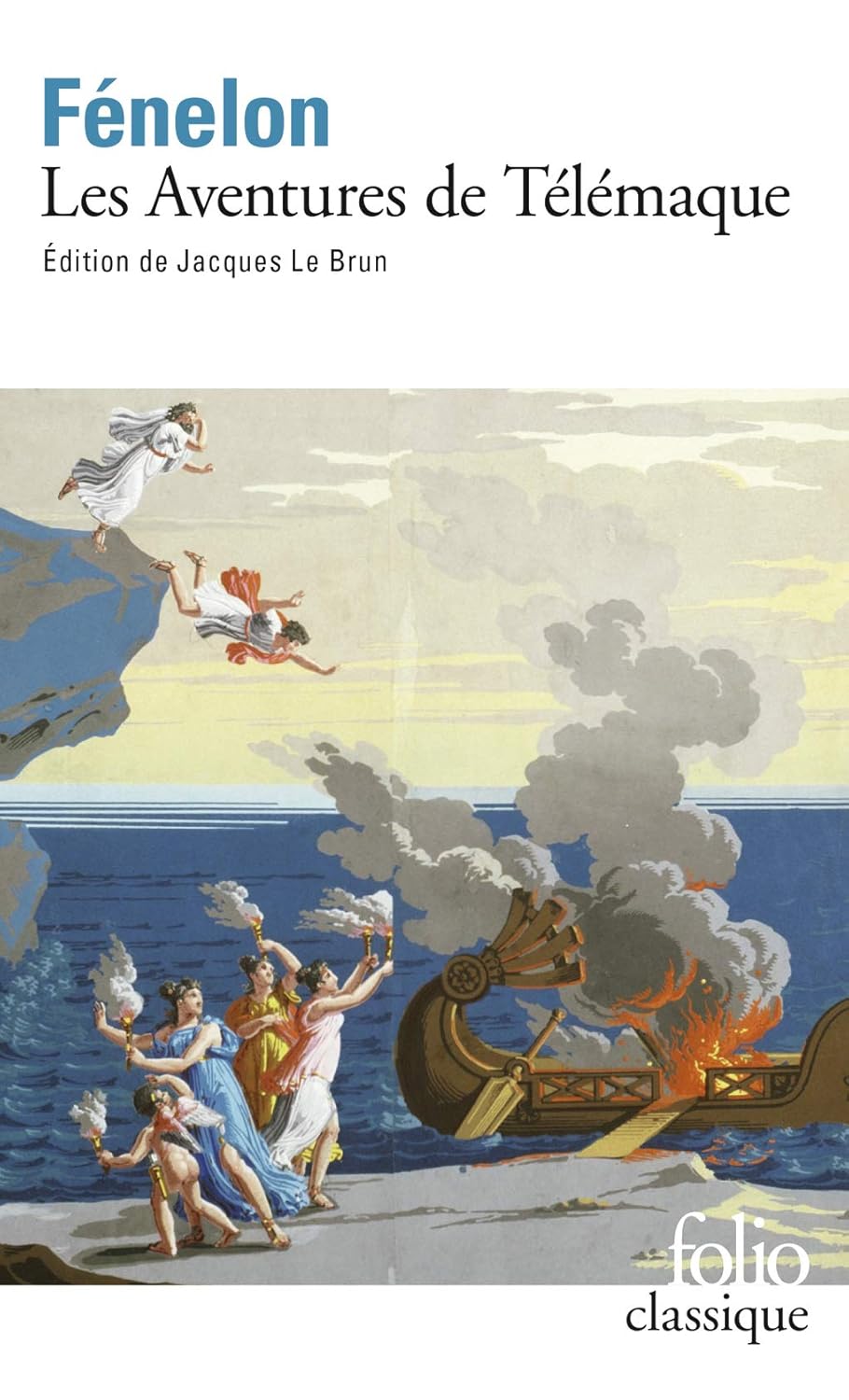
7 commentaires
Delphine · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Et, oui, je vais lire les Armoires vides et vous dire ensuite ce que j’en pense
Delphine · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Bonsoir Cléanthe, figurez-vous que votre blog m’a enchantée par sa passion contagieuse de la lecture, ses challenges et ses lectures suivies de Zola ou James… je n’ai pas fini d’en faire le tour
(je suis tombée dessus par hasard, cherchant des infos sur Ernaux). Du coup j’ai décidé d’en créer un pour consigner comme vous mes notes de lecture. Je ne sais pas si j’y serai aussi fidèle
assidue que vous sur le vôtre. Mais si mon point de vue d’historienne à propos de ce bouquin vous intéresse, mon 1er et unique article à ce jour est bel et bien dédiée aux « Années » !
Bien à vous, Delphine
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Delphine: je cours faire un tour sur votre blog.
Delphine · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
Je n’ai lu que « Les Années » et je suis comme vous : la partie que je préfère est l’évocation des années 40 et 50 car le « on », d’abord, s’accommode de la mémoire floue des années d’enfance, où « le
monde » se réduit à l’entourage proche, mais aussi parce que cette première partie apporte un regard ethnographique sur les années d’après-guerre, avec des relents immémoriaux drainés par les
« récits des dimanche ». Or ce regard d’ethnographe m’intéresse moins en ce qui concerne les années post-68 dans la mesure où ces dernières ont accouché du monde que je connais (un peu).
Pour rebondir sur l’emploi du « on » par Annie Ernaux, il me semble être une trouvaille littéraire qui vise à la compréhension du monde tel qu’il est, et à la réduction de l’écart entre le « moi » et
le « eux », l’individu et la masse, le un et le tout. Certes il ne s’épargne pas de généralisations, de « tableaux » brossés rapidement et de façon « définitive ». Mais il résonne beaucoup en moi, qui
suis historienne, car il est comme une porte d’entrée vers un passé que je n’ai jamais connu et qui me provoque pourtant tant de nostalgie. Son absence de métaphore, dans ses textes, est pour le
lecteur un repos, comme une cure d’austérité, et justement, encore, un moyen d’identification. D’ailleurs, j’aimerais lui dire qu’il n’y a pas besoin d’avoir été fille d’épiciers pour s’être senti
« dominé » dans son enfance et sa jeunesse… Enfin, là j’introduis la psychanalyse, bonjour le folklore !
Merci de vos critiques fines, pertinentes et éclairantes d’une auteur qui ne laisse pas indifférent !
Delphine
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Delphine: merci pour vos compliments, et pour votre commentaire qui enrichit encore ma compréhension de cette auteure importante. Je me demandais justement comment le travail
d’Annie Ernaux pouvait etre perçu par un/une historien/ne. Sur la question de la domination, je vous conseille justement la lecture de ces Armoires vides. Merci de me dire ce que vous en
pensez si vous me faites l’amitié de repasser par là.
Midola · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
« Les années » m’attend depuis Noël sur ma table de nuit sans que j’arrive à me décider. Mais peut-être que ton incertitude à savoir si tu aimes ou non cet auteur me donne envie de tenter
l’expérience. J’ai lu, il y a quelques années, « La Place » dont je n’ai pas gardé de souvenir très net…
Cléanthe · 30 novembre -0001 à 0 h 00 min
@Midola: j’ai hâte de savoir ce que tu en penses.