Ödön von HORVÁTH: Le Belvédère
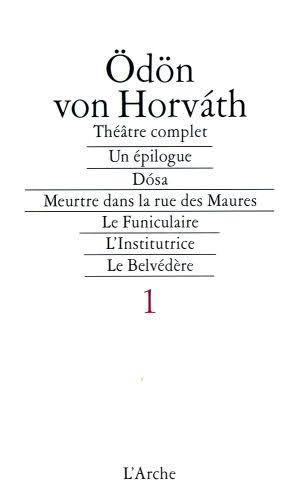
Dans un hôtel qui n’a plus rien de reluisant, pompeusement baptisé « À la belle vue », s’agitent des vies médiocres. Strasser, le patron, au vague passé de vedette de cinéma, rêve encore de gloire et de bonnes affaires qui ne viennent pas. Max, le serveur, ex-affichiste, et Karl, le chauffeur, au passé trouble, constituent le maigre personnel de l’établissement. Seule cliente de l’hôtel, Ada von Stetten, une baronne vieillissante, nymphomane et alcoolique, paie pour se donner l’illusion du pouvoir sur ces hommes qu’elle entretient — patron, chauffeur, serveur — trois ratés qui survivent tant bien que mal. Un représentant de commerce, venu tenter de récupérer le paiement d’une caisse de mauvais Champagne, passe ses journées à attendre sa revanche sur le monde, à rêver d’un « homme fort » providentiel. Et puis reviennent des fantômes : un frère ruiné par le jeu, venu implorer sa sœur, et surtout Christine, jeune femme abandonnée, enceinte du patron, qui réclame une responsabilité refusée. Dans ce huis clos délabré, chacun calcule, ment, s’allie et trahit. Peu à peu, tous se liguent pour effacer Christine, dans une comédie qui glisse insensiblement vers la cruauté et l’effroi…
J’ai saisi l’occasion d’une lecture commune d’Un fils de notre temps, organisée récemment en hommage à Goran, pour continuer à flâner quelques temps dans l’oeuvre d’Ödön von Horváth, dont j’avais aussi apprécié naguère le théâtre, des comédies grinçantes dénonçant la médiocrité des individus et l’emprise du pouvoir.
Le Belvédère (titre original: Zur schőnen Aussicht, « A la belle vue ») est l’une d’elle. Écrite en 1926, cette pièce d’Horváth, parmi les premières de l’auteur, qui ne sera finalement jouée qu’en 1969, frappe avant tout par sa lucidité. Derrière les dialogues vifs, les situations presque burlesques, caractéristiques d’une sorte de comédie de boulevard à la sauce de l’Europe centrale, le vrai sujet ne tarde pas en effet à paraître: la lâcheté collective, la facilité avec laquelle un groupe choisit de se protéger en sacrifiant la plus fragile. Car si le rire, d’abord, est là — des répliques qui fusent, le grotesque des postures, le ridicule des situations – le rire cependant se fige vite. Le spectateur comprend bientôt qu’il assiste moins à une farce qu’à un mécanisme social: comment une communauté s’invente un récit pour se décharger de ses fautes, comment l’opportunisme et la médiocrité préparent la violence.
Le hall d’un hôtel delabré, la salle à manger, un couloir avec des portes ouvrant sur des chambres – tels sont les lieux à travers lesquels nous promènent les trois actes de la pièce. On ne sort jamais de l’hôtel Belvédère dont le nom nous promet cependant trompeusement une « belle vue » (Hôtel Bellevue pourrait être une autre traduction du titre) qu’on ne verra jamais donc, mais qui se referme au contraire sur une bien mesquine affaire.
Car Horváth excelle avant tout à faire d’un lieu clos un laboratoire social où se joue une époque. Pouvoir, sexe, argent : tout circule en petites transactions, tout s’achète ou se troque, sauf la vérité, que Christine incarne malgré elle. Elle n’est pas une sainte, seulement une jeune femme obstinée qui refuse d’entrer dans la comédie des faux-semblants. C’est assez pour que les autres s’acharnent contre elle. Sous le vernis du rire, Horváth dévoile ainsi le visage inquiétant d’une société prête à écraser plus faible qu’elle. En cela, Le Belvédère n’est plus seulement un vaudeville grinçant: c’est déjà un diagnostic, presque une prémonition. À travers ces personnages médiocres, il nous montre combien la brutalité politique peut naître du quotidien, des petites lâchetés partagées. La « belle vue » promise par l’enseigne n’offre en réalité aucun horizon, sinon celui d’une humanité qui se ment à elle-même. Un bel exercice de lucidité !

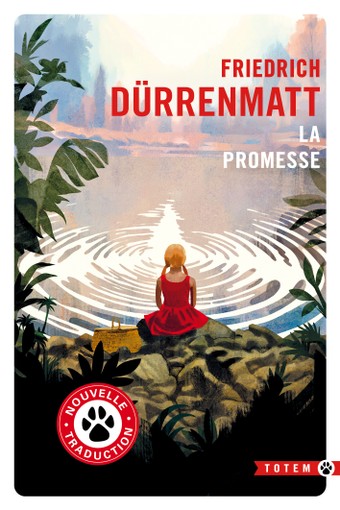
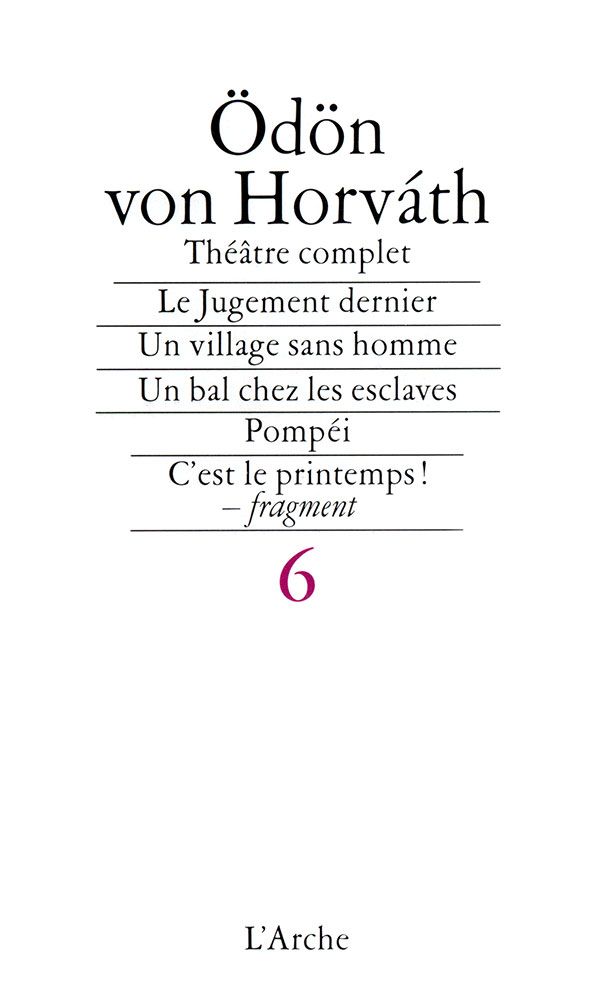
6 commentaires
Ingannmic · 19 septembre 2025 à 8 h 31 min
Une belle proposition pour continuer la découverte de cet auteur, c’est noté !
Cléanthe · 19 septembre 2025 à 15 h 32 min
C’est un auteur qui mérite qu’on y passe quelques temps en effet.
PatiVore · 19 septembre 2025 à 20 h 17 min
Je note cet auteur pour les Feuilles allemandes en novembre 😉
Cléanthe · 20 septembre 2025 à 18 h 04 min
Je te souhaite une bonne lecture alors!
Sacha · 9 octobre 2025 à 10 h 47 min
Tous vos billets sur « Un fils de notre temps » m’avait déjà incitée à me pencher sur l’oeuvre de von Horvath. Commencer par son théâtre me semble une très bonne idée. Cette critique sociale acerbe me rappelle par ailleurs « La visite de la vieille dame » de Dürrenmatt, une pièce que j’avais beaucoup aimé pour son acidité et sa lucidité.
Cléanthe · 10 octobre 2025 à 16 h 27 min
Je n’avais pas pensé à Dürrenmatt, mais tu as raison, les deux univers sont assez comparables.