Orhan PAMUK: Mon père et autres textes
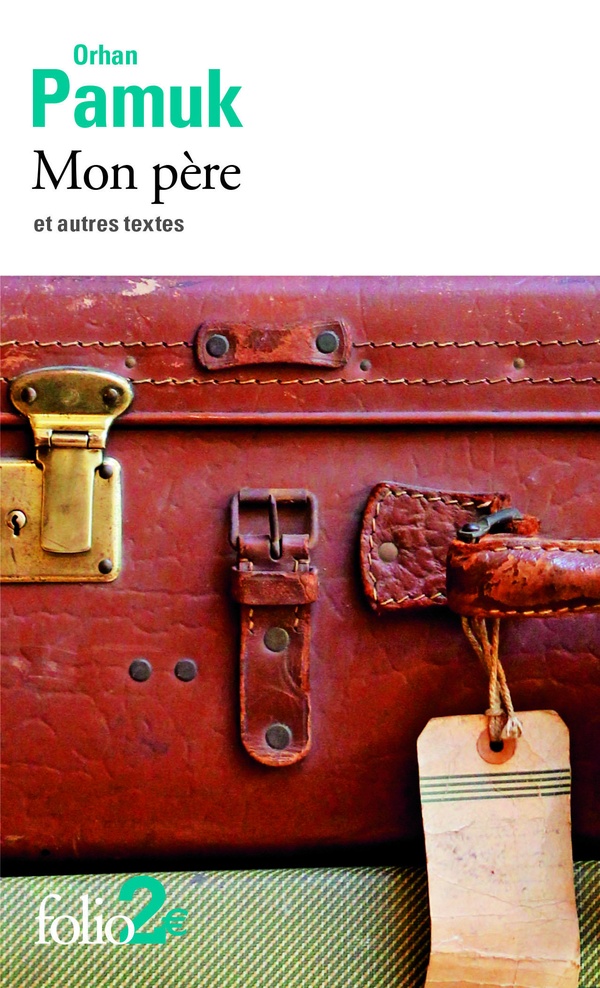
Dans un taxi en route vers l’enterrement de son père, dans la Turquie des années 1950-1960, observant depuis une fenêtre la vie familiale et le monde extérieur, dans un mélange de jeux, de conflits et de douce mélancolie, en 2006 à Stockholm, dans le discours prononcé lors de la remise de son prix Nobel, Orhan Pamuk laisse affluer les souvenirs et esquisse le portrait d’un homme insaisissable, son père, dont la légèreté et les silences ont façonné l’écrivain qu’il est devenu. Trois moments, trois formes, mais un même centre de gravité: la figure du père, présence discrète mais déterminante, miroir, soutien et énigme, à travers laquelle Orhan Pamuk interroge à la fois l’origine de l’écriture et ce qui se transmet, parfois à voix basse, d’une génération à l’autre…
Après Mon Nom est rouge, plongée dans l’Istanbul du 16e siècle, dont la lecture m’a impressionné, j’ai voulu poursuivre un peu en compagnie d’Orhan Pamuk. Mais comme je ne me sentais pas de me lancer de nouveau, et si vite, dans l’un de ses massifs pavés, même si certains me tentent déjà, je suis tombé avec plaisir sur ce petit recueil de trois textes courts. Je n’ai découvert qu’une fois ma lecture achevée qu’il était composé en fait de textes qui avaient d’abord été publiés dans D’autres couleurs (un autre pavé de l’auteur!), où j’irai sans doute un de ces jours les retrouver. En tout cas, ce petit recueil se révèle très bien fait, et très touchant. C’est un hommage à la fois doux et incisif à la figure paternelle, mais aussi une méditation sur ce qui pousse un être à écrire, et sur la manière dont l’écriture nous relie aux autres.
Avec Mon père, texte très court, Orhan Pamuk convie son lecteur à un voyage intime et littéraire, où la mémoire personnelle se mêle aux réflexions sur l’écriture. Dans un taxi, en route vers l’enterrement de son père, la mémoire de l’écrivain s’ouvre. Le père, figure légère, insaisissable, réapparaît dans l’esprit de l’auteur. En quelques pages, Pamuk nous fait sentir la complexité de ce lien: un père à la fois proche et distant, dont la légèreté a marqué l’enfant et l’écrivain qu’il est devenu. C’est un hommage pudique, mais d’une grande profondeur, où l’absence se fait sentir dans chaque souvenir.
Le deuxième texte, Regarder par la fenêtre, s’étire davantage, nous transportant dans la Turquie des années 50-60, au cœur de l’enfance de l’auteur. Ce texte a des accents presque romanesques: il nous fait revivre les scènes familiales, les chamailleries, les jeux d’enfants, mais toujours sous l’œil de cette figure paternelle, à la fois présente et ailleurs, qui se rêva écrivain et finit même par quitter quelques temps sa famille pour partir à Paris. Et puis, il y a aussi cette fenêtre à laquelle régulièrement chacun revient dans la famille, pour regarder la rue, les voisins, pour attendre le retour d’un père, d’un mari, pour laisser aussi simplement le regard flotter dans le vide. Dans Regarder par la fenêtre, le motif organise ainsi tout le texte. La fenêtre devient un poste d’observation à la fois banal et décisif, depuis lequel l’enfant Pamuk découvre le monde sans encore y prendre pleinement part. Il y regarde la rue, les passants, les petits événements du quotidien, mais aussi la vie familiale elle-même, comme si elle pouvait être tenue à distance. Ce regard en retrait dit beaucoup de la position future de l’écrivain: être là, au cœur des choses, tout en conservant une légère séparation, indispensable pour voir, comprendre et transformer le réel en récit. La fenêtre matérialise ainsi une posture essentielle chez Orhan Pamuk: celle de l’observateur attentif, à mi-chemin entre l’intimité vécue et le monde devenu matière littéraire.
Enfin, le troisième texte, La valise de mon père, est en fait le discours que Pamuk prononça lors de la cérémonie de remise du prix Nobel en 2006. Ici, l’hommage à son père prend une dimension encore plus poignante: Pamuk évoque une valise pleine d’écrits paternels, qu’il a longtemps hésité à ouvrir. À travers cette valise, il confronte les tentatives modestes de son père et sa propre vocation. Et exprime à son égard une véritable gratitude, montrant, au moment de recevoir le Nobel, comment, malgré les doutes, ses absences aussi parfois, c’est le soutien de son père qui l’a conduit à persévérer et à devenir le premier (et aujourd’hui encore) le seul écrivain turc à recevoir le prix Nobel de littérature.
J’ajouterai qu’au fil de ces trois textes, Pamuk déploie une langue subtile, empreinte de poésie, du moins à ce que permet d’en saisir la traduction, très élégante. Une langue qui interroge bien souvent le sens même de l’écriture. C’est une force qui relie, dit Pamuk, qui éclaire l’histoire et nous aide à comprendre le monde. Bien plus qu’un simple hommage le recueil de ces trois textes est ainsi une réflexion sur l’héritage, sur ce qui reste de ceux qui nous ont précédés, et sur l’acte d’écrire comme une façon de les prolonger. Un petit bijou autobiographique, où la lumière de la littérature éclaire, avec modestie, les replis de l’âme humaine.
« Pour autant, notre solitude dans cette chambre où nous nous enfermons n’est pas si grande que nous le croyons. Nous sommes environnés des mots, des histoires des autres, de leurs livres, de tout ce que nous appelons la tradition littéraire. Je crois que la littérature est la somme la plus précieuse que l’humanité s’est donnée pour se comprendre. Les sociétés humaines, les tribus et les nations deviennent intelligentes, s’enrichissent et s’élèvent dans la mesure où elles prennent au sérieux leur littérature, où elles écoutent leurs écrivains, et, comme nous le savons tous, les bûchers de livres, les persécutions contre les écrivains présagent pour les nations des périodes noires et obscures.
La littérature n’est jamais seulement un sujet national ; l’écrivain qui s’enferme dans une chambre avec ses livres, et qui initie avant tout un voyage intérieur va y découvrir au cours des années cette règle essentielle : la littérature est l’art de savoir parler de notre histoire comme de l’histoire des autres et de l’histoire des autres comme de notre propre histoire. Pour arriver à ce but, nous commençons par lire les histoires et les livres des autres. »Orhan PAMUK, La valise de mon papa – Conférence du Nobel – 7 décembre 2006, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy et Gilles Authier
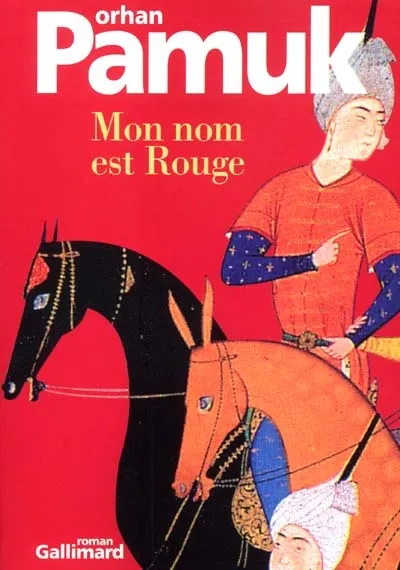
0 commentaire