Marie DOCHER: Pourquoi les lesbiennes sont invisibles?
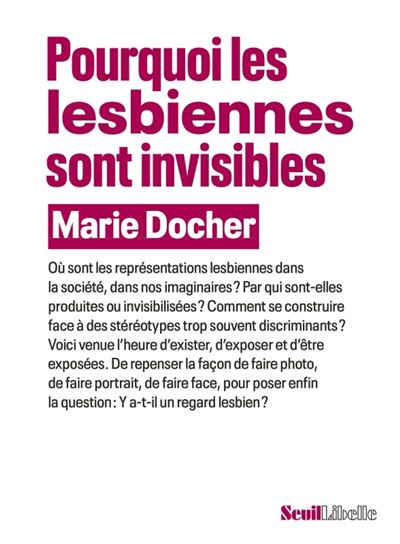
Comment se fabrique l’invisibilité ? Pourquoi certaines existences, certains désirs, certaines images semblent-ils voués à disparaître du champ commun ? Qu’est-ce qui, dans la culture, dans les institutions, dans nos habitudes de regard, rend si difficile la pleine visibilité des lesbiennes ? Photographe, réalisatrice et féministe engagée, Docher interroge les mécanismes multiples qui, aujourd’hui encore, maintiennent les lesbiennes dans l’ombre: effacement médiatique, désintérêt institutionnel, autocensure dans les milieux artistiques, silences universitaires…
C’est une question que je me pose depuis longtemps: pourquoi si peu de témoignages d’un regard de femme qui aime les femmes, au cinéma, dans la photographie, en littérature, hors peut-être une littérature spécialisée ou un art de niche? Cela va au-delà de la question de l’homosexualité: tout lecteur un peu assidu, quelle que soit son orientation sexuelle, aura déjà eu l’occasion de découvrir le monde, de bâtir une expérience du point de vue d’un Proust, d’un Gide, d’un Baldwin. Où sont les Sodome et Gomorrhe, les Si le grain ne meurt, les La Chambre de Giovanni du lesbianisme? C’est à ce point de mes interrogations que je suis tombé par hasard, en poussant par curiosité l’autre jour la porte d’une librairie militante près de chez moi, sur le petit essai de Marie Dochet. Une lecture passionnante, stimulante, à l’occasion de laquelle j’ai découvert notamment que ce regard existe, mais que la plupart du temps nous ne le voyons pas, ou ne l’identifions pas comme tel. J’y ai appris à regarder autrement les œuvres des artistes que je connaissais déjà: les beaux portraits de femmes au travail de Frances Benjamin Johnston, les tableaux de Rosa Bonheur, notamment. Et rien que pour cela, la lecture de l’essai de Marie Dochet m’a semblé nécessaire.
Loin d’un simple constat sociologique, le livre de Marie Dochet se lit en effet comme une enquête sur les formes d’invisibilisation contemporaines — non pas un oubli passif, mais un phénomène actif, structurel, qui se rejoue dans tous les espaces de pouvoir symbolique. Ce qu’elle décrit, c’est une culture où la reconnaissance des artistes lesbiennes demeure rare, où les financements et les lieux de diffusion se ferment encore dès qu’une œuvre assume une parole minoritaire. L’autrice parle d’un plafond de verre spécifique, fait de petites résistances, d’exclusions tacites, de dissuasions sourdes. Beaucoup d’artistes lesbiennes, dit-elle, préfèrent ne pas afficher leur orientation pour ne pas voir leur carrière compromise. C’est dans ce déni tranquille, plus que dans les attaques frontales, que se joue l’effacement.
L’essai éclaire ainsi un paradoxe contemporain: alors que les droits LGBTQIA+ ont progressé et que la visibilité semble acquise dans les discours publics, le lesbianisme reste souvent traité comme un sujet «réglé», marginal ou anecdotique. Les médias s’y intéressent par à-coups, les institutions le neutralisent. L’autrice le montre bien: l’invisibilité d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier — elle passe par des filtres plus subtils, par le désintérêt, par la saturation d’images sans regard véritable.
C’est là que le propos de Marie Docher rejoint sa pratique photographique. Tout son travail consiste en effet à produire des images où les lesbiennes ne soient plus objets de fantasme ou d’oubli, mais sujets de représentation. Elle plaide pour la nécessité de figures, de visages, de récits dans lesquels les lesbiennes puissent se projeter, s’imaginer, se reconnaître. À ce titre, Pourquoi les lesbiennes sont invisibles? est aussi un texte de militante, porté par la conviction que la visibilité est un acte politique.
Mais c’est aussi là que réside, à mes yeux, une limite du livre. On ne voit pas les photographies dont il parle. Ni reproductions, ni renvois vers un site ou un portfolio: tout se joue dans le discours. Paradoxalement, le livre participe ainsi de la même invisibilité qu’il dénonce. J’aurais aimé pouvoir confronter le texte à ces images, voir ce qu’elles produisent, ce qu’elles déplacent. Non pour juger, mais pour éprouver ce décentrement dont parle implicitement Docher: regarder autrement, à travers un regard qui n’est pas le sien. Car l’expérience esthétique, pour moi, suppose cela: la possibilité d’un décalage. N’étant ni femme ni lesbienne, j’aurais voulu, à travers ses photographies, vivre cette rencontre avec une autre façon d’habiter le visible. Voir comment une sensibilité lesbienne interroge la norme du regard, comment elle réinvente la relation entre corps et image, entre désir et représentation. Peut-être qu’un ouvrage illustré ou une exposition à venir prolongera cette réflexion. C’est le vœu que laisse en tout cas naître ce livre stimulant.
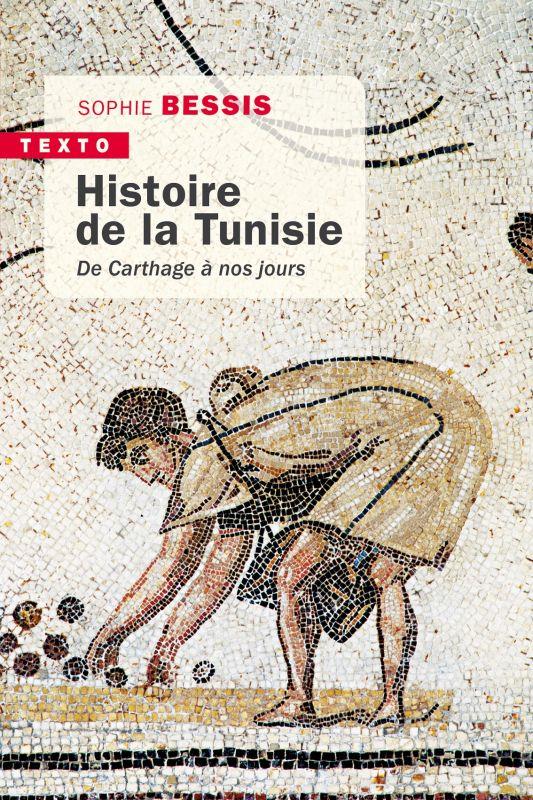
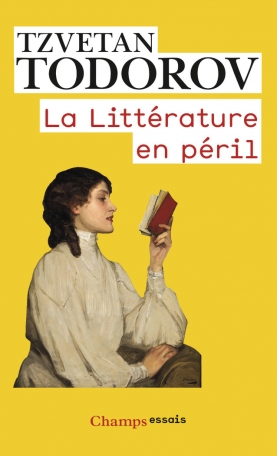
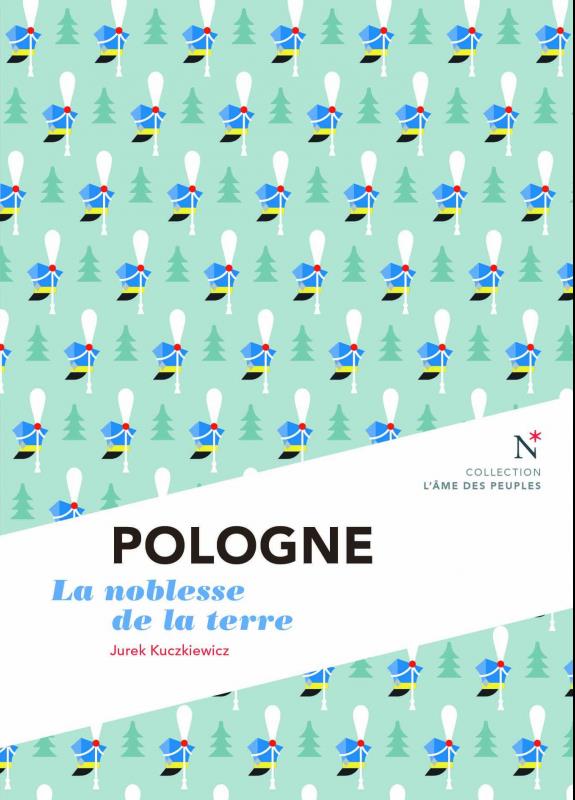
12 commentaires
aifelle · 22 octobre 2025 à 10 h 09 min
Il me semble que de nos jours, davantage d’actrices se revendiquent lesbiennes, ce qu’elles n’osaient pas faire auparavant. Mais tu as raison, on en parle bien moins que des homos hommes par exemple. Je lirais bien cet essai, malgré le manque d’images. C’est dommage en effet.
Cléanthe · 27 octobre 2025 à 18 h 55 min
Ce que j’ai apprécié dans cet essai, c’est le point de vue de la photographe: celle qui regarde, plutôt qu’elle n’est regardé.
keisha · 23 octobre 2025 à 6 h 40 min
Dommage en effet pour les photos, qui sans doute augmenteraient le prix du livre ou demanderaient l’accès à des droits?
J’avoue que je remarque juste plus de visibilité parmi les artistes, humoristes, actrices, chanteuses etc., mais c’est leur talent (ou pas) qui m’intéresse. Mais je suis d’accord, on en parle moins.
Cléanthe · 27 octobre 2025 à 18 h 57 min
Les photos sont accessibles, en faisant des recherches sur internet, pour tous les noms d’artistes citées dans l’essai. Mais c’est vrai que c’est un peu laborieux.
Nathalie · 24 octobre 2025 à 19 h 14 min
Anecdote : à l’expo (très bonne par ailleurs) sur Rosa Bonheur au musée de Bordeaux, les mots lesbienne, couple de femmes, compagnes, n’étaient pas prononcés alors celui de LGBT l’était. Pour te dire, on proclame des trucs mais on surtout on ne dit rien.
Cléanthe · 27 octobre 2025 à 18 h 59 min
D’autant que dans le cas de Rosa Bonheur, cet « oubli » est plutôt fâcheux, comme le montre justement Marie Docher dans son essai.
miriam · 28 octobre 2025 à 16 h 51 min
je note le titre qui m’intéresse. Allez tous.tes voir La Petite Dernière qui est sortie cette semaine au cinéma
Cléanthe · 5 novembre 2025 à 14 h 46 min
Je n’avais pas relevé cette sortie. Merci pour l’info.
Choup · 6 novembre 2025 à 19 h 42 min
Oui, étonnamment, ou pas, les gays ont plus de visibilités que les lesbiennes… je serai moi-même bien en peine de citer 10 artistes lesbiennes! Un titre à découvrir donc.
Cléanthe · 10 novembre 2025 à 17 h 59 min
Oui, un titre intéressant par la façon dont il interroge, en photographe, le regard que portent des femmes sur d’autres femmes, mais où la dimension du désir est étonnamment « invisibilisé » socialement.
Anne-yes · 7 novembre 2025 à 12 h 08 min
Question intéressante. Je note le titre pour mon mois des fiertés en juin. J’ai grandement apprécié le film La petite dernière et j’ai l’intention de lire le livre dont il est tiré.
Cléanthe · 10 novembre 2025 à 18 h 00 min
Oui, j’ai pensé à ton mois des fiertés. Mais cela faisait un peu long pour poster le billet.