Ödön von HORVÁTH: Légendes de la forêt viennoise
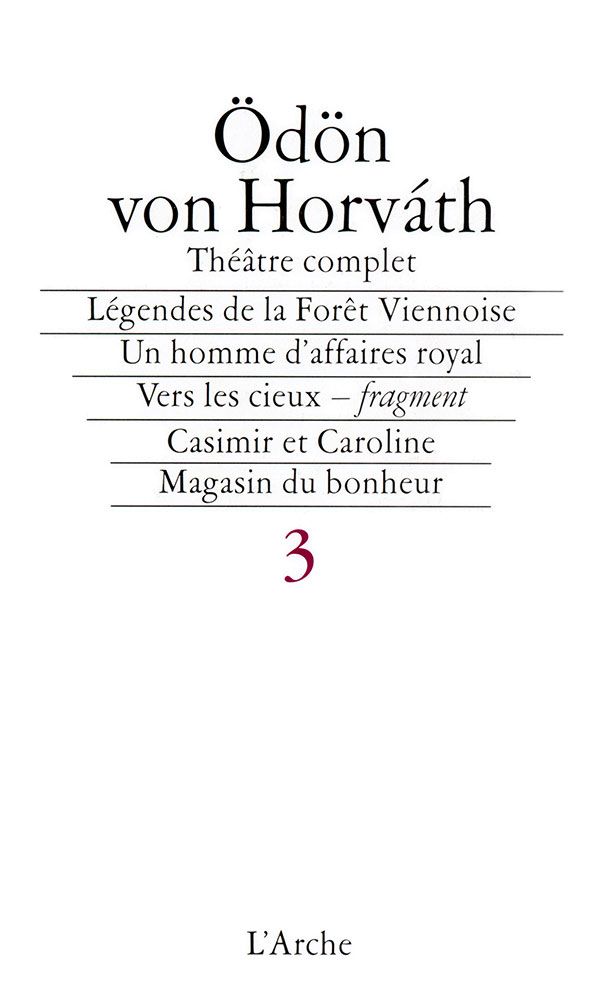
L’action se situe à Vienne, dans les années 1920. Marianne, fille du marchand de jouets Roimage, est promise à Oskar, boucher prospère mais brutal. Elle rêve pourtant d’amour et d’une autre vie. Quand surgit Alfred, beau parleur séduisant, un joueur de courses entretenu par Valérie, une buraliste mûre, l’étau des conventions se desserre un instant: la promesse d’un avenir plus libre semble possible. Mais déjà, derrière la légèreté des chansons populaires et des valses viennoises, l’ombre de la chute se profile…
Ne vous fiez pas au titre : rien ici de bucolique. Dans Légendes de la forêt viennoise, Horváth compose une comédie populaire au ton grinçant, où les valses viennoises et la légèreté supposée des bals masquent à peine la misère et la cruauté d’une société en crise. Créée en 1931 au Theater in der Josefstadt à Vienne, la pièce suit Marianne, fille d’un marchand de jouets, qui rêve d’échapper à son milieu et à son fiancé brutal pour vivre un grand amour. Mais dans cette Vienne des petites gens, régie par l’argent, les préjugés et l’égoïsme, toute tentative d’émancipation se solde par une humiliation ou une chute. Le grotesque se mêle au tragique, dans un enchaînement de situations où les dialogues secs et quotidiens révèlent la bêtise ordinaire, la violence latente et la désagrégation sociale. Il faut dire que, même si Horváth qualifia son œuvre de Volksstück, « pièce populaire », et que le drame s’inspire en effet du théâtre populaire viennois, il en renouvelle profondément la tradition. Au lieu de proposer une comédie de mœurs rassurante, Horváth transforme la fresque des petites gens viennois en drame social. Les personnages, englués dans leurs préjugés et leur médiocrité, ne sont pas libres: ils parlent un «jargon», fait de clichés, de maximes et de formules toutes faites, qui masque mal leur impuissance et leur violence. Les dialogues banals, traversés de silences et de grossièretés, révèlent une aliénation collective.
À travers le personnage de Marianne, seule figure sincère qui évolue de la naïveté bourgeoise à une lucidité tragique, Horváth montre ainsi comment la société broie les individus. Croyant trouver l’amour, Marianne s’enfuit avec Alfred. Mais leur vie bascule vite dans la misère: Alfred l’abandonne, leur enfant est placé à la campagne, puis meurt par négligence volontaire. Déchue, contrainte de danser nue dans un cabaret, Marianne finit rejetée de tous. La pièce se referme sur une scène glaçante: Oskar, son fiancé d’autrefois, peut désormais la « récupérer ». Son dernier mot — « Tu n’échapperas pas à mon amour » — sonne comme une menace, tandis que retentit la valse de Johann Strauss qui donne son titre à la pièce. L’ironie, l’usage des refrains populaires, les valses en contrepoint d’une réalité sordide, créent un effet de distanciation qui invite le spectateur à juger ce monde. En 1931, cette mise à nu des illusions viennoises sonnait déjà comme un avertissement: le fascisme s’insinuait dans les consciences, et les harmonies de Strauss ne suffisaient plus à couvrir le fracas qui s’annonçait.
L’histoire scénique de Légendes de la forêt viennoise en est elle-même révélatrice. Le drame valut en effet à Horváth le prestigieux prix Kleist et connut un triomphe public. Mais la pièce, très vite attaquée par la presse viennoise et l’extrême droite, fut jugée scandaleuse. Les nazis l’interdirent en 1933, jugeant insupportable cette image d’une société gangrenée par l’égoïsme et la médiocrité: Horváth osait montrer derrière le décor d’opérette d’une Autriche de cartes postales la brutalité, la bêtise et l’aliénation qui couvaient sous la surface! Le dramaturge en donnait d’ailleurs la clé dès l’exergue de sa pièce: «Rien ne donne autant le sentiment de l’infini que la bêtise.» Depuis, la pièce n’a cessé d’être reprise sur les scènes européennes, chaque époque y trouvant son reflet amer, entre rire et malaise.
Tout au long de ma lecture j’ai pensé à Brecht — et pas seulement parce qu’en ce moment je passe volontiers de l’un à l’autre : mon mois de septembre a pris des couleurs critiques, comme un fil conducteur de sympathie pour les littératures engagées. Horváth et Brecht: tous deux partagent une veine critique et un goût pour les chansons et la distanciation. On ne saurait cependant les confondre. Là où Brecht construit un théâtre de la démonstration et du raisonnement, Horváth reste plus ambigu, plus populaire, jouant d’un humour noir et d’une ironie cruelle. Chez Brecht, la critique et l’ironie se veulent didactiques ; chez Horváth, elles passent par le rire amer, par le miroir tendu aux médiocrités quotidiennes. Avec Casimir et Caroline (1932) et Foi, Amour, Espérance (1932), Légendes de la forêt viennoise forme ainsi une sorte de triptyque sur l’effondrement moral et social de l’entre-deux-guerres. Trois pièces qui mettent en scène les petites gens pris dans la crise économique, le chômage, l’humiliation sociale, et qui révèlent la fragilité de tout idéal face au cynisme dominant. Horváth, en dramaturge lucide, montre comment l’aspiration au bonheur ou à l’amour s’écrase contre les murs d’une société incapable de donner sens et dignité à la vie. Un théâtre moins théorique que celui de Brecht donc, mais peut-être plus immédiatement corrosif. C’est pour cela que cette lecture résonne si fort aujourd’hui: dans un monde saturé de slogans, de conformismes imposés et de discours populistes, la manière de débusquer les illusions et les faux-semblants dont use Horváth dans son théâtre comme dans ses romans garde une brûlante actualité.

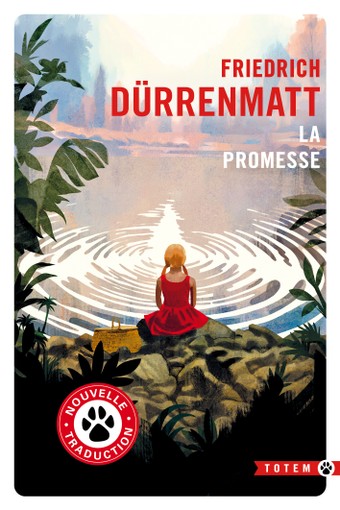
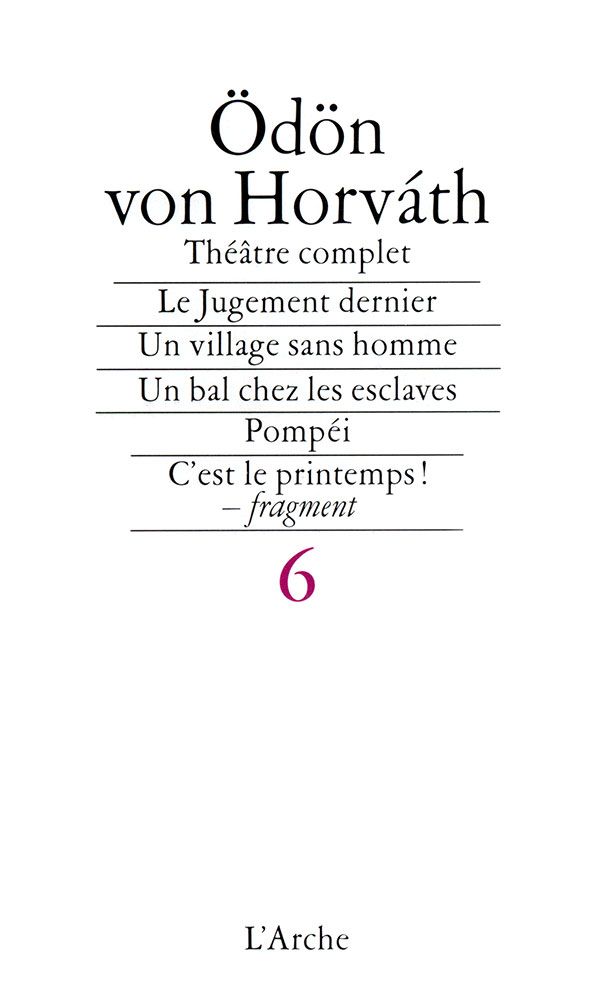
2 commentaires
claudialucia · 3 octobre 2025 à 15 h 32 min
Que j’aimerais voir cette pièce sur scène ! Il faudra que je me contente de la lire, ce qui est intéressant aussi. J’aime beaucoup le contrepoint que tu soulignes entre la musique viennoise et la réalité sordide sur fond de montée du nazisme.
Cléanthe · 3 octobre 2025 à 17 h 27 min
J’aimerais aussi beaucoup la voir. Et voir surtout comment est traité sur scène le contrepoint que tu relèves. Je suis en train de lire un essai sur Horváth qui éclaire assez bien cette question d’ailleurs… Bon, tu l’auras compris, je me suis lancé dans une exploration en profondeur de son théâtre! 🙂