Philip ROTH: La Tache
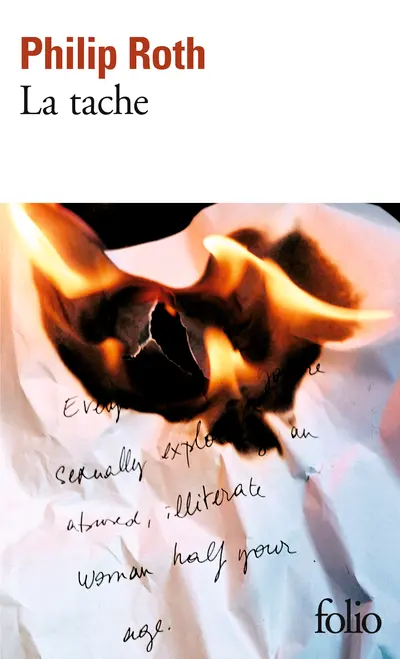
Tout commence par une scène apparemment banale: Coleman Silk, professeur de lettres classiques à l’université d’Athena, s’étonne de l’absence de deux étudiants qu’il n’a jamais vus en cours. Il parle de «zombies» et le mot est aussitôt interprété comme une insulte raciste, car les étudiants en question sont noirs. De ce malentendu naît une affaire qui va embraser le campus, mettre en marche les comités disciplinaires, les procédures, les indignations publiques. Coleman, ancien doyen charismatique, voit alors sa carrière et son nom s’effondrer, tandis que son entourage se détourne de lui. Mais derrière ce scandale universitaire se cache une histoire autrement plus vertigineuse. Car Coleman n’est pas l’homme que tous croyaient…
J’achève avec La Tache ma lecture de la « trilogie américaine ». Merveilleuse maturité d’un immense écrivain! Les trois romans partagent en effet une même obsession: montrer comment l’Amérique se déchire sur ses propres contradictions, comment les vies individuelles sont broyées par les passions collectives. Dans Pastorale américaine, le drame se nouait autour du rêve d’intégration et de réussite, brisé par la violence politique des années 1960. Dans J’ai épousé un communiste, c’est la paranoïa du maccarthysme qui détruit une carrière et un mariage. Dans La Tache, l’arène devient celle de l’université, traversée par les crispations identitaires et la chasse aux fautes morales. À chaque fois, Roth met en scène un homme respecté, enraciné dans une communauté, soudain précipité dans la disgrâce. Mais là où Pastorale américaine a la grandeur tragique d’une épopée, et J’ai épousé un communiste la noirceur d’une tragédie politique, La Tache frappe par son mélange d’ironie et de mélancolie: c’est peut-être le plus intime, le plus amer des trois, où la question de l’identité se double d’une réflexion sur le vieillissement et le désir. C’est un roman plus vif, plus cruel, plus ironique aussi — bref, l’œuvre d’un moraliste au sens fort, dans la lignée des moralistes du Grand Siècle, voire d’un Kundera.
Dans le climat de puritanisme entourant l’affaire Clinton/Lewinsky, La Tache règle ses comptes avec les hypocrisies du monde universitaire. Roth excelle à montrer comment un mot mal reçu suffit à détruire une réputation patiemment construite. Mais derrière ce scandale universitaire se cache une histoire autrement plus vertigineuse, sans quoi un roman de Philip Roth ne serait pas, bien sûr un roman de Roth: Coleman n’est pas l’homme que tous croyaient. On l’a toujours pensé juif, mais il est en réalité né dans une famille afro-américaine et a choisi, très jeune, de « passer » pour blanc afin de tracer son chemin dans l’Amérique ségrégationniste. Ce secret, gardé au prix d’un reniement familial irréversible, éclaire d’une lumière tragique l’accusation de racisme qui le frappe à la fin de sa vie.
Tragédie d’un homme, La Tache est aussi cependant celle de l’Amérique. Bien plus qu’un récit de scandale, le roman, qui se présente comme le travail d’une enquête faite par Nathan Zuckerman sur Coleman, ce voisin, cet ami qu’il a finalement peu connu, au cours des dernières années de sa vie, est d’abord le miroir grossissant des crispations identitaires et morales d’une Amérique obsédée par la pureté et prompte à la dénonciation. Les petites querelles académiques deviennent la scène d’une tragédie nationale, où chacun cherche à traquer la faute, à exhiber la faute. C’est un retournement ironique d’une écriture qui se nourrit pourtant des secrets sur lesquels se construit chacune des personnalités du roman: origine dissimulée, illétrisme joué…; – chacun dans ce roman a son petit ou grand secret, sa solitude à quoi il se raccroche pour tenter de sauver une dignité précaire! La voix de Nathan Zuckerman, donne au roman une profondeur méditative: au-delà des péripéties, Roth scrute la mécanique des passions collectives, la violence des mots, les traumatismes du Vietnam, l’usure des corps, la hantise de l’âge et du désir. Car le vieux professeur, rejeté par les siens, s’éprend d’une femme beaucoup plus jeune, Faunia Farley, rescapée d’une existence chaotique. Leur liaison, jugée scandaleuse, devient pour lui une ultime affirmation de vie.
A côté de ce couple improbable, et de Zuckerman, le narrateur, Delphine Roux, jeune universitaire française, incarne l’obsession de la pureté idéologique qui menace l’université. Moins d’ailleurs par conviction que pour faire sa place dans cette université américaine qui en même temps la déroute. Jeune française brillante, normalienne, venue aux Etats-Unis pour y affirmer sa réussite personnelle, loin de son milieu familial, elle se pense gardienne d’une forme de perfection académique, mais Roth en fait le portrait d’une crispation: sous son apparente rigueur se cache un mélange d’envie et de ressentiment, la solitude d’une petite française transplantée dans une terre étrangère, qui la pousse à devenir l’artisan acharné de la chute de Coleman. J’avoue que ce personnage est celui qui m’a le moins convaincu. On a souvent reproché à Roth sa misogynie. Peut-être est-ce cela. Mais bon, il est vrai que l’argument tombe un peu quand on le compare aux deux beaux portraits de femmes que contient le roman: celui de Faunia Farley et celui d’Ernestine, la soeur de Coleman qui resurgit à la fin du roman. Déroutant Philip Roth, qui cache sans doute lui aussi ses secrets! En tout cas, Delphine Roux fournit à un Roth, toujours caustique, le prétexte de quelques pages enlevées de satire sociale sur les milieux intellectuels parisiens qui ne manquent pas de piquant… et d’une certaine pertinence. À l’opposé, Les Farley, l’ex-mari violent de Faunia, vétéran du Vietnam, est la figure de la brutalité brute, d’un homme détruit par la guerre, incapable de se réinscrire dans la vie ordinaire, et qui traîne sa haine comme une blessure jamais refermée. Tous deux portent, à leur manière, leur propre « tache » : Delphine, celle du dogmatisme qui dissimule mal sa fragilité ; Les, celle d’une violence héritée de l’Histoire et retournée contre les siens. Ils accentuent l’isolement tragique de Coleman et Faunia, et montrent que nul n’échappe, dans ce roman, à la part d’ombre qui le poursuit.
Et puis, bien sûr, il y a tous ces moments de brio d’un Roth peignant, de digressions en digressions, le tableau réaliste d’une Amérique qui se nourrit paradoxalement de l’imagination en liberté de son auteur. Moments de brio que j’attends de roman en roman, tellement est grand le talent du romancier, dans cette attention soutenue au réel, à intéresser son lecteur à des sujets qu’il ne supposait pas pouvoir un jour soulever seulement son intérêt: combats de boxe du jeune Coleman, rêveries de Faunia sur les corneilles dont le vol et les croassements envahissent littéralement l’espace de 10 pages, etc. Et, bien sûr encore, cette réflexion sur les formes de la tragédie, que l’on retrouve également de roman en roman, renforcé ici en outre par la profession de Coleman. Il faudra que je développe un jour cette dernière question, sans doute à l’occasion d’un prochain billet sur Roth, celui-ci étant déjà bien trop long.
Je suis sorti en tout cas de La Tache, comme bien d’autres lecteurs avant moi sans doute, secoué par la lucidité de Roth: la dénonciation morale y apparaît comme une autre forme de barbarie, tandis que le secret intime, celui de Coleman, éclaire la tragédie d’un homme qui aura tout misé sur une identité choisie et en aura payé le prix. C’est un roman âpre, magistral. Je sais que les lecteurs de Roth se partagent entre inconditionnels de La Tache et inconditionnels de Pastorale américaine. Pas sûr qu’il soit facile finalement de choisir entre les deux – et d’ailleurs le doit-on?
« Car nous sommes dans l’ignorance, n’est-ce pas? Il est de notoriété publique que… Qu’est-ce qui fait que les choses se passent comme elles se passent? Ce qui sous-tend l’anarchie des événements qui s’enchaînent, les incertitudes, les accrocs, l’absence d’unité, les irrégularités choquantes qui caractérisent les liaisons. Personne n’en sait rien, professeur Roux. A dire « il est de notoriété publique que », on ne fait qu’onvoquer un cliché, que commencer à banaliser l’expérience, et ce qui est insupportable, c’est l’autorité sentencieuse des gens quand ils répètent ce cliché. Ce que nous savons, hors clichés, c’est que personne ne sait rien. on ne peut rien savoir. Même les choses que l’on sait, on ne les sait pas. Les intentions, les mobiles, la logique interne, le sens de actes? C’est stupéfiant, ce que nous ne savons pas. Et plus stupéfiant encore, ce qui passe pour savoir. »
Philip Roth, La Tache (2000), traduction: Josée Kamoun, Folio/Gallimard
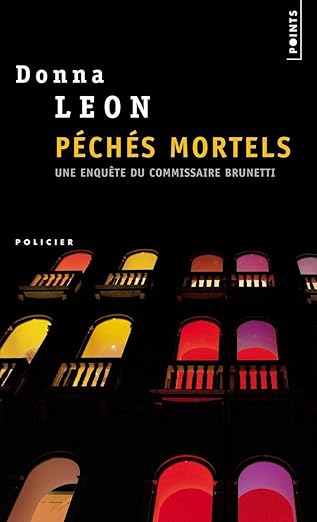
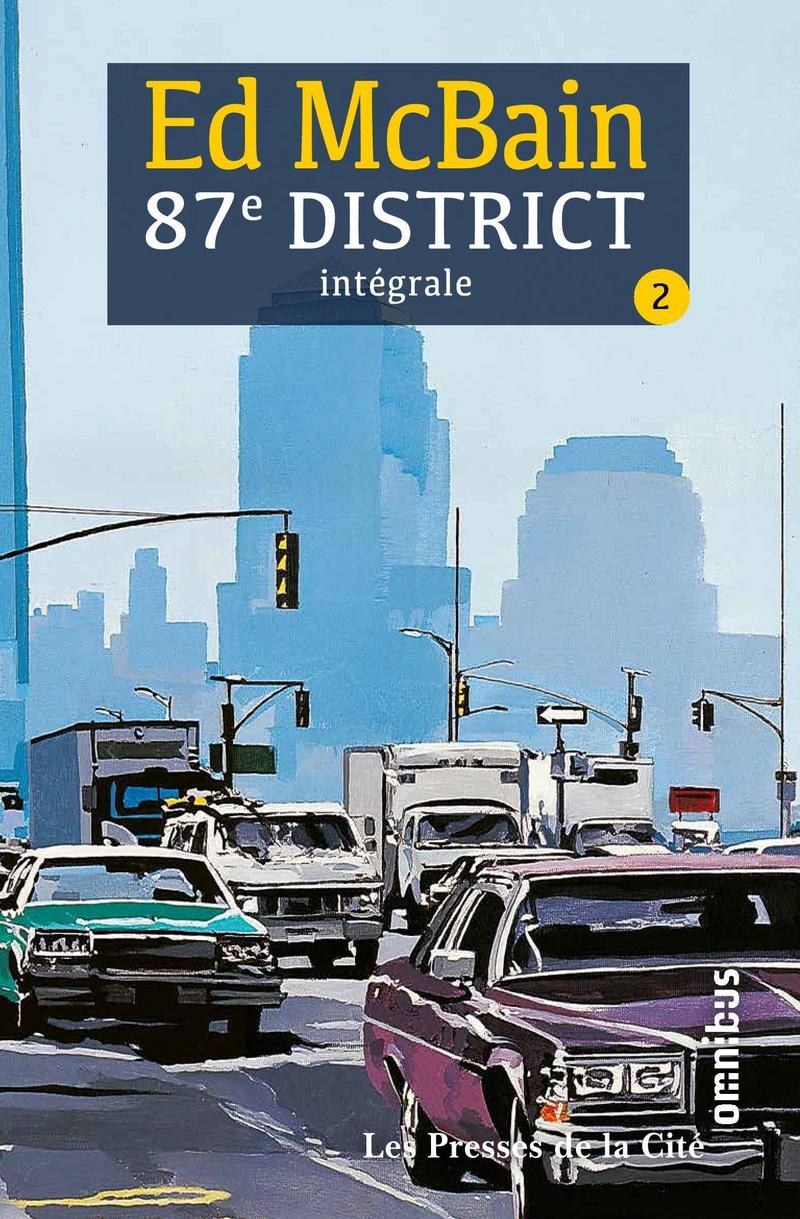
6 commentaires
Virginie Vertigo · 25 septembre 2025 à 19 h 48 min
J’adore Philip Roth, j’ai lu beaucoup de ses livres. « La Tâche » est mon roman préféré de cette trilogie. Oui, c’était un auteur tellement lucide sur son monde, sur l’Amérique. J’aurais tellement aimé qu’il nous écrive encore sur ce qui se passe actuellement même si, de façon visionnaire, il avait déjà flairé la tendance.
Cléanthe · 27 septembre 2025 à 11 h 50 min
Je dirais que le réel dépasse même ses prévisions… Philip Roth est un auteur que j’aime beaucoup également. Du coup, sans attendre, j’ai repris le premier Nathan Zuckerman, et je pense lire/relire assez vite l’ensemble de la série.
Ingannmic · 26 septembre 2025 à 10 h 43 min
J’ai découvert Roth avec ce titre, qui m’a été offert à sa sortie par mon conjoint, sur les conseils d’un libraire (je ne connaissais même pas l’auteur de nom…). Je l’ai trouvé brillant, subtil, mais je crois n’avoir pas tout compris… il faudrait que je le relise…
Cléanthe · 27 septembre 2025 à 11 h 50 min
Je ne sais pas si tu en as lu d’autres ensuite. Pastorale américaine est très bien également.
nathalie · 27 septembre 2025 à 8 h 28 min
J’ai pas du tout aimé ce roman. Très mal à l’aise avec les personnages. J’ai eu l’impression que l’auteur se réjouissait de faire un texte brillant, habile, tendant un piège à tout le monde, mais je ne me suis pas du tout attachée à cet univers et à ce propos.
Cléanthe · 1 octobre 2025 à 10 h 52 min
Je comprends très bien cela. Parfois, la rencontre avec un auteur, un roman ne se fait pas. Je ne sais pas si tu as lu d’autres romans de Roth?