Léa WIAZEMSKY: Petit éloge des cafés
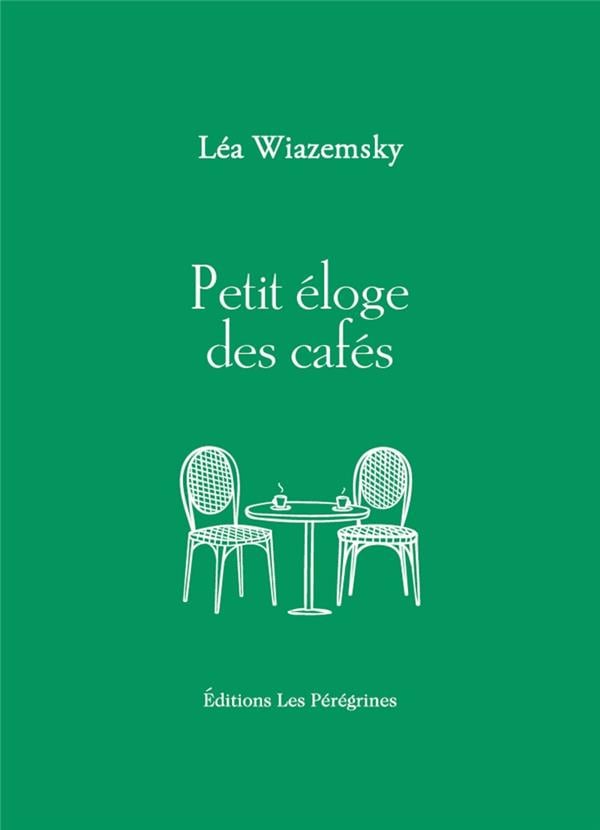
On tourne la première page, et aussitôt reviennent l’odeur du café brûlant, le brouhaha des conversations qui se chevauchent, la lumière oblique d’un après-midi d’hiver, la rumeur d’un percolateur, et ce sentiment qu’on est ici chez soi plus qu’ailleurs. Petit éloge des cafés, de Léa Wiazemsky, appartient à cette catégorie de textes qui réveillent une mémoire sensible, presque tactile: celle des lieux où l’on a lu, écrit, attendu, aimé, pleuré — et où l’on a surtout appris à regarder les autres. Des lieux qui sont ceux d’une vie…
Grand amateur des cafés, où j’aime lire, écrire, travailler, dessiner, que je collectionne même, pourrais-je dire, au gré de mes voyages ici ou là, où j’ai mes habitudes (c’est d’ailleurs dans l’un d’eux que je rédige ce billet…), je ne pouvais pas laisser passer ce livre, qui me faisait de l’œil depuis deux ou trois semaines sous son élégante couverture verte. Un éloge, comme les éditeurs aiment en publier ces temps-ci, sous des titres divers: éloge, dictionnaire amoureux… où il est tout autant question des cafés que de l’autrice elle-même, un récit subjectif, conduit du point de vue d’une histoire personnelle, dans ce qu’elle a de plus singulier. Lea Wiazemsky, fille de Régine Deforges et du dessinateur Wiaz, arrière petit-fille de Mauriac (j’en parle parce que ces références familiales tiennent une place importante tout au long de ses pages) ne signe ni une étude sociologique ni une ode nostalgique aux cafés d’antan. Elle propose quelque chose de plus intime: une traversée des cafés qui ont ponctué sa vie, depuis les troquets populaires, en passant par les cafés où elle a servi en tant qu’étudiante, jusqu’aux palaces feutrés qui racontent une autre histoire du monde.
C’est ce que j’ai aimé dans ce livre. C’est par là qu’il est attachant. Dans ces pages, le café rappelle sa fonction de maison ouverte: un refuge, un théâtre du quotidien, un laboratoire de sociabilité, un lieu d’apprentissage du regard. Léa Wiazemsky écrit son amour des cafés en laissant revenir les images: un serveur qui connaît votre commande avant même que vous ne la formuliez, des étudiants qui refont le monde en négligeant leurs partiels. Elle rappelle que les cafés sont des parents adoptifs: ils vous accueillent sans poser de questions, et peuvent même vous recueillir à la suite d’un chagrin d’amour. Quelques beaux lieux de la culture des cafés parisiens sont évoqués: la Coupole, le Procope, le Flore, le bar Hemingway au Ritz… L’Histoire n’est pas absente, et notamment l’évocation du rôle joué, pendant l’Occupation, par les cafés pour les réseaux de Résistance. De page en page, ainsi, un motif s’impose: le café n’est jamais seulement un décor. C’est un point fixe dans un monde de plus en plus mouvant. Lieu de passage, certes, mais aussi lieu d’ancrage. Une référence d’un certain art de vivre… à la française.
Et c’est là que je n’ai plus suivi Léa Wiazemsky! C’est ce que j’ai moins aimé, dans son livre, qui m’a même agacé parfois: un tropisme parisien un peu étroit, un ancrage très Rive gauche, parfois franchement germanopratin. Et quand on quitte Paris, c’est pour la Provence, Bordeaux, la Bretagne, l’Ile de Ré… une Province bien parisienne, ma foi! Ce n’est pas l’éloge subjectif qui m’a ennuyé, son inscription dans un lieu particulier. Ce serait déplacé pour un lecteur qui se nourrit en ce moment des œuvres de Philip Roth, Ed McBain ou Friedrich Dürrenmatt. Seulement, voilà, à partir de leur coin singulier, ces auteurs trouvent aussi à saisir quelque chose d’universel. Léa Wiazemsky revendique l’universalité des cafés… tout en affirmant, à plusieurs reprises, qu’on ne trouverait de véritables cafés qu’en France, que ceux de l’étranger seraient de « pâles copies », que la culture du café serait une invention typiquement française, et que rien n’égalerait le garçon de café parisien. Ce parisianisme d’auto-célébration — volontiers convaincu d’être le centre du monde — prête un peu à sourire. Car enfin où placer alors, dans la grande culture des cafés, les Kaffeehäuser viennois? les cafés historiques de Turin où le rituel de l’aperitivo prend des allures de fête, de célébration? et Trieste? et Lisbonne? et Istanbul? et Prague? et Budapest? et Varsovie? et Ljubljana? À côté de la grande culture des cafés de la Mitteleuropa — où l’on peut encore aujourd’hui passer la journée entière à écrire, lire la presse, refaire le monde sous des plafonds rehaussés de stucs — les cafés parisiens paraîtraient parfois presque… provinciaux. Et je ne parle pas des cafés maures du Maghreb, des cafés d’Istanbul, des cafés du Caire…
Je sors donc un peu mitigé de ma lecture de ce Petit éloge des cafés, avec lequel j’ai passé cependant un agréable moment, mais qui ne m’a pas transporté et qui ne séduira peut-être que ceux qui comme moi sont vraiment accros à ces endroits. Une curiosité en tout cas qui, à l’occasion, mérite éventuellement le coup d’œil.
6 commentaires
Aifelle · 27 novembre 2025 à 6 h 47 min
Je ne vais pas me précipiter, je pense que je serais agacée comme toi par ce parisianisme qui tourne en boucle sur lui-même dans un certain monde littéraire. Je pensais en te lisant aux cafés viennois et autres … dans le genre tu as sûrement lu celui de Chantal Thomas « cafés de la mémoire » que j’ai beaucoup aimé.
Cléanthe · 27 novembre 2025 à 15 h 23 min
Non justement. Merci pour la référence. Je note.
Nathalie · 29 novembre 2025 à 21 h 26 min
Ah le charme des PMU miteux, pourtant c’est irremplaçable… et oui les cafés de Turin, et ceux de Madrid où l’on boit du chocolat chaud et du café con leche jusqu’à midi… Je te rejoins pour ne pas lire ce truc.
Cléanthe · 29 novembre 2025 à 21 h 40 min
Oui, j’oubliais les cafés de Madrid, les tartines de pain frottées de tomates sur un filet d’huile d’olive qu’on peut prendre dès le petit déjeuner. Et le soir les tapas directement au comptoir.
Bon, ceci dit, malgré son prisme très franco-français qui ignore qu’il y a un monde au-delà de son horizon, le livre n’est pas inintéressant. Mais c’est vrai que cela m’a agacé.
keisha · 2 décembre 2025 à 15 h 11 min
Un poil parisien (donc agaçant)pour ceux qui comme toi ont une vision plus large des cafés. Je les fréquente peu (parlez moi des salons de thé)
Mais c’est une jolis collection par ailleurs. Petit éloge des chats et Petit éloge de la procrastination ont déjà contribué à mon bonheur (sans billet, mais il faut me croire)
Cléanthe · 3 décembre 2025 à 17 h 51 min
Que son évocation s’inscrive dans son expérience personnelle, c’est normal, et même plaisant à lire – c’est le propos de la collection. En fait, j’ai moins été agacé par ce côté parisien, que par l’impression que pour l’autrice il n’existe rien en dehors de sa ville et de son milieu. Ce qu’elle affiche même au détour de certaines pages. Et là, ça me gêne. Dommage, parce que le livre est agréable aussi à d’autres moments. Et la collection séduisante, en effet.